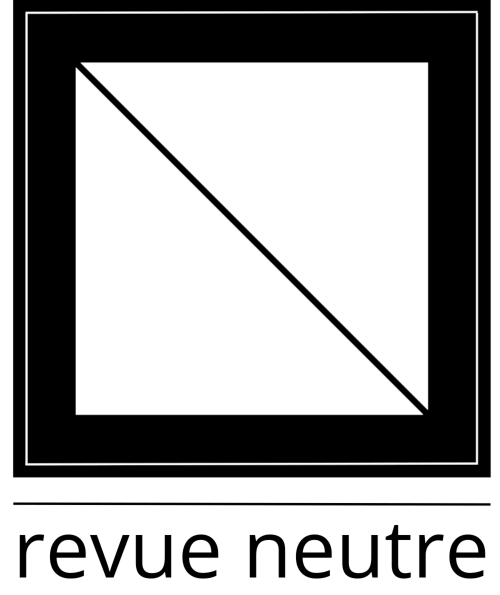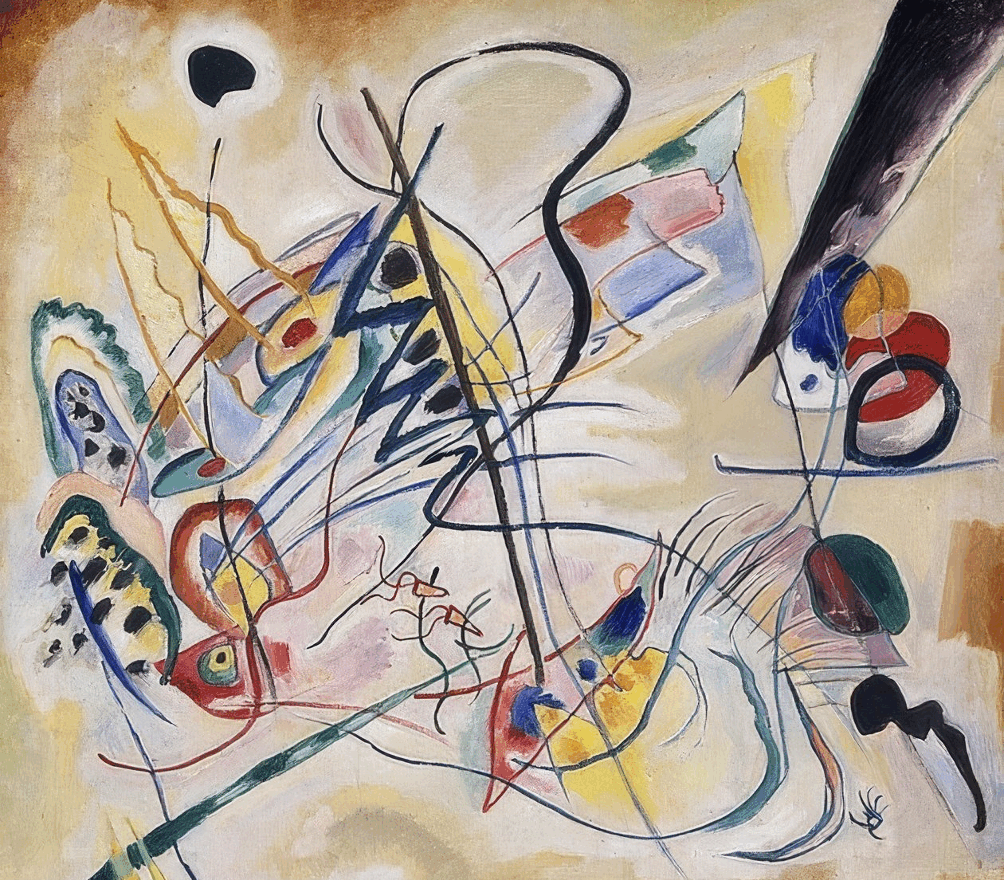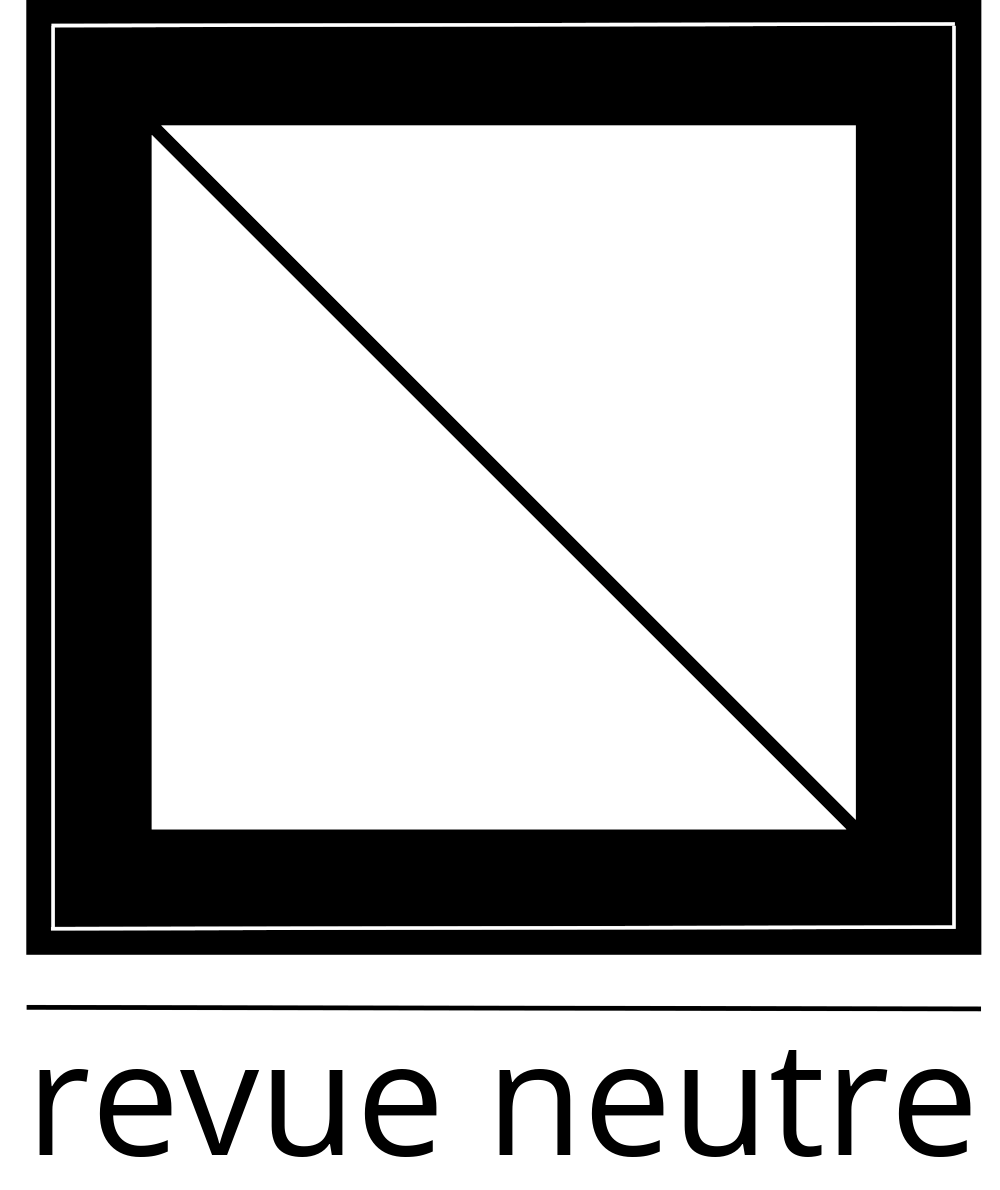TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE
Quand le code propre fait des siennes
George-Henri Melenotte

Robert Doisneau – Mademoiselle Anita
LEEBCLASIPA
Raymond Roussel
Au Xe Congrès de l’École freudienne de Paris, le jeudi 6 juillet 1978, Jean Allouch présente « De la translittération en psychanalyse1 ». Son intervention précède de six ans la publication de son premier livre, Lettre pour lettre2, paru en 1984.
Il emprunte à Marcel Cohen cette définition de la translittération comme « transfert caractère à caractère d’une écriture dans une autre sans aucune interprétation3 ». Elle donne à chaque lettre ou signe syllabique « un correspondant dans un autre alphabet, construit un écrit à partir de l’écrit, procède pour ce faire au coup par coup, c’est-à-dire compte un à chacune de ses opérations4 ». De cette définition, ressort la correspondance signe à signe qui produit un nouvel écrit à partir d’un écrit précédent. La translittération est comptable. Elle témoigne d’une indifférence quant au sens produit par le passage d’un écrit à un autre écrit. Si l’on part d’une première écriture orthographiée, rien ne garantit que la seconde écriture le soit selon la même orthographie que la première. Le plus souvent, elle change.
En 1984, dans Lettre pour lettre, Jean Allouch déploie la notion de rébus à transfert en prenant un exemple, celui de « pipe en terre5 ». On passe de « pipe en terre » à pi panthère. Ce passage se fait en trois temps :
| « Pipe en terre » (1) Son Pipe en terre |
. (2) Écriture Pip en terre |
pi panthère (3) Écriture pi pan thère |
| ← | transcription | → | ||
| ← | translittération | → |
Dans un premier temps, la première expression verbale « pipe en terre » passe d’une syllabe prononcée à une syllabe homophone mais écrite cette fois-ci : soit la transcription de « pipe en terre » (son) à pip en terre (écrit). Ensuite, on passe de l’écriture pip en terre à une autre orthographe : pi panthère, soit par translittération.
Si, avec « pipe en terre », l’orthographie est évidente, tel n’est plus le cas avec pip en terre, ni avec pi panthère. Si « pipe en terre » véhicule un sens aisé à repérer, avec pi panthère, il ne l’est plus. Il en va de même pour l’orthographe : la seconde écriture échappe à celle de la première. Dans cette présentation, la première expression (« pipe en terre ») passe par une tournure intermédiaire marquée par une décomposition syllabique (« pip—en—terre ») qui donne à la fin une formulation translittérée (pi—panthère). La formule intermédiaire (« pip—en—terre ») (2) est remarquable dans l’opération puisqu’elle sert de charnière au passage de « pipe en terre » (1) à pi panthère (3).
La censure degré zéro et sa méthode
Trente-quatre ans après, devant l’École des Forums du Champ lacanien, Jean Allouch présente un travail intitulé « Le degré zéro de la censure6 ». Ce titre, inspiré par Roland Barthes avec Le degré zéro de l’écriture, reprend à son compte le terme freudien de censure. S’y trouvent des remarques éclairantes sur ce degré zéro de la censure. Blanchot a son mot à dire qui porte sur le neutre :
Parler au neutre, c’est parler à distance, en réservant cette distance, sans médiation, ni communauté, et même en éprouvant le distancement infini de la distance, son irréciprocité, son irrectitude ou sa dissymétrie7 […].
Blanchot toujours :
La parole neutre ne révèle ni ne cache. […] elle ouvre dans le langage un pouvoir autre, étranger au pouvoir d’éclairement (ou d’obscurcissement), de compréhension (ou de méprise)8.
Blanchot enfin :
L’exigence du neutre tend à suspendre la structure attributive du langage, ce rapport à l’être, implicite ou explicite, qui est, dans nos langues, immédiatement posé, dès que quelque chose est dit9.
Alors, pourquoi parler de « degré zéro de la censure » ? On trouve ces formulations diverses du neutre :
On appelle degré zéro le terme non marqué de l’opposition. Le degré zéro n’est donc pas à proprement parler un néant […], c’est une absence qui signifie10.
Avec cette censure, il est impossible de marquer le terme d’une opposition par la négation, comme avec un « ce n’est pas… ». Il ne s’agit pas non plus d’un caviardage comme en temps de guerre, où la censure y est trop voyante. Elle revient plutôt à effacer le propos, le réduire à rien. Ce propos n’aura pas existé. Seule demeure son absence significative comme le montre le futur antérieur d’un « il aura été là ». Ne reste comme seule trace de cette absence que la présence de cette absence.
Une autre remarque :
Et c’est donc tout juste si l’on peut parler là, dans cette négligence de certains thèmes, dans le silence où on les maintient, d’une censure11.
Avec l’emploi réglé des mots « négligence », « silence », c’est tout juste si l’on n’excuserait pas cette censure. Là se confirme non seulement son fonctionnement discret qui veille à ce que l’on s’en rende compte le moins possible, mais aussi le prétexte que la négligence ou le silence assumé fournissent à la censure, en lui donnant de mauvaises raisons.
Avec elle, il s’agit aussi « d’une façon de s’en remettre à certaines catégories aux dépens d’autres silencieusement délaissées12 ». La censure degré zéro efface une catégorie, et puis, elle la remplace par d’autres qui masquent l’oubli volontaire. Ce sera l’usage massif par Jacques Lacan du désir qui a eu pour effet « une négligence de la volonté ». Ou encore le recouvrement par l’ « inconscient » du « ça », maintenu, lui, dans les oubliettes d’un Freud d’un autre temps. En jouant de cette censure, la doxa a donné à l’inconscient la place d’un centre de gravité aux dépens du « ça ». Ou un autre exemple : le déterminisme des faits psychologiques (la cause) qui témoigne si bien de la négligence, entretenue elle, vis-à-vis de « la liberté de tout un chacun13 ».
Effacement, négligence, remplacement ne qualifient pas à eux seuls la censure degré zéro. Il y a aussi la colonisation du discours :
Il y a « censure degré zéro » si et seulement si c’est de façon insistante qu’un terme habite les discours, les colonise (l’objet a qui fait flores pour les détenteurs d’un fantasme fondamental) aux dépens d’un autre terme qui, étant donné le contexte ou ce que l’on souhaite dire, pourrait s’y trouver à sa place14.
On saura que le terme qui s’est trouvé délogé par l’objet a n’est autre que le neutre quand la chute de ce dernier lui laisse sa place comme lieu. Sur ce point où se repère le passage de la première à la seconde analytique du sexe, Jean Allouch écrit :
Le vide du neutre peut n’être pas sans référence à la condition qu’une coupure la produise, produise cet objet petit a, cet objet chu qui, alors, fait place au neutre15.
La chute de l’objet, liée à l’effacement progressif de l’objet de l’incarpation (qui occupait le lieu de l’Autre et où il incarnait l’objet), laisse un vide à sa place, un vide qui donne son lieu au neutre à la place même occupée auparavant par cet objet.
La folie selon Foucault est un langage exclu
Aux alentours des années 1955-60, Foucault réserve à la folie des feuillets remarquables. Ils la démarquent d’une approche psychopathologique16 et lui permettent de surcroît de donner accueil à divers auteurs dont Raymond Roussel.
Dans un article intitulé « La littérature et la folie17 », Foucault indique que la folie est une fonction sociale spécifique qui « s’exerce sur le langage ». C’est par lui que la folie se perçoit. Aussi, ce qui se cache sous les troubles du comportement est-il toujours « un trouble de l’expression18 » :
Je répondrai que d’une façon générale ce qui désigne un fou dans une société quelconque, ce n’est pas sa conduite, c’est son langage19.
Autre point : Foucault constate que, dans toute société, le langage est le lieu d’interdictions privilégiées et particulières. Il prend acte de ce qu’« il n’y a pas de cultures où tout le langage soit autorisé20 ». Il s’ensuit qu’il y a des transgressions de langage. La folie est l’une d’entre elles. D’où cette acception que Foucault confère à la folie : « La folie est un langage autre. »
Si le langage est incomplet, son incomplétude tient aux interdictions qui le frappent. Ces interdits peuvent dépendre de ce qui est rendu tabou par un autre code. Celui-ci pourra relever du code commun, être religieux, politique, familial ou éthique. Quand il est moral et que le code verbal lui est soumis, ce dernier passera sous la férule du code des bonnes mœurs, des vertus de la famille, de la religion ou de la politique.
Sont interdits aussi les mots qui disent autre chose que ce qu’ils disent. La psychanalyse tombe sous leur coup. Changer le sens des mots serait un outrage sémantique, et de ce fait, une hérésie.
Il arrive enfin que la parole soit transgressive au point de prendre ses aises avec le code commun de la langue, fait de sa syntaxe, de son vocabulaire, de sa phonétique et de sa grammaire21. Quand la parole transgresse les règles du code commun, elle vaut comme une langue dotée d’un autre code qui n’est pas fait de la même eau. Ce sera le code propre de cette langue. La langue commune est mise en péril par le caractère transgressif de la parole quand celle-ci relève du code propre. Foucault donne notamment en exemple l’ésotérisme : quand une parole n’est accessible qu’à ceux qui en détiennent le code et peuvent, grâce à lui, accéder à sa compréhension. Il y a folie quand la parole s’émancipe de la tutelle du code commun pour faire valoir son propre code22.
Dans « La folie, l’absence d’œuvre23 », paru en mai 1964, on retrouve les mêmes points sur les interdits du langage. La langue y est partagée : d’un côté, la langue commune offerte à tous ceux qui la parlent. C’est la langue de la communication du sens et de l’échange ; de l’autre, la langue réservée tout au plus à quelques-uns. C’est la langue de la transgression offerte uniquement à ceux qui savent l’accueillir. Foucault s’impatiente : « Il faudra bien un jour étudier ce domaine des interdits du langage dans son autonomie ». Car, le langage échappe bien au contrôle absolu qui le maintiendrait en son entier sous la férule du code commun. Or, il se trouve, constate-t-il, que l’insoumission au code commun est inévitable :
Il est bien probable que toute culture, quelle qu’elle soit, connaît, pratique et tolère (dans une certaine mesure), mais réprime également et exclut ces […] paroles interdites24.
L’expérience de la folie n’est plus comme dans son précédent article l’une des formes possibles des transgressions du langage. Cette fois-ci, elle se déplace sur l’échelle des formes de paroles interdites. Ce déplacement indique que son domaine va des fautes de langage, aux mots blasphématoires, en passant par les paroles à la signification intolérable avant d’en arriver à ce que Lacan appelle le signifiant.
Foucault précise :
La folie, c’est le langage exclu — celui qui, contre le code de la langue, prononce des paroles sans signification (les « insensés », les « imbéciles », les « déments »), ou celui qui prononce des paroles sacralisées (les « violents », les « furieux »), ou celui encore qui fait passer des significations interdites (les « libertins », les « entêtés »)25.
En posant que : « la folie, c’est le langage exclu », il lui donne une portée générale. Il y inclut toutes les paroles rebelles à la dictature du code commun. Il élargit de façon considérable le champ de la folie comme champ de tout le langage exclu. Cette nouvelle acception non seulement la détache de la portée psychopathologique donnée par son annexion par la médecine, mais elle annexe dans son entier le champ de toutes les paroles qui ne se soumettent pas à la dictature du code commun de la langue. La folie, c’est le langage des interdits de la langue.
Trois clés donnent accès à la folie selon Foucault :
1/ Il y a un langage propre à la folie. C’est lui qui fait la folie.
2/ La folie comme langage est une transgression du langage du code commun. Elle passe outre les interdictions édictées par ce code. Elle est le langage exclu par ces interdictions.
3/ Si la folie se caractérise par son langage propre, ce langage est un langage autre que le langage commun (c’est-à-dire communicationnel). Au dehors du champ du langage vertueux et respectueux du code commun, elle se localise dans le champ des interdictions du langage produites par la culture. La définissant comme un langage Autre, Foucault inscrit le langage de la folie au lieu de cette Altérité.
Ce propos où Foucault donne une définition toujours plus large à la folie, permet de passer de la folie comme langage exclu au langage exclu comme folie. C’est sur la base d’une telle ouverture qu’un auteur comme Raymond Roussel va se trouver placé sous le signe de la folie.
Quand surgit le code propre
Dans sa Postface à Lettre pour lettre, Jean Allouch cite Foucault à propos de la folie de Raymond Roussel. Il renvoie à l’importance du code propre dans la folie26 :
[…] la folie porte atteinte à la langue en tant que code (p. 105)27 ; la parole reconnue folle (ou/et littéraire) met la langue en danger. Comment ? En ayant son chiffre en elle-même (p. 106). En tant que telle, la folie ne puise pas dans le code commun, mais véhicule son propre code dans sa parole […].
Suit cette citation de Foucault :
La folie n’obéit à aucune langue (et c’est pour cela qu’elle est insensée) : mais elle contient son propre code dans les paroles qu’elle prononce […]28.
Dans son livre « Raymond Roussel29 », Foucault se livre à une analyse du procédé qui a servi à Roussel dans nombre de ses livres. On la trouve dans un extrait de ce livre30 puis dans un passage sur Roussel tiré de l’article La littérature et la folie31. Si les deux textes se rejoignent en grande partie, ils présentent cependant des différences.
Dans l’extrait du livre (A), on lit :
À ce risque généralisé (celui du dévoilement du procédé), on peut supposer plusieurs figures dont l’œuvre de Roussel (n’est-elle pas, après tout, le secret du secret ?) donnerait les modèles. Il se peut qu’au-dessous du procédé révélé dans le texte dernier, une autre loi établisse son règne plus secret et une forme tout à fait imprévue. Sa structure serait celle, exactement, des Impressions d’Afrique ou de Locus Solus : les scènes aménagées sur le tréteau des Incomparables ou les machineries du jardin de Martial Canterel ont une explication apparente dans un récit — événement, légende, souvenir, ou livre — qui en justifie les épisodes ; mais la clé réelle — ou en tout cas une autre clé à un niveau plus profond — ouvre le texte selon toute sa longueur et révèle sous tant de merveilles la sourde explosion phonétique de phrases arbitraires. Peut-être, après tout, l’œuvre en son entier est-elle construite sur ce modèle : Comment j’ai écrit certains de mes livres jouant le même rôle que la seconde partie des Impressions d’Afrique ou les passages explicatifs de Locus Solus, et cachant, sous prétexte de révélation, la vraie force souterraine d’où jaillit le langage32.
L’article (B) est bref :
L’autre partie de son œuvre est tout aussi obsessionnelle et plus étrange encore. Il choisit au hasard des phrases toutes faites ( « j’ai du bon tabac »), il en extrait des sonorités approximatives et à partir d’elles bâtit une série de mots qui servent de fil conducteur à une nouvelle histoire. Il s’agit d’un traitement du hasard dans le langage : soumettre des phrases à des explosions phonétiques et, les dés sonores une fois retombés, bâtir un nouvel édifice verbal à partir de la figure ainsi constituée33.
Dans Foucault, Gilles Deleuze dit de la méthode de Roussel qui porte sur les mots, les phrases ou les propositions, qu’il « faut donc fendre, ouvrir les mots, les phrases ou les propositions pour en extraire les énoncés34 ». Il précise :
Ouvrir les mots, les phrases et les propositions, ouvrir les qualités, les choses et les objets […] Il faut extraire des mots et de la langue les énoncés correspondant à chaque strate et à ses seuils, mais aussi extraire des choses et de la vue les visibilités et les évidences propres à chaque strate35.
Par « clé » du procédé, Deleuze entend une ouverture du texte bien singulière. Comme il le suggère, faut-il voir dans « explosion phonétique » une telle ouverture ? Quelle est-elle alors ? Faut-il extraire des mots de la langue les énoncés correspondant à chaque strate ? C’est bien à cela que nous invitent les deux extraits (A) et (B).
En partant d’un extrait d’Impressions d’Afrique36, et en suivant les éléments de l’analyse de Foucault sur le procédé de Roussel, on obtient ceci : on part d’une phrase d’une comptine familière : « J’ai du bon tabac dans ma tabatière ». En translittérant cette phrase, on a comme résultat la seconde écriture suivante : « Jade tube onde aubade en mat à basse tierce ».
J’ai du bon tabac dans ma tabatière
Jade tube onde aubade en mat à basse tierce
La translittération fait passer directement la phrase de départ à une seconde phrase, faite d’une série de mots du vocabulaire de la langue commune mais non corrélés selon une syntaxe. Ces deux phrases ne sont pas en rapport entre elles par le sens. Elles le sont par le son. C’est l’homophonie à peu près qui mène la danse.
L’originalité de Foucault tient à ce qu’il conteste ce rapport direct entre les deux phrases. Il introduit entre elles une étape intermédiaire.
C’est ce que montre l’extrait tiré de l’article (B) dans le schéma suivant :
Article (B)
1
J’ai du bon tabac dans ma tabatière
phrase toute faite
2
j’ai d/u bon t-/ abac d/-ans/ ma t/a/batière
explosion phonétique
Cassure des mots (/)
Ouverture des mots en dés sonores
(Deleuze sur Roussel)
3
Jade Tube onde aubade en mat à basse tierce
reconfiguration des dés sonores
par sonorités approximatives
(Homophonie à peu près)
Dans la translittération (étapes 1 et 3), on voit une phase intermédiaire (étape 2). Ce qui se lit de la façon suivante :
1/ J’ai du bon tabac dans ma tabatière
i
| 2/ jaid/ubont / abacd / ans/ ma t /a / batière |
i
3/ Jade Tube onde aubade en mat à basse tierce
Dans cette phase intermédiaire, les slashs signent la découpe de l’explosion phonétique qui casse les mots. Ne restent que des paquets de lettres : jaid ; unbont ; abacd ; ans ; mat ; a ; batière. Ces paquets répondent à un code propre énigmatique. Ils n’ont pas de syntaxe, pas de grammaire, pas de vocabulaire, pas de sens communicable. Ils ne relèvent plus du code commun de la langue. Si la folie est du langage exclu du fait des interdictions venues de la domination du code commun de la langue, alors les paquets de lettres : jaid ; unbont ; abacd ; ans ; mat ; a ; batière, relèvent de la folie comme langue exclue telle que définie par Foucault. Chacun de ces dés, pris un à un, porte atteinte à la langue en tant que code commun producteur de sens.
Avec la cassure des mots, on retrouve ici un équivalent de la décomposition syllabique dont Jean Allouch a fait état dans son exposé de 1978.
En suivant le fil qui relie « bon tabac dans » à « aubade », on constate que le paquet de lettres est issu de mots tout faits. Ces paquets de lettres vont évoluer vers un nouveau mot issu de la reconfiguration des paquets sonores. Ce qui donne ceci :
| 1/ Bon tabac dans | Phrase familière | — code commun |
| 2/– abac d/- | paquets de lettres | — code propre |
| 3/ aubade | reconfiguration | — code commun |
Dans la phrase familière (1), fonctionne le code commun de la langue. Puis se produit l’explosion phonétique (l’ouverture des mots). C’est une explosion en paquets de lettres sans aucun sens. Ils relèvent du code propre comme langage exclu (2). Puis l’on revient au code commun par une reconfiguration de la langue. Foucault parle du rôle « que Roussel assignait aux phrases qu’il trouvait toutes faites, et qu’il brisait, pulvérisait, secouait, pour en faire jaillir la miraculeuse étrangeté du récit impossible37. »
Ce qui jaillit en effet de l’ouverture des mots est l’étape 2 caractérisée par cette « miraculeuse étrangeté du récit impossible ».
On est mené à des remarques sur la différence entre code propre et code commun :
1/ L’exemple de translittération analysé montre que, dans le procédé roussélien étudié, entre les deux écritures, se glisse une phrase intermédiaire qui relève du code propre de la folie.
2/ Cette intercalation du code propre est le résultat d’une explosion phonétique qui casse les mots de la langue commune en paquets de lettres sans sens. Ces paquets écrivent un récit impossible qui répond à un code propre.
3/ Les paquets de lettres seront ensuite reconfigurés de façon telle qu’ils retourneront au vocabulaire du code commun dans un ordre réglé par l’homophonie à peu près. La reconfiguration se fait alors avec des mots tirés du vocabulaire du code commun selon la préservation du son la plus proche possible de la phrase de départ.
La phase intermédiaire, l’étape indispensable du code propre, n’est pas visible dans cette opération. On en déduira les correspondances suivantes :
Visibilité : Code commun
Invisibilité : Code propre
Visibilité : Code commun
Quand il jaillit, le code propre échappe à la visibilité. Dans « sa défaillance souveraine et centrale », le code propre est là cette part obscure que Foucault appelle « soleil noir ».
De la censure degré zéro dans la seconde analytique du sexe
En insérant l’explosion phonétique au cœur d’une translittération chez Roussel, Foucault — qui ne parle pas de « translittération » — ouvre une problématique importante pour la fin effective d’une analyse.
Dans l’étape 2 des schémas précédents, on a obtenu ceci :
jaid ; ubont ; abacd ; ans ; mat ; a ; batière,
Chaque « dé de la langue38 » est un élément du code propre. Pour peu qu’on le sépare des autres, on constate qu’il ne se relie à rien. Il est isolé, indéchiffrable. En sortant de l’homophonie qui persiste dans la phrase intercalaire, les dés de la langue deviennent purs de toute dépendance au code commun de la langue. Briser avec cette homophonie est nécessaire car l’homophonie est au service du code commun. Elle le protège des atteintes portées par le code propre. Elle dictera le retour par reconfiguration du code propre au code commun.
Le son sert ainsi d’outil majeur à la censure degré zéro pour effacer l’intercalation de la phrase hors sens intermédiaire. Une fois dégagé de la domination de l’homophonie, voici le résultat qui montre les paquets de lettres émancipés. Ce qui donne en vrac ceci :
Batière
abacd
ans
ubont
mat
jaid
a
Dans le cours d’une analyse, l’émergence en dés du code propre est éphémère. L’emprunt à Roussel selon Foucault montre combien cette émergence est recouverte quasi instantanément par l’étape 3 de la reconfiguration par homophonie. Effacée la phase 2, voici ce que donne la phase 3 devenue 2 que voici :
Jade Tube onde aubade en mat à basse tierce
Les dés épars du code propre sont reconfigurés pour les faire retourner sous la domination du code commun dans une forme rétablie de ce code par la censure degré zéro.
L’effacement de l’émergence du code propre est dû à la censure degré zéro au cours d’une analyse. Elle efface par recouvrement le jaillissement du code propre de sorte que plus rien de cette étape intermédiaire n’apparaît. Après l’action de la censure, ne reste qu’une écriture du code commun qui passe, dans le fragment de Roussel retenu ici, par translittération à une autre écriture du code commun. N’apparaît plus l’intercalation de fragments littéraux purs, indéchiffrables, isolés, en paquets de lettres qui répondent à un code propre.
Tel est l’effet de l’action de la censure degré zéro quand elle entre en jeu au cours d’une analyse. Lorsque surgit en un éclair un élément transgressif de la langue relevant du code propre, la censure agit tout aussitôt pour mettre à sa place un élément régulé du code commun. À la fin, tout se passe comme si l’émergence du code propre n’avait pas eu lieu.
Ceci mène à une proposition portant sur la seconde analytique du sexe, soit sur la fin de l’analyse. La seconde analytique du sexe se démarque de la première en ce que, dans la première, l’émergence du code propre se produit et disparaît comme un éclair, alors que, dans la seconde, elle se maintient. La censure ne fonctionne plus comme ce fut le cas dans la première analytique du sexe où la censure degré zéro l’effaçait quasi immédiatement. La fin de l’analyse correspond au moment où la censure degré zéro ne peut plus effacer le code propre dans son surgissement qui alors est accueilli en tant que « récit impossible et fulgurant », en totalité ou sous formes de traces.
Le code propre peut prendre des formes diverses, bien différentes de celle qui vient d’être présentée. Il n’empêche qu’à chaque fois, il n’aura pas de syntaxe, pas de grammaire, pas de vocabulaire, pas de sens communicable. Si le langage exclu l’est du fait des interdictions venues de la domination du code commun de la langue, alors les paquets de lettres, pris ici un par un, et libérés de la domination du son : Batière ; abacd ; ans ; ubont ; mat ; jaid ; a, relèvent bien de la folie telle que définie par Foucault.
Si chacun de ces dés porte atteinte à la langue en tant que code commun, il la met en danger. Cette mise en danger de la langue commune par l’accueil de la langue propre de la folie (celle qui a ses règles pour elle-même) à la fin de l’analyse, peut engendrer un traumatisme : celui de l’ouverture à un effondrement possible de la langue commune.
S’ouvre alors un horizon : celui des choses telles que Foucault les décrit :
Sans vibrations, menu, discret, obstinément attaché aux choses, tout proches d’elles, fidèle jusqu’à l’obsession, à leur détail, à leurs distances, à leurs couleurs, à leurs imperceptibles accrocs, c’est le discours neutre des objets eux-mêmes, dépouillé de complicité et de tout cousinage affectif, comme absorbé entièrement par l’extérieur39.
Une porte n’est-elle pas en train de s’ouvrir ici sur le discours neutre des objets ?
.