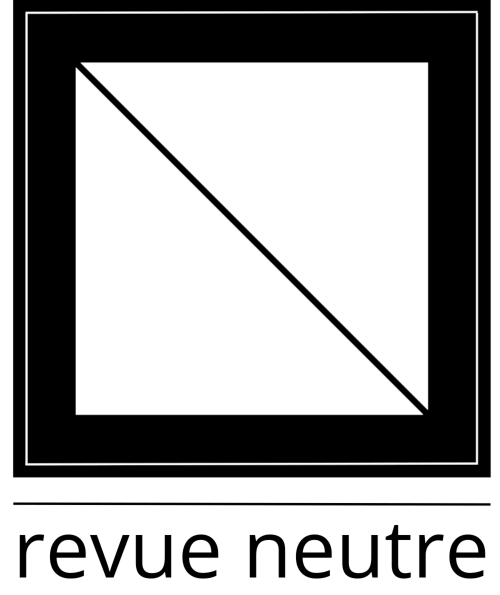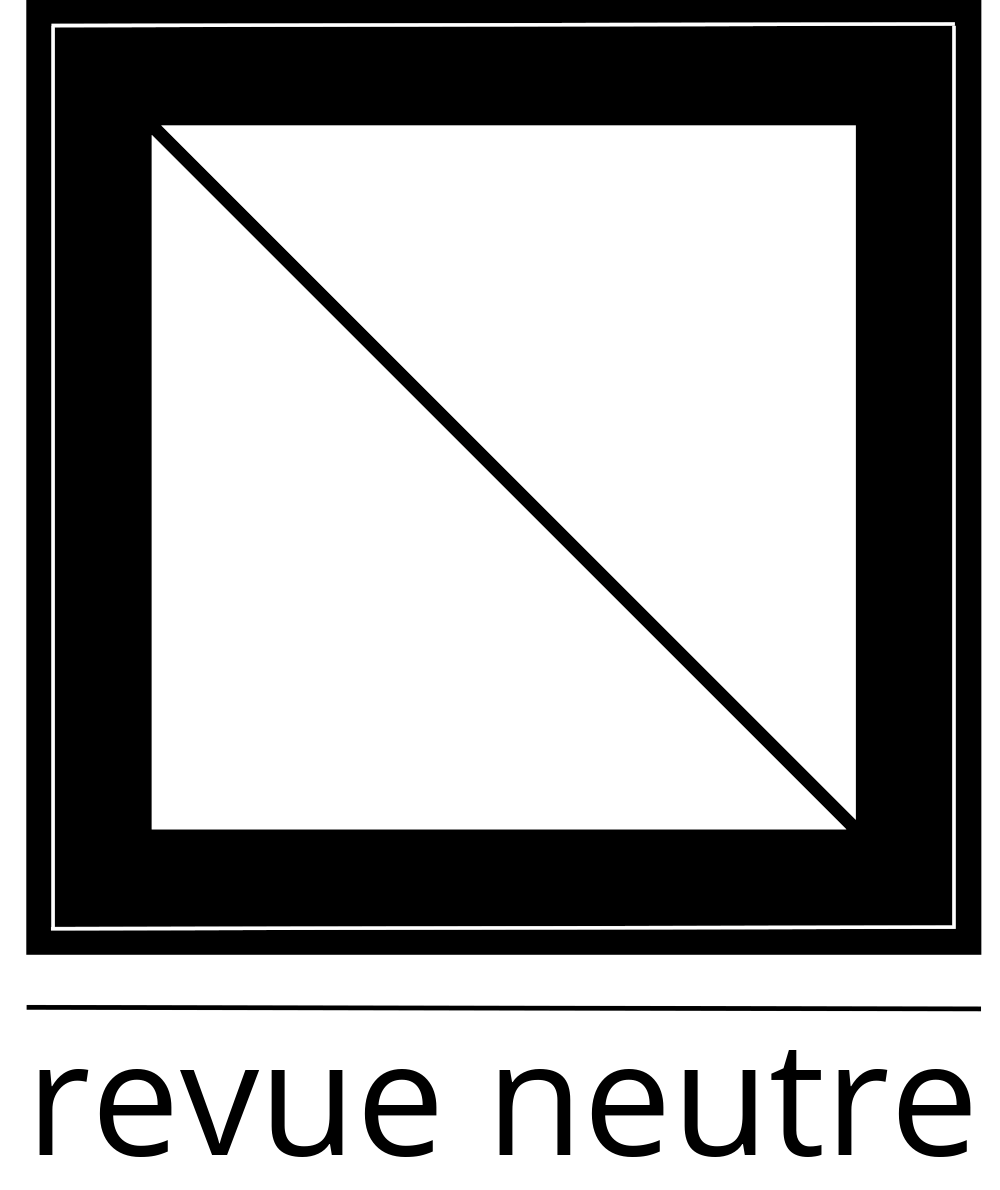TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE
En-quête de l’image en elle-même : L’effet Ménines. Foucault, Lacan, Picasso, Leroy de George-Henri Melenotte
Catherine Franceschi
 Impossible d’engager une lecture au plus près d’un texte s’il n’a pas déjà suscité un sérieux intérêt et aussi de l’enthousiasme. Impossible d’en parler ni d’en écrire quelque chose si ce n’est en l’approchant au plus près de sa lettre… au risque d’un trébuchement, de moments de non compréhension. Mais face à des points d’achoppement, tenter de saisir la ligne de crête du propos et laisser tomber les péripéties de la démonstration.
Impossible d’engager une lecture au plus près d’un texte s’il n’a pas déjà suscité un sérieux intérêt et aussi de l’enthousiasme. Impossible d’en parler ni d’en écrire quelque chose si ce n’est en l’approchant au plus près de sa lettre… au risque d’un trébuchement, de moments de non compréhension. Mais face à des points d’achoppement, tenter de saisir la ligne de crête du propos et laisser tomber les péripéties de la démonstration.
C’est ce qui sera tenté ici après avoir repéré trois moments structurant l’ensemble de cet essai : l’introduction qui conduit vers les questions qui y seront explorées ; les quatre premiers chapitres qui sont autant d’aperçus sur Les Ménines de Vélasquez ; puis un cinquième aperçu qui, changeant de registre, mène vers un point conclusif.
Le titre de l’ouvrage L’effet Ménines. Foucault, Lacan, Picasso, Leroy prévient le lecteur : l’ouvrage porte moins sur le tableau des Ménines que sur l’effet qu’il a pu produire sur quatre auteurs venus de domaines différents : celui de la philosophie avec Foucault, celui de la psychanalyse avec Lacan, puis celui de l’art pictural avec Picasso et Leroy.
Coup d’envoi introductif
Sans rien annoncer de sa visée, le livre1 ouvre sur la page de gauche avec une reproduction d’un tableau de Cézanne Nature morte avec pêches et poires. Sur la page de droite, les premiers mots sont : « Dans cette nature morte, on perçoit… ». Le lecteur qui aura négligé de jeter un œil sur la page de gauche, y est immédiatement invité par le démonstratif de la première ligne « cette ». Ce début de phrase pose d’emblée l’importance qui sera donnée à l’image, au fait de « percevoir » et à un « on » qui perçoit. Le coup d’envoi introductif est lancé. S’y engage une discussion en trois étapes sur l’image à partir d’un mouvement que l’on pourrait appeler de position entre objet, image et représentation jusqu’au point de possibilité d’une image « en tant que telle » aussi opaque qu’elle puisse paraître. Ceci ouvre sur les questions et les choix orientant L’effet Ménines. Foucault, Lacan, Picasso, Leroy.
Première étape : une dépendance de la re-présentation à l’objet naturel
À partir des pêches peintes dans la Nature morte de Cézanne, une distinction est établie entre l’objet pêche, l’image de l’objet pêche et la re-présentation de l’objet pêche, non sans équivoque toutefois.
L’objet pêche renvoie tant à « l’objet naturel », le modèle pour le peintre, qu’à l’objet peint, le résultat de la peinture.
L’image, dans le texte, renvoie à l’image de l’objet naturel pris comme modèle ; elle résulte de la reproduction par imitation de l’objet naturel, ce que les premiers théoriciens de l’art du XVIIe siècle occidental dénigraient sous l’expression « image servile ». Mais c’est encore le terme d’image qui est employé pour parler des images peintes.
La représentation, quant à elle, est le statut attribué à l’image peinte, par le peintre dont la vision déforme, transforme l’objet naturel, s’éloignant ainsi de l’image par imitation. Dans le tableau de Cézanne, l’objet pêche est autre que la pêche naturelle. Re-présentée – présentée à nouveau en peinture – elle change de nature. C’est une nouvelle manière de la présenter.
Dans ces coordonnées, qui sont somme toute celles de la représentation à l’âge classique en Occident construite avec les règles de la perspective géométrique centrale, et au-delà de l’illusion perspectiviste, une opposition est établie entre l’image de l’objet naturel et l’image peinte, autrement dit entre la reproduction de l’objet par imitation et la re-présentation de l’objet selon la vision du peintre.
La discussion se poursuit : la représentation suppose l’écart entre un objet naturel et son image. Dans le tableau de Cézanne, la pêche naturelle n’est plus, elle disparaît ; transformée par la vision du peintre, « elle ne persiste plus qu’en tant qu’image » (p. 6).
Et de conclure : « La peinture est donc un procédé qui sépare l’image de l’objet. Son résultat est l’absence de l’objet par sa disparition en même temps qu’il est réduit à l’image vue par le peintre. » (p. 7).
Mais en jouant ainsi du même vocable d’objet pour désigner l’objet naturel ou l’objet peint, la question du rapport de l’un à l’autre est soulevée. Deux possibilités s’opposent. Celle d’une disparition de l’objet naturel substitué dans la peinture par l’objet peint, marquant la présence d’une absence. Celle, à l’inverse, où l’objet peint magnifie l’objet naturel, comme ce fut le cas pendant le Siècle d’Or de la peinture hollandaise en lien avec le développement florissant du commerce au XVIIe siècle : « la peinture donne à l’objet une puissance de rayonnement, magnifié dans sa splendeur par l’idée de sa détention, source de richesse pour le commerçant » (p. 7). Loin d’être détruit par la peinture, il devient un objet à acheter, à détenir, à posséder.
Cette distinction permet de préciser l’orientation de cet essai : la remise en cause de la survalorisation de l’objet par son image (p. 8). Tandis que la subtile dialectique entre présence et absence soutenue avec les écrits de Louis Marin sera reprise mais autrement dans le dernier chapitre. Dans ce premier mouvement de position entre objet, image, représentation, et quel que soit le devenir de l’objet naturel (survalorisation ou disparition) deux points émergent : la dépendance de la représentation à un objet naturel, et le caractère spécularisable de ce dernier.
Deuxième étape : présentation de l’objet tel qu’en lui-même et image en tant que telle
C’est avec Joseph Beuys et Marcel Duchamp que le changement de registre de l’art du xxe siècle est abordé, en soulignant l’accentuation de l’écart entre l’objet naturel et l’image qui le représente au point de tenter « une approche de l’objet en lui-même ». L’exemple retenu est La Roue de bicyclette de Marcel Duchamp : « sa présentation de l’objet vaut pour l’objet tel qu’en lui-même. » Le préfixe re- [de la représentation] tombe et avec lui la distinction précédente entre image de l’objet par imitation et représentation de l’objet selon la vision du peintre.
Non sans un saut logique, il est alors précisé que ce mouvement « met l’accent sur la différence entre image de l’objet et image en tant que telle. » (p. 8). Glissant du domaine de l’art à celui de la philosophie, l’expression vient d’une citation de Jean-Paul Sartre, qui dans L’imaginaire. Psychologie phénoménologique de l’imagination à propos de l’image de Pierre qu’il produit en lui, écrit : « je pourrai bien donner une description de l’objet [Pierre] tel qu’il m’apparaît en image mais non de l’image en tant que telle ». (p.8)
Voici « l’image en tant que telle », émergée des limbes des profondes transformations de l’art à partir du xxe siècle, dépris de la représentation classique régie par les règles de la perspective géométrique centrale. Cette « image en tant que telle » n’en reste pas moins opaque, mais un commentaire d’une autre citation de Sartre fait valoir un point central pour l’objet de cet ouvrage : « elle n’apparaît que lorsque le regard se détourne de l’objet au lieu de se centrer sur lui […]. Elle se contente de la façon dont elle est donnée. » (p. 9).
Troisième étape : « image en tant que telle » … « image “en elle-même” »
On a déjà remarqué le glissement du domaine de l’art à celui de la philosophie pour introduire le syntagme « image en tant que telle ». Dans le champ analytique, l’interrogation porte sur l’image « en elle-même ». Des questions sont soulevées de l’une à l’autre car c’est en se demandant quelles sont les caractéristiques d’une « image en tant que telle » que l’essai va tenter de « percer le caractère énigmatique de ce que serait une image “en elle-même” à la fin d’une analyse » (p. 9), se saisissant d’un propos énoncé par Jean Allouch dans L’altérité littérale. Suit aussitôt une autre question : « Comment rendre compte de ce qu’elle devient alors et quel statut lui conférer pour venir à bout de l’opacité première d’une image « en tant que telle ? » (p. 9).
L’on ne s’arrêtera pas sur les ambiguïtés introduites par l’adverbe « alors » ni sur l’apparente équivalence entre « image en tant que telle » et « image en elle-même » pour suivre pas à pas le développement de l’auteur.
C’est à partir d’une œuvre picturale du milieu du XVIIe des plus énigmatiques – le tableau de Vélasquez Las Meninas, peint en 1656 –, et de l’étude de deux écrits et de deux expériences picturales la concernant que les questions sur l’image en tant que telle y sont abordées. Puis, les réflexions de Louis Marin sur la représentation et les écrits de Jean Allouch sur l’image « dans ce qu’il dénomme “la seconde analytique du sexe” » (p. 10) permettront de conférer un statut à cette « image en elle-même ». Voici énoncé le projet de cet essai.
Quatre aperçus sur les manières de voir Les Ménines de Vélasquez
Les quatre premiers chapitres présentent et analysent quatre manières de voir Las Meninas susceptibles d’approcher quelques-uns des attributs d’une image en tant que telle. Dans cette note de lecture, seules les conclusions seront présentées, laissant au lecteur le loisir de se reporter au livre pour apprécier les analyses de George-Henri Melenotte des textes et œuvres de Foucault, Lacan, Picasso, Leroy.
Avec Foucault : y voir une configuration ?
L’essai de George-Henri Melenotte aborde le texte de Foucault sur les Ménines, paru dans Les Mots et les Choses en 1966, sous trois angles : tout d’abord une présentation précise du tableau et des personnages ; ensuite « La manière de Foucault » (p. 16) de voir ce tableau ; enfin, la fine pointe de l’analyse de Foucault sur la représentation, qui voit dans ce tableau « “l’essence manifestée” de toute représentation. » (p. 30). Le titre de ce chapitre indique ce qui sera retenu in fine comme élément constitutif d’une image en tant que telle : une configuration.
Une configuration ? l’accent est moins porté sur ce que l’image représente, que sur la structure de l’image composée de points, de lignes, de couleurs, organisée par des lignes de regards qui s’entrecroisent, débordant la surface plane du tableau « en y introduisant le modèle supposé devant le tableau, tout comme le spectateur. » (p. 21). Deux procédés y concourent : « le triangle du regard du peintre » (p. 21) et le miroir dans le fond du tableau qui permet d’accéder à l’espace devant le tableau (p. 25). La manière très étayée de Foucault analysée dans ce chapitre conduit à repérer sur le devant du tableau, un point à l’intersection de deux lignes sagittales qui « est un lieu parfaitement inaccessible » selon Foucault (p. 24), et pourtant bien défini géométriquement :
Ce point du dehors désigne le lieu du spectacle vers lequel convergent les regards du peintre et des personnages et « que l’on retrouve d’abord au fond des prunelles de l’infante » (p. 24).
Le débordement de l’espace du tableau est encore marqué par la présence du miroir qui
forme un point au fond du tableau qui répond au point idéal déjà reconnu à son devant. Au point où se situe le couple royal devant le tableau, répond à l’opposé, dans le miroir, un autre point où se reconnaît le reflet du regard extérieur du couple royal (p. 28).
En supposant un modèle sous le regard pourtant vide du peintre, en supposant le couple royal en lieu et place de ce modèle du fait de leur reflet pourtant irréel voire spectral dans le miroir, en supposant à la même place le spectateur, qui est aussi la place du peintre lorsqu’il a peint le tableau, Foucault déploie une interprétation des Ménines dans les coordonnées de la représentation classique sous la férule des lignes géométriques de la perspective centrale. Redoublées, exacerbées par Vélasquez dans ce tableau en y figurant l’envers d’une toile immense et le peintre lui-même, Foucault s’interroge :
Peut-être y a-t-il, dans ce tableau de Vélasquez, comme la représentation de la représentation classique, et la définition de l’espace qu’elle ouvre2.
Ce jeu des regards, regardant et regardés dans une oscillation troublante des visibilités et des invisibilités, ce tracé des lignes et leurs entrecroisements en des points configurant un volume d’espace au-delà de la surface plate du tableau, cette substitution plus troublante encore des places du couple royal, du peintre, des spectateurs, tout cela interroge ce moment de capture du regard de la représentation à l’âge classique. L’écheveau qui la structure prend le pas sur l’objet représenté, au cœur d’une disparition du sujet lui-même qui fonde la représentation : le roi tout autant que le peintre lui-même, tout autant que tout regard. Foucault conclut son ouvrage Les Mots et les choses par cette phrase, en partie citée dans ce 1er chapitre :
Mais là, dans cette dispersion qu’elle recueille et étale tout ensemble, un vide essentiel est impérieusement indiqué de toutes parts : la disparition nécessaire de ce qui la fonde […]. Ce sujet même – qui est le même– a été élidé. Et libre enfin de ce rapport qui l’enchaînait, la représentation peut se donner comme pure représentation (p. 33).
Accentuant cette réflexion foucaldienne, George-Henri Melenotte ajoute que la représentation alors « devient libre de ce qui la corsetait jusque-là : libre de son fondateur, de son producteur, de son créateur. Elle devient pure représentation. » (p. 34).
Pure représentation ? l’expression peut-elle être rapprochée de « image en tant que telle » ? À cette « absence de sujet qui la fonde » répond « la configuration comme structure nécessaire à la représentation » (p. 34). L’espace prend le dessus sur le temps, ce qui est « une rupture de grande portée » souligne George-Henri Melenotte (p. 35), avant de conclure ainsi ce chapitre :
Avec Les Ménines, Foucault offre à l’image une configuration propre. Elle est faite d’une série de rapports entre les regards qui fabriquent son espace. Cet espace est un espace d’orientation et d’attraction du regard du spectateur vers son cœur qui est le miroir. […]. La fonction de la représentation s’émancipe, à ce moment de l’âge classique, de la tutelle de son sujet fondateur, le roi, pour devenir représentation pure (p. 35-36).
Mais que l’image soit « effet de la configuration des rapports spatiaux des points regards » l’extrait-elle du champ scopique ? Que la visée de cette configuration soit « l’attraction du regard du spectateur » (p. 36) semble dire que non.
Avec Lacan : une image du fantasme ?
Comme ceci est rappelé dès le début du chapitre, à peine quatre semaines se sont écoulées depuis la sortie du livre Les Mots et les choses de Foucault que déjà Lacan propose une autre lecture du tableau des Ménines de Vélasquez, au cours de cinq séances de son séminaire L’Objet de la psychanalyse, du 4 mai au 1er juin 1966.
Le lecteur est d’emblée averti que ce que Lacan fait du tableau des Ménines éclairera peu l’image en tant que telle. Pourquoi ? car « Lacan voit le tableau comme image du fantasme » (p. 37) et le lit à partir de son écriture [S barré poinçon a]. L’on comprend alors qu’une condition essentielle à une image « en tant que telle » est qu’elle soit sans objet. Ceci est incompatible avec la participation de l’objet a dans la formule du fantasme. L’on pourrait s’en tenir là tout en interrogeant le rapprochement sous-jacent proposé entre l’objet spéculaire de la représentation et l’objet a non spécularisable, et passer directement aux apports de Picasso et d’Eugène Leroy. Mais ce serait se priver d’un point essentiel pourtant à ce que devient l’image en fin d’analyse, objet principal de cet essai.
Ce deuxième chapitre commence par présenter les points de désaccord de Lacan à propos de la lecture foucaldienne des Ménines. Ils sont au nombre de trois :
- « La référence unitaire du sujet » propre aux « théoriciens de la philosophie » (p. 38) ;
- Le fait que le peintre dans le tableau peigne le roi et la reine situés au-devant du tableau, alors que pour Lacan c’est le tableau que l’on a sous les yeux que le peintre peint sur la toile renversée ;
- Le fait qu’il y ait intervision et croisement des regards alors qu’« il est manifeste qu’aucun ne se rencontre » et que les personnages « ne savent point où placer ces regards. » (p. 44).
Ces trois points sont analysés séparément au fil de leur énonciation, ce qui met en évidence le traitement de ce tableau par Lacan et la fonction de représentant de la représentation (Vorstellungrepräsentanz) attribuée à la toile retournée.
Mais, considérés simultanément, ces trois points relèvent de la structure perspectiviste de l’espace du tableau exacerbée par la présence du peintre lui-même et de la toile inversée. Elle est mise en évidence par Foucault, avec le trait unifié du sujet, tout élidé qu’il puisse être. Or, cette année-là le séminaire de Lacan vise à une élucidation du sujet de la psychanalyse dont la division entre savoir et vérité accompagnée du modèle topologique qu’est la bande de Moebius a déjà été posée l’année précédente3. Dans la séance du 4 mai, pour se départir de ce « sujet pur, ce sujet dont les théoriciens de la philosophie ont poussé jusqu’à l’extrême la référence unitaire4 », Lacan concentre ce séminaire à l’exploration de « la structure visuelle de ce sujet ». Cette quête, pour laquelle le tableau de Vélasquez est sollicité mais pas seulement, aboutit à une structure topologique permettant de situer et la division du sujet et l’objet a regard et les rapports de l’objet a avec le S barré, soit l’écriture du fantasme. George-Henri Melenotte apporte les éléments de la démonstration. On peut le suivre jusque dans ses conclusions qui lui font dire que les analyses de Lacan n’apportent rien à la caractérisation de « l’image en tant que telle ». Mais on peut interroger les expressions de « structure visuelle du fantasme » et « image du fantasme » employées pour qualifier L’effet Ménines chez Lacan5. En effet, elles n’apparaissent pas dans les séances du séminaire du 4 mai au 1er juin 1966. « Structure » y est très fréquemment employé : « structure visuelle du sujet », « structure visuelle de ce monde topologique, celui sur lequel se fonde toute instauration du sujet », « structure du sujet scopique », et aussi « structure du fantasme » par exemple dans la séance du 4 mai. Et réduisant le tableau à des plans, lignes et points avec les coordonnées de la géométrie projective, on peut lire :
que quelque chose se produit dans la construction visuelle qui n’est autre que ce qui nous donne la base et support du fantasme, à savoir une perte qui n’est autre que celle que j’appelle la perte de l’objet (a) et qui n’est autre que le regard et, d’autre part, une division du sujet6.
Fantasme (perte de l’objet (a) regard) et division du sujet est ce quelque chose qui se produit dans la construction visuelle. De là à parler de « structure visuelle du fantasme » ?
Le 18 mai, Lacan est plus explicite encore :
Mais ce qui trouble, c’est que chaque fois qu’on parle du fantasme inconscient, on parle aussi implicitement du fantasme de le voir. C’est-à-dire que l’espoir du fait qu’on court après, introduit beaucoup de confusion7.
Il semble d’autant plus difficile de parler de « structure visuelle du fantasme » que pour Lacan il « repose sur un bâti » :
Mais pour l’instant j’essaie de vous donner à proprement parler un bâti. Et un bâti ce n’est pas une métaphore, parce que le fantasme inconscient repose sur un bâti8.
L’expression « image du fantasme » est tout aussi absente des séances où Lacan analyse le tableau de Vélasquez. Viendrait-elle du « champ scopique » de la dernière citation de Lacan bouclant ce deuxième chapitre, par contamination sémantique de l’image par le scopique ?
Je veux dire que j’y ai poussé aussi loin que possible la rigueur avec laquelle peut s’énoncer, dans ce cas du champ scopique9, comment se compose le fantasme, enfin qu’il est pour nous le représentant de toute représentation possible du sujet (p. 55).
De la lecture des séances du séminaire L’Objet de la psychanalyse où Lacan déchiffre le tableau des Ménines, rien ne peut être retenu, pour George-Henri Melenotte, en ce qui concerne « les éléments de l’image en elle-même telle qu’on la trouve en fin d’analyse » (p. 56), celle « dans la seconde analytique lorsqu’elle est débarrassée de l’objet » (p. 56). À ce stade de cet essai, seuls les apports de Foucault comptent :
Par son insistance sur les rapports entre les points regards, il met en valeur l’espace structuré d’une image libre de toute dépendance à un ordre symbolique sous-jacent (p. 56).
Et pourtant… dès lors que la question de l’image en elle-même est posée de l’intérieur du champ analytique tel qu’élaboré par Lacan, peut-on sans conséquence mettre de côté la structure topologique du sujet divisé dépliée dans ces cinq séances de L’Objet de la psychanalyse ? Celle qui permet de se départir des apories du sujet de la science depuis Descartes, sujet sur lequel agit ou opère la psychanalyse comme le répète Lacan au fil de ses séminaires.
Avec les peintres Picasso et Leroy : se déprendre de la représentation ?
L’en-quête des éléments de l’image en tant que telle se poursuit dans le domaine de l’art avec un grand maître de la peinture qu’est Picasso capturé qu’il a été par les Ménines, puis avec Eugène Leroy soucieux de traiter la peinture par la peinture. Peintres du xxe siècle, l’un et l’autre se distancient explicitement du registre de la représentation.
Picasso qui ne put pendant presque quatre mois que peindre une série de 58 études des Ménines raconte après sa visite au Prado son état de sidération à la rencontre du tableau de Vélasquez, Las Méninas :
Elles m’attendaient au musée du Prado. Depuis lors est resté comme marqué au fer rouge sur ma rétine, de façon obsessionnelle, le tableau des Ménines. Je crois que c’est alors, bien que de façon subconsciente, que l’idée a germé de produire ma propre version des Ménines (p. 59).
L’analyse, par George-Henri Melenotte, de la série des 58 tableaux étayée de propos de Picasso lui-même, puis celle de la première partie du « Dactylogramme » que Foucault a écrit sur les variations de Picasso, soulignent le mouvement d’émancipation de la peinture par rapport à la représentation classique de l’époque de Vélasquez. Face ou pour faire face à une incrustation rétinienne obsédante des Ménines, Picasso « cherche une issue à la captation dont il est objet » (p. 59). C’est dans la peinture et par la peinture elle-même dans un « acte de libération de l’emprise du maître » qu’il la trouve (p. 59-60). George-Henri Melenotte précise : « la série des images qu’il peint devient une chronique de sa libération de l’empreinte rétinienne infligée à ses yeux par l’image du maître. » (p. 61). Loin de copier le maître et « à partir de l’original, Picasso témoigne, par sa peinture, de son propre rapport à la peinture. » (p. 62). « Il ne copie pas, mais s’oriente résolument vers les détails qui structurent l’œuvre. » (p. 62). « Il a déjà inventé un nouveau langage pictural qui lui permet de développer une analyse critique du langage pictural de Vélasquez » (p. 62-63) aussi « L’image première se volatilise en une série de variations secondes. Elle perd son prestige et lui permet de s’attaquer à la source du problème : le peintre. » (p. 63).
La sélection de ces quelques phrases extraites du 3e chapitre donne la mesure du travail entrepris par Picasso : de la puissance d’une empreinte rétinienne produite par le tableau de Vélasquez à un acte de libération de l’emprise du maître par la peinture qui devient acte de création subversive de la peinture par la peinture jusqu’à s’interroger sur le peintre lui-même. La description de la succession des tableaux dans les pages qui suivent fait apparaître le point où Picasso « casse les figures qui ne représentent plus rien en donnant le primat à la lumière et à ses effets d’irisation » (p. 66). Alors « La peinture prend le pas sur sa fonction de représentation. » (p. 66). En cherchant ainsi « jusqu’au secret de son art » que découvre-t-il ? « la toute-puissance de la mort qui le condamne à l’exil dans la peinture. » Comme le suggère la variation 32 où « à la place de Vélasquez qui avait peint son autoportrait dans son tableau, il met le cercueil du peintre comme passage nécessaire. » (p. 70).
Au regard de la visée de cet essai :
Picasso met en lumière l’image libre dans ses variations contre l’image aliénante peinte par Vélasquez […] Il répond à la tutelle imposée par la tradition par la production d’une diversité qui explore les possibilités offertes par sa peinture (p. 70).
Une image libre, libre de quoi ? De la tutelle aliénante de la tradition dont la construction perspectiviste de la surface du tableau fait partie ; mais plus encore, une image libre de l’objet supposé dans toute représentation :
Chacun est pris dans une distorsion de sa représentation qui en fait une figure que seule la peinture libre peut autoriser.
Le vocabulaire employé dans le texte se déplace alors de celui de représentation à ceux d’image ou de figure. Et de conclure :
Picasso rend possible un pas de plus vers l’image en elle-même. Contre le poids de la tradition picturale incarnée par Vélasquez, il fabrique les images d’un soulèvement démultiplié (p. 71).
Qu’apporte la série des Ménines à l’image en elle-même ? Liberté et soulèvement, deux termes caractérisant la seconde analytique du sexe selon Jean Allouch.
Eugène Leroy, présenté par George-Henri Melenotte, offre une autre manière de traiter la peinture par la peinture « en partant à la “recherche de la matérialité” » (p. 71). C’est une manière pour lui « d’aller contre la représentation » (p. 73), de « dépouiller complètement l’image de la signification visuelle » (p. 74). « Quand il peint, Leroy déplace le regard vers la puissance de la pâte. » (p. 76). « S’extraire du primat de la représentation revient à aller contre la fonction séculaire de l’image. » Aussi, « par un renversement violent, il invente une forme picturale qui, en visant la déprise de la représentation, privilégie l’outil devenu croûte séchée de plusieurs épaisseurs de couleurs. » (p. 76).
Eugène Leroy écrit : « La peinture existe en soi, et non dans l’image même aussi archipicturale qu’elle puisse être. » (p. 76).
Il privilégie le geste pictural : « les gestes n’étaient jamais des motifs mais la surprise du moment dans mon environnement » (p. 76). « Il dote les gestes d’une grande liberté » (p. 76).
Mais alors que fait-il en peignant les Ménines ?
Cette fois, il n’agit plus comme le fit Picasso avec ses variations. Il destitue la représentation pour chercher, au-delà de la figure, la peinture (p. 78).
À quoi cela sert-il ?
À présenter le tableau comme une scène peuplée de chimères, comme le lieu du désenchantement de la figure dû à son caractère trompeur, comme endroit où l’illusion se lève pour ne laisser apparaître que la matière dont elle est faite (p. 80).
Ces mots très forts se prolongent vers ce qui pourrait être attribué à l’image en elle-même :
C’est le lieu de la disparition de la magie de l’image quand elle ne captive plus (p. 80).
Citant alors Leroy lui-même :
Tout ce que j’ai essayé en peinture c’est d’arriver […] à une espèce d’absence presque, pour que la peinture soit totalement elle-même (p. 80).
« Que la peinture soit totalement elle-même », cela a-t-il à faire avec « l’image en elle-même » ? Sans doute est-ce le fait d’essayer d’arriver « à une espèce d’absence presque » qui fait écrire à George-Henri Melenotte que « ce passage ouvre l’accès à l’image telle qu’on la trouve en fin d’analyse » (p. 80). Aussitôt suivi par : « L’effort du peintre vise à retourner à l’“essence” de la peinture. » (p. 80). Kandinsky, qui a écrit Du spirituel dans l’art et de la peinture en particulier, est alors sollicité pour introduire précisément l’élévation d’un tableau au rang de sujet spirituel : « La peinture en acte devient un acte spirituel » (p. 81). Celle d’Eugène Leroy est placée sous cet auspice : « en privilégiant la matière qu’il donne abondamment, il élève la peinture au rang de sujet spirituel » (p. 81).
Par contiguïté, l’on glisse dans le champ analytique :
Si l’exercice analytique, parvenu à sa fin, donne accès à une image dépouillée de l’objet a, on pourra modifier la formule de Kandinsky pour lui conférer son nouveau statut (p. 82).
Comment ? en remplaçant l’expression « sujet spirituel » par celui d’« érotique spirituelle ».
Le lecteur lira la finesse de ce développement qui circulant du champ de l’art à celui analytique permet d’énoncer ceci à propos de l’image en elle-même :
le lieu que l’image donne à voir est bien celui, spirituel, d’une absence (p. 82).
Au terme de cette exploration de L’effet Ménines pour Foucault, Lacan, Picasso et Leroy, « l’image en elle-même » apparaît hors du champ de la représentation et de l’objet dont cette dernière dépend. Sans objet, elle ne captive plus ; elle donne à voir un lieu, le lieu de l’absence de l’objet ; lieu spirituel du fait de cette absence.
Sans objet, elle se laisse approcher par quelques termes : configuration, image libre, soulèvement, lieu, absence, spirituel.
Elle pourrait commencer à être décrite par : une configuration spatiale ; une fonction libératrice ou désaliénante ; vers un horizon spirituel…
Le 5e aperçu du tableau de Vélasquez, précédé d’une analyse de la portraiture selon Louis Marin achemine vers la conclusion de cet essai. On y retrouve la réflexion autour de la présence de l’absence annoncée dès l’introduction.
L’image en elle-même dans la seconde analytique du sexe : quel statut ?
Dès les premières lignes de ce chapitre, la réponse à la question du statut à conférer à l’image en elle-même dans la seconde analytique du sexe est donnée : celui de neutre.
Pour explorer « l’image quand elle est neutre », deux images sont commentées : la gravure de Dürer Le Chevalier, la Mort et le Diable analysée par Louis Marin avec la notion de « portraiture », et à nouveau le tableau des Ménines mais « revisité et modifié selon les critères produits par Marin et ceux avancés par Allouch. » (p. 85).
Avant cela, une citation de Maurice Blanchot extraite de L’Entretien infini donne le la du neutre :
Le neutre est ce qui ne se distribue en aucun genre : le non-général, le non-générique comme le non-particulier. […] cela veut dire qu’il suppose une relation autre, ne relevant ni des conditions objectives, ni des dispositions subjectives (p. 86).
Appliquée à l’image, cette formulation de Blanchot, écrit George-Henri Melenotte,
me permet de subvertir la vision spontanée que l’on a de l’image – une représentation – au profit de sa localisation dans un autre lieu. Le neutre, tel qu’il le décrit, localise ce lieu dans un ailleurs (p. 86).
Puis, poussant le raisonnement jusqu’à ses conséquences :
Si l’on accepte l’indétermination quant à ce lieu, l’image de ce lieu acquiert un statut particulier : celui d’un refus où sa réception classique conduisait à la détermination d’un objet représenté aussi bien que celle d’un sujet regardant (p. 86).
Blanchot va plus loin :
Le neutre ne séduit pas, n’attire pas : c’est là le vertige de son attrait dont rien ne préserve.
S’ensuit un commentaire où, à suivre Blanchot,
l’image ne fixerait pas le regard. Elle ne chercherait pas à le piéger. Elle fonctionnerait par elle-même et en elle-même, sans saisie du moindre objet qui bâtirait sa représentation. Que peut-elle alors piéger ? L’attrait de sa structure vide émerge et tient à la puissance érogène de ce vide. Dans la double négation du ni…ni… réside la puissance dynamique du neutre (p. 87).
Le la – le la du là ? – est donné en éloignant discrètement quelques idées lacaniennes via l’usage des deux termes « piéger » et « bâtir » : le tableau comme piège à regard et le fait que « le fantasme repose sur un bâti » (cf. ci-dessus).
Louis Marin s’intéresse aussi au neutre et rappelle le caractère intransitif des « verbes neutres » comme « marcher » ou « mourir ». Ce qui fait dire à George-Henri Melenotte : « De cette intransitivité, se déduit que le neutre est “l’expression d’une action pure” ».
Vers où cela oriente-t-il l’analyse de la gravure de Dürer, selon Marin ?
Le Chevalier, le Diable, la Mort ou formes figurées de l’irreprésentable
Il est difficile de trouver une image plus saturée que cette gravure où s’entremêlent des membres, des visages, des figures, des symboles dans un lieu chaotique. Mais…
Bien que la gravure soit réalisée à l’aube de la représentation classique régie par les règles de la perspective géométrique centrale, Louis Marin écarte la possibilité pour cette image de représenter un modèle que le peintre aurait sous les yeux tout comme celle qui assurerait la présence en chair et en os des personnages. Pourquoi ? parce que la Mort, le Diable n’ont pas de visage, pas d’image. Ce sont des irreprésentables. Dès lors : comment figurer ce qui n’a pas de figure ? En lui inventant un figuré. C’est ce que fait Dürer, selon Marin qui analyse l’image avec la notion de « portraiture ». La gravure de Dürer devient alors l’image présentant les figurés de ce qui n’a pas de figure ; ces personnages sont des figures figurées de l’irreprésentable. Quel est le statut de cette image ? « Ce n’est pas un complément d’objet de l’image, mais la “réflexion” de la figure sur elle-même » écrit Marin (p. 92), ce qui suscite un commentaire plus explicite :
C’est une image intransitive, sans complément d’objet, libérée de la transitivité que suppose la grammaire, c’est-à-dire de toute référence, de tout modèle, de tout objet, de toute écriture dont elle serait la mise en image. Pour le dire ainsi, cette image est à elle-même sa propre référence. Elle se réfléchit sur elle-même du fait de son intransitivité (p. 92).
Ce propos, radical dès lors qu’il y aurait « réflexion » de l’image sur elle-même, se prolonge dans deux directions :
- L’une où « les personnages que l’on voit [dans la gravure de Dürer] servent de prétexte à l’acte de (dé)peindre, à quoi se résume la portraiture. […]. Si les figures dépouillées sont autant de figures de l’irreprésentable, leur mise en portrait déplace l’attention sur la confection de l’image » (p. 93).
- L’autre où « la représentation ne se laisse pas évacuer aussi facilement » (p. 93).
Pour éviter l’impasse, Louis Marin propose que l’espace de la gravure soit celui d’un espace tiers, situé entre image et représentation (p. 93). « C’est là, selon George-Henri Melenotte, la thèse qui fait la force de son analyse » (p. 93).
C’est ce qui permet tout à la fois de « situer l’image dans un ailleurs », et de qualifier cet ailleurs de neutre :
Ainsi dépouillée de son objet et figurant l’acte de sa figuration qui fait image, l’image neutre se donne comme image qui ne renvoie plus qu’à elle-même. Dépouillée de son objet l’image devient image fantôme du lieu de l’absence de cet objet (p. 94).
D’une telle « image fantôme du lieu de l’absence de cet objet », George-Henri Melenotte engage le lecteur à faire une expérience de l’esprit avec le tableau de Vélasquez
qui va obliger à se défaire de l’image originale et à laisser de côté la peinture pour en arriver à l’image telle qu’elle apparaît en fin d’analyse (p. 94).
C’est l’expérience de « l’atelier sans personnages ». En montrant, par un raisonnement soutenu, que les personnages dans le tableau de Vélasquez, désormais morts mais à jamais là en représentation selon Lacan, « sont des fantômes, des images spectrales » (p. 96), George-Henri Melenotte peut écrire que le tableau est
l’image d’un lieu qui ne serait plus occupé que par des ombres. Ce serait le lieu de l’inexistence de ceux qui y auront paru et l’auront délaissé dans la mort (p. 101).
Plus encore, dans des coordonnées développées par Marin à propos de la gravure de Dürer, les personnages « ne sont que les figurés des figures sans représentation possible » (p. 102). Dès lors, « Dans son entier, le tableau est marqué par l’intransitivité de son image qui n’a plus d’objet. » (p. 102). C’est une image neutre. Il devient possible, sans effroi, de vider le tableau de ces figurés des figures sans représentation pour ne laisser que l’image de la pièce vide, lieu de l’absence de l’objet. Cette « expérience de l’esprit » peut être rapprochée de celle de Leroy : « Ses Ménines donnent à voir une image qui ouvre la porte à l’élévation de l’esprit. » (p. 102).
Retour au champ analytique
Ce qu’est une image lorsqu’elle est neutre a pu être approché depuis le champ de l’art, tant du point de vue de l’expérience picturale elle-même que du point de vue de la philosophie de l’art. De même quelques éléments constitutifs d’une « image en elle-même ». C’est le moment de boucler ce parcours avec un retour dans le champ analytique, celui d’où a émergé un regain d’intérêt pour l’image lancé par la mise en évidence par Jean Allouch de deux analytiques du sexe : la première analytique du sexe, celle du lien et qui suppose l’objet a ; une seconde analytique du sexe, celle du lieu, dite encore célibataire aussi appelée « l’analytique du rapport10 ». Dans la première analytique du sexe, rappelle George-Henri Melenotte citant Jean Allouch11 :
C’est de petit a derrière l’image [mathème i(a)], pensait-on, que celle-ci tenait sa prégnance et ses effets – et non pas de l’image en elle-même (p. 104).
Dans la seconde analytique du sexe, du fait de « l’absence » de l’objet a selon le terme employé dans ce passage de L’effet Ménines (p. 104), Allouch constate le changement de statut de l’image. Au terme d’« absence », on préfèrera celui d’« effacement » ou celui de « disparition » qui indiquent un mouvement, celui du passage de la première à la seconde analytique du sexe, en fin d’analyse.
Ce mouvement a de multiples conséquences explorées dans les écrits de Jean Allouch et en partie évoquées dans cet essai :
Elle [l’image] tire d’elle désormais sa puissance érogène et sa prégnance. Dans le « en elle-même », le en fonctionne comme un locatif qui remplace un complément circonstanciel de lieu. L’image en elle-même vient d’un lieu qui serait le sien (p. 104).
Loin d’échapper à tout érotisme,
elle est porteuse d’une Autre érotique qui, dans la seconde analytique du sexe est spirituelle (p. 104).
Les éléments mis évidence dans les chapitres précédents et en particulier avec deux peintres du xxe siècle glissent par analogie vers le champ analytique :
L’acte même de peindre est repéré dans le mouvement de la peinture. Peindre prend une acception nouvelle. La peinture advient en s’émancipant de son modèle. Tel est le cas de l’objet dans la seconde analytique du sexe (p. 107).
Et plus encore :
C’est en se détachant de l’objet que l’analyse devient possible et peut-être même jusqu’à son terme. L’image liée au départ à l’objet a se déprend de ce lien pour devenir à son tour une image célibataire. Dire de cette image qu’elle est en elle-même indique ce célibat de l’objet (p. 108).
Est-ce de ce fait que la seconde analytique du sexe est aussi dite célibataire ? sans doute y a-t-il d’autres éléments.
S’agissant de conférer un statut à cette image, on retrouve en fin de partie les caractéristiques de l’image neutre déployées avec Blanchot et Marin :
Elle n’est plus que l’image d’un lieu abandonné par cet objet. Intransitive, sans rien à représenter, elle n’a qu’elle-même comme référent. C’est à partir de ce constat qu’on la dira neutre (p. 108).
L’ouvrage a ouvert sur La nature morte avec pêches et poires de Paul Cézanne peinte à la fin du xixe siècle. Il se termine par une image du tableau de Vélasquez, celle du lieu vidé de ses personnages : Las Meninas. Una indumentaria familiar, de José Maria Bullon de Diego visible au musée du Prado.
D’avoir approché cet essai pas à pas permet d’appréhender la concision de la conclusion qui reprend les points les plus saillants du propos et ses prolongements à partir des développements dans les écrits de Jean Allouch relatifs à la seconde analytique du sexe. Quelques-uns sont évoqués : le fantasme en tant que scène et non plus en tant qu’image (p. 105) ; l’importance donnée au lieu en transformant « Wo Es war soll Ich werden » de Freud en « Wo Ich war soll Es werden » (p. 115). Cela conduit aux portes du neutre et à sa vitalité, objet de l’ouvrage posthume de Jean Allouch12 :
Le neutre fait preuve d’une grande vitalité. Il oblige à revisiter l’appareil analytique tel qu’on le trouve dans la première analytique du sexe (objet, image, signe) et à y introduire de nouvelles thématiques (liberté, volonté, soulèvement) (p. 115).
Avec L’effet Ménines. Foucault, Lacan, Picasso, Leroy – et l’on pourrait ajouter Marin, Allouch – pour parvenir à lire la dernière phrase, cela suppose d’avoir accepté de suivre l’auteur au cœur du kaléidoscope parfois vertigineux qu’il emprunte pour répondre à sa question :
Aussi c’est là (Wo), à la fin d’une analyse, que l’image adopte un nouveau statut qui la fait image neutre dont les figures spectrales ne sont rien que des figures du vide du lieu de l’Autre inexistant (p. 116).
Ce petit livre de 116 pages qui semble se lire sans effort devient si l’on y prête un peu attention un formidable outil de travail pour appréhender les effets et les conséquences de l’espace autre ouvert par la lecture serrée que Jean Allouch a conduite sans relâche des séminaires et écrits de Lacan. Cela soulève bien des questions dont celle-ci : l’objet a effacé, disparu dans la deuxième analytique du sexe, que devient la structure du sujet divisé introduite par Lacan pour faire un pas de côté par rapport au cogito cartésien et au sujet de la science que cela instaure, sujet sur lequel opère la psychanalyse ? Se retrouve-t-il unifié et à nouveau pris dans les rets des apories de la science moderne ? disparaît-il ? lui substitue-t-on une érotique comme le suggère la modification du « sujet spirituel » de Kandinsky en « érotique spirituelle » ?
.