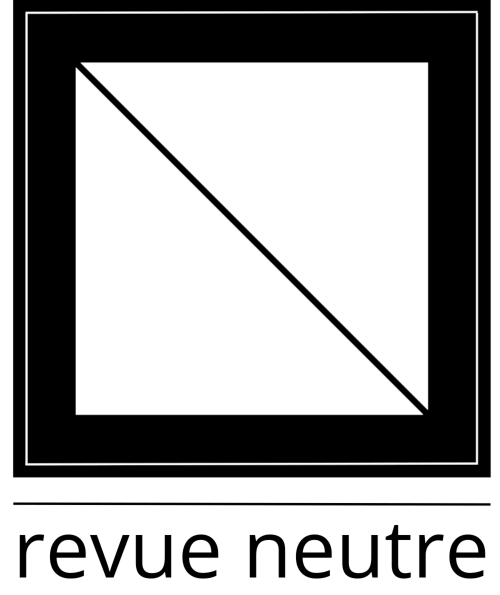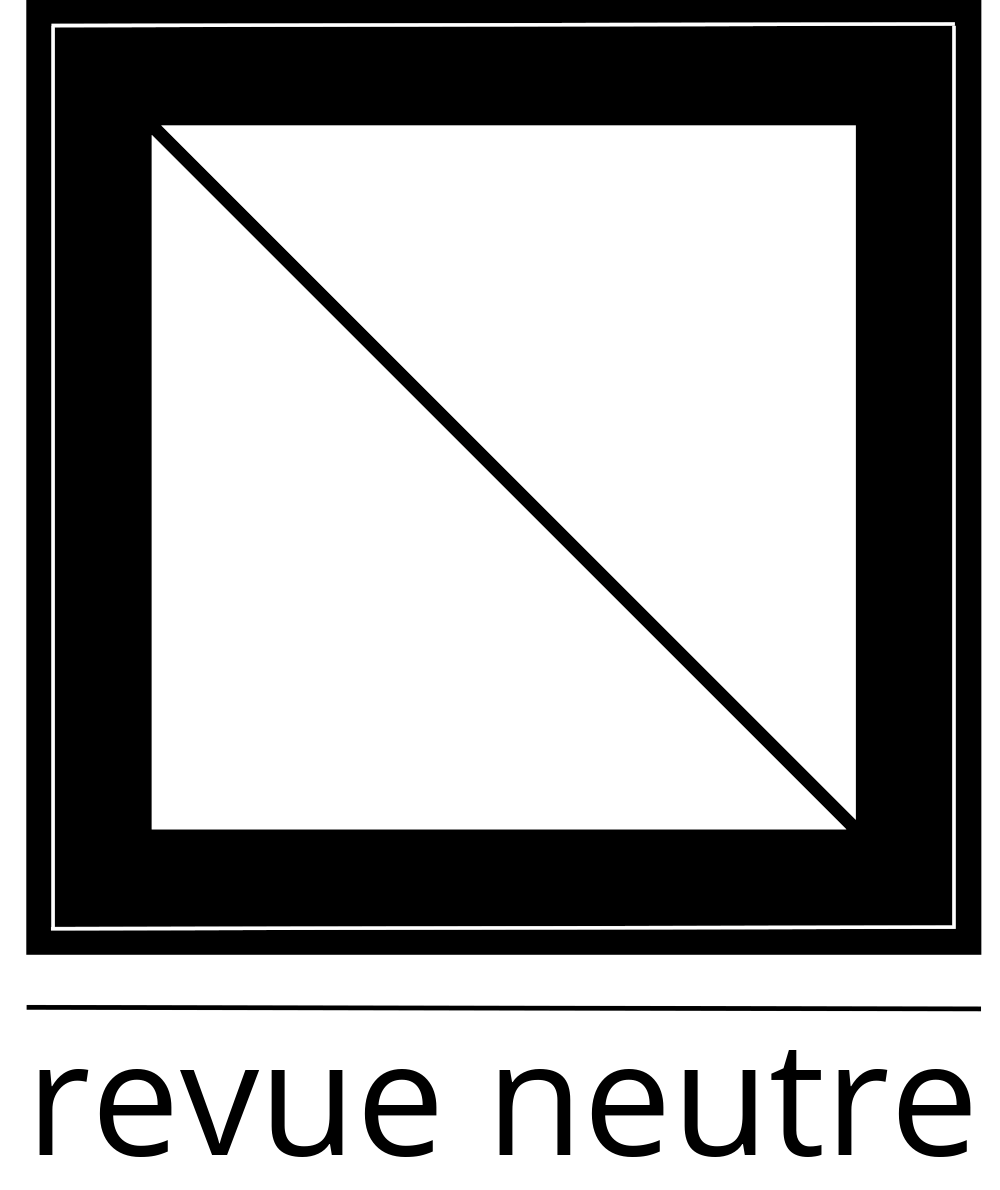Préface
Le domaine des âmes vives (Ville-Evrard, été 2022)
Philippe Bertin
C’est un domaine où des âmes errantes surgissent au hasard des allées du grand parc, accablé par la sécheresse. Des fantômes modelés sous mes doigts dont les effets pour certains sont restés à la consigne sous la forme d’un baluchon muséifié. Des apparitions pétries d’élégance et parées de couleurs chatoyantes. Sublimation parée des rayons du soleil. Une manière peut-être de conjurer le silence et la réclusion, en s’affranchissant des barreaux, des serrures et des murs d’enceinte. Ou juste une illusion d’optique qui permettrait de ressusciter les aliénés d’autrefois, sous forme de silhouettes asexuées, déambulant dans les galeries et les préaux à la recherche d’un peu d’ombre ou de présence.
C’est un domaine soumis au vent et aux rêveries où le souvenir s’incarne en douceur dans des corps de papier crépon. Des sculptures éphémères dont le savant déséquilibre et la fluidité rappellent en creux le renoncement de Camille Claudel, dont l’internement à Ville-Evrard en 1913, à la demande de sa famille, sonne le glas de son geste créateur.
______________________________________________________________________
Camille Claudel est décédée, il y aura bientôt 80 ans, le 19 octobre 1943 à Montdevergues (Montfavet) dans le Vaucluse. Aujourd’hui perçue comme l’héroïne dramatique d’une histoire emblématique de la condition féminine au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, elle est surtout une artiste de premier rang, qui apporte à l’histoire de la sculpture moderne un regard d’une grande singularité, ouvrant des ponts entre le naturalisme et le symbolisme, le néoflorentinisme et l’Art nouveau, entre une inspiration fortement autobiographique et un langage d’une sensibilité universelle.























Postface
Danielle Arnoux
Le 10 mars 1913, Camille Claudel est conduite sous escorte musclée à la Maison de Santé de Ville-Évrard, Paul Claudel note alors dans son Journal : « Les folles à Ville-Évrard. La vieille gâteuse. Celle qui jasait continuellement en anglais d’une voix douce comme un pauvre sansonnet malade. Celles qui errent sans rien dire. Assise dans le corridor la tête dans la main. Affreuse tristesse de ces âmes en peine et de ces esprits déchus. »
Septembre 1914, Camille Claudel est transférée à l’asile de Montfavet où elle passera le restant de ses jours, elle y décède le 19 octobre 1943.
En 1927, dans le Journal du frère : Ma vieille sœur Camille à Montdevergues avec son triste chapeau de paille perché sur son crâne et sa robe de toile jaune.
Ces brèves notations, presque des haïkus, auraient pu inspirer l’installation qui a précédé les prises de vue de Philippe Bertin à Ville-Évrard. Des silhouettes fragiles, diversement colorées, sculptées dans du papier crépon, habitent un décor désaffecté dans lequel elles sont posées, un lieu non-lieu, déserté de tout autre occupant. La portée de ces photographies excède toute représentation. Leur étrangeté provoque, dérange, questionne.
Ces apparitions à la fois intenses et inconsistantes seraient, elles-mêmes, vidées de leur contenu. S’agit-il de dépouilles ? Un corps s’est-il un jour logé dans ces formes vagues ? Les êtres que le poète qualifiait d’âmes en peine et d’esprits déchus seraient-ils, ici maintenant, devenus fantômes ? Des fantômes de folles, de fous ? Chacun hante, dans une posture adaptée et suggestive, le paysage qui lui a donné asile. Alors s’évoque l’empreinte d’un Quelconque, être à la fois disparu et présent, assis, debout, en marche, arc-bouté. Quelqu’une aurait erré, fait le guet, aurait chu, se serait recroquevillée, quelqu’un aurait dressé l’oreille… Car le violet, le fuchsia, l’écarlate, le pourpre, l’ocre, le vert, le jaune, le noir même, le bleu crient. Ça hurle ! Et si écho il y a, il se répercute en silence sur des portes closes, vitrées, vitreuses, délavées, marquées par l’usure du temps, des portes entrouvertes sur une échappée carrelée de blanc, une tôle ondulée… ou bien voici des escaliers qui semblent ne mener nulle part, des couloirs, un banc abandonné, une perspective sur un bâtiment désert. Presque incolore, impersonnel l’endroit, impeccablement cadré, d’une sublime neutralité, un no man’s land.
On se souvient de l’appel de Camille Claudel à sa cousine Henriette : « Mon infortunée personne s’est trouvée transportée délicatement dans un enclos grillagé… Je vous attends derrière la grille.
On voit la grille, on sait qu’il n’y aura pas de visite. Une solitude, une désolation émanent de ces images. Oui, une tristesse ! D’une plume répétitive et monotone la veilleuse Lagarde note dans son rapport que : « La malade est calme, se tient toujours seule au jardin, ne s’occupe à rien de la journée. » Au jardin, il y aurait comme une inquiétante douceur, une magnificence. Une vie sauvage s’invite dans la présence d’herbes folles, de lierre, de ronces et colonise une allée, une perspective, un parc arboré dont on aurait autrefois pris soin. Tandis que la malade selon la même gardienne n’était « ni propre ni soigneuse » avec sa « façon bizarre pour se coiffer ».
La vie végétative de Camille Claudel et des autres, en exil, comme elle, « ensevelie dans le plus affreux désespoir » s’apaise dans les images de Philippe Bertin, transcendée dans une singulière beauté, une poétique, entre présence et absence. Une sépulture ?
Ces scènes à la fois peuplées dépeuplées, habitées désertées, réalistes et abstraites font surgir le manque, coexister les contraires. Maniant l’oxymore, elles parlent alors d’humanité, d’humus, d’humain, d’humour, d’un lieu commun de la folie.
Danielle Arnoux, Camille Claudel, l’ironique sacrifice, Paris, Epel, 2001
Camille Claudel, réenchantement de l’œuvre, Paris Epel, 2011