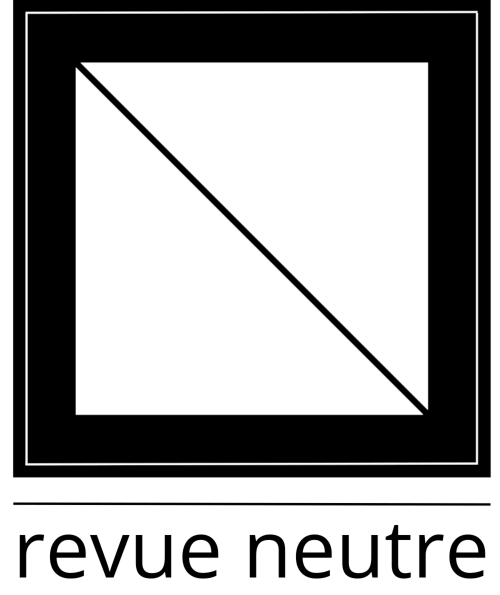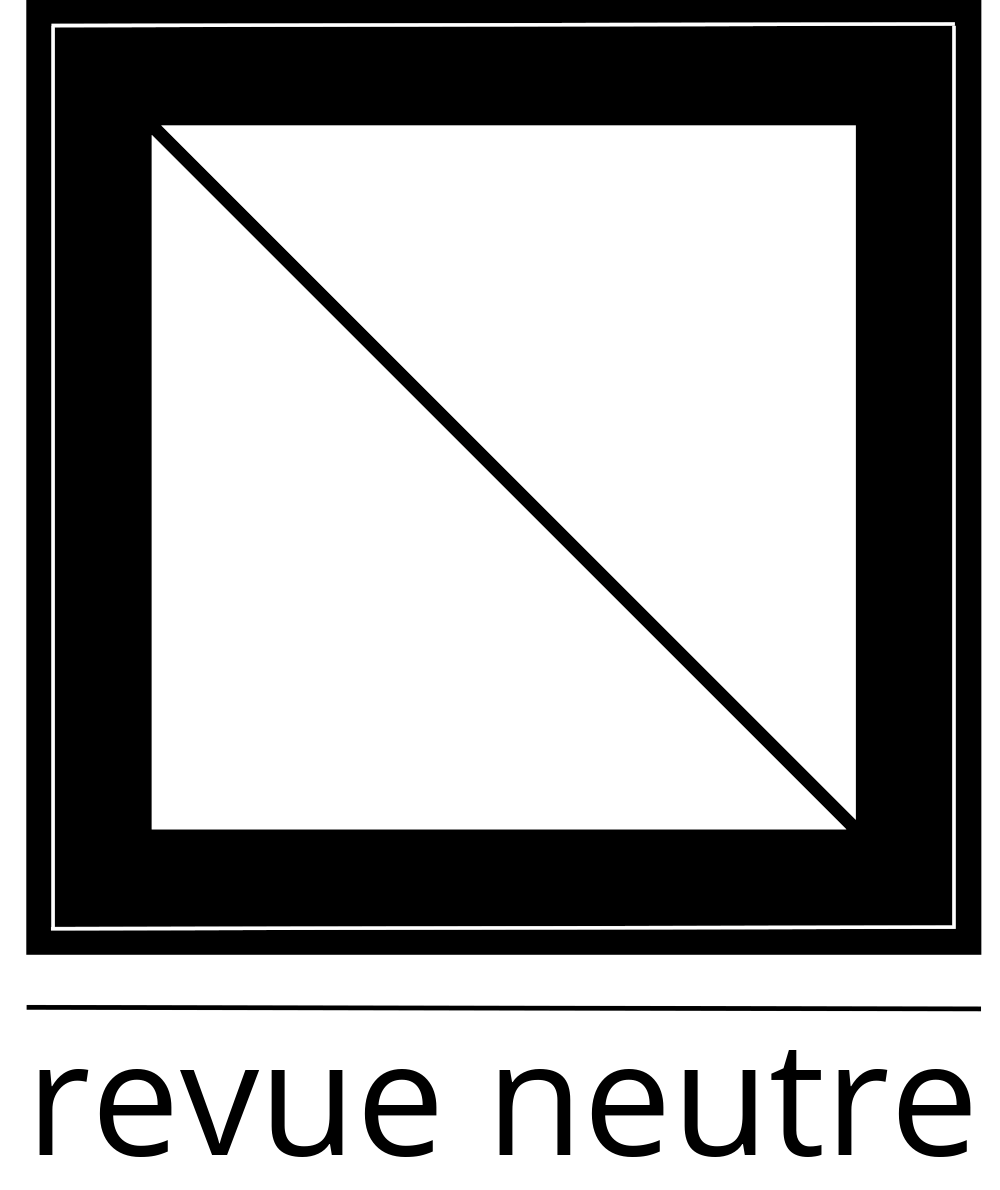TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE
La spécularité du cas
Guy Le Gaufey
Je me propose de mettre à la question l’un de mes préjugés les plus tenaces, qui baigne pour moi dans une évidence que le doute prend rarement en écharpe : j’ai besoin de croire que ce qu’on me raconte a existé, d’une façon ou d’une autre.
Je me suis pourtant longtemps trompé sur mon compte à cet endroit. Armé du fameux dit de Lacan : « La vérité a structure de fiction », je pensais tenir en presque égale estime les récits à l’évidence fictionnels, au moins en partie, parfois avoués comme tels, parfois non, et ceux à forte prétention réaliste. Jusqu’au jour où, dans la préparation d’un séminaire intitulé « Le fin cas », j’apprenais qu’une analyste londonienne venait de publier un livre relatant six cas « entièrement inventés1 ». Intrigué, je me le procurai et me dis d’emblée : « Bof, elle n’a pas l’air d’avoir inventé grand-chose », tant tout y était plus que vraisemblable. Mais au terme de ma lecture, il apparaissait que, oui, c’était fait (et bien fait) comme des « short stories », des petites nouvelles qui rendaient fort bien l’ambiance des séances, les apories du transfert, etc. Pourquoi ne pas le traduire ? Je me lançai alors dans un petit galop d’essai, sur une dizaine de pages, et tombai illico sur l’expression « the patient-on-the-page », qui ne m’avait posé aucun problème à la lecture de l’anglais, mais que je ne savais comment traduire : le « patient… de papier » ? (puisque nous avons des « tigres de papier »). Non, ça ne m’allait pas. Je cherchai meilleure expression, ne trouvai rien, et finis par laisser tout ça de côté, tant et si bien que je ne l’ai jamais traduit. Ça avait été juste un petit grain de sable, mais suffisant pour arrêter la machine : la fiction, peut-être, mais pas jusqu’à l’afficher au fronton du cas.
Je n’ai pas besoin de me perdre en conjectures pour savoir ce qui m’attache à ce besoin de référent dès qu’il s’agit de s’approcher d’un cas. Plutôt que de puiser dans ma propre besace d’ancien apprenti historien ayant un peu traîné dans des archives, je prendrai un exemple que John Forrester rapporte dans le cours de son article sur Kuhn2. Sous la direction de ce dernier, il est alors en train d’écrire sa thèse sur le physicien anglais James Prescott Joule, à qui nous devons encore le nom de l’unité avec laquelle nous quantifions l’énergie ou le travail. En lisant attentivement les travaux du savant Anglais sur la nature électrochimique de la chaleur, Forrester en vient à penser que Joule avait dû imaginer le rapport entre chaleur et mouvement comme résultant de forces qui faisaient se frotter entre eux les atomes – alors même que les textes publiés restaient muets là-dessus. Pendant tout un temps, Forrester garde pour lui ses idées plutôt saugrenues, jusqu’au jour où il se rend à Salford, la ville natale de Joule, dans le grand Manchester, et parvient à mettre la main sur les manuscrits du savant. Je le cite :
Ce fut donc un moment de triomphe et de justification quand je trouvai dans l’un des manuscrits une description graphique de ce dont j’étais absolument convaincu que Joule l’avait pensé : un diagramme décrivant les atomes avec des cordes enroulées autour d’eux tirées par une force externe3.
Deux vues de l’esprit – comment les appeler autrement ? –, étrangères l’une à l’autre, entrent soudain en correspondance, et presque en surimpression, produisant un effet subjectif de grande intensité. Une identité inespérée est venue donner force et réalité à ce qui n’était jusque-là que rêveries inavouables.
Pour mieux marquer ce que je cherche à distinguer dans cet appariement de pensées, je propose de considérer tout de suite un autre événement du même ordre que Forrester nous livre dans ce même article sur Kuhn, à savoir ce que ce dernier nomme l’« épiphanie Aristote » (Aristotle epiphany). En quoi consiste-t-elle, pourquoi Thomas Kuhn l’invoque-t-il si souvent ? Dans le cours de sa thèse, et chargé depuis peu d’enseigner la physique à Harvard, il lui faut comprendre comment Aristote concevait le mouvement. Il est donc en train de faire face au couple conceptuel acte/puissance par lequel le Stagirite conçoit tout type de mouvement comme « acte de ce qui est en puissance en tant qu’il est en puissance ». Lui, Kuhn, n’est alors en rien un philosophe, seulement un jeune physicien qui a bien sûr intégré le principe d’inertie galiléen selon lequel tout mobile en mouvement rectiligne uniforme poursuit indéfiniment sa trajectoire si aucune force extérieure ne vient le perturber. Avec Aristote, il est donc face à un autre monde conceptuel, qui ignore totalement le concept d’inertie et veut que tout corps en mouvement tente de lui-même de rejoindre son lieu.
Et là aussi, dans ce moment de forte concentration sur le mode de raisonnement d’Aristote, il se passe quelque chose d’intime chez Kuhn : il a d’un seul coup d’un seul le sentiment aigu de penser comme Aristote, à la façon de Forrester heureusement surpris d’avoir pensé comme Joule. Voici comment Kuhn décrit, avec vivacité et précision, l’événement qui a, selon lui, était suffisamment vif pour décider de sa vie ultérieure d’historien des sciences :
J’étais assis à mon bureau avec la Physique d’Aristote en face de moi et un stylo de quatre couleurs à la main. En levant les yeux, je regardais fixement dans le vide à travers la fenêtre de la pièce – j’ai encore l’image en tête. Soudain les fragments présents dans mon esprit se sont mis en ordre d’une nouvelle façon, et se sont retrouvés ensemble. J’en suis resté bouche bée, car tout d’un coup Aristote me faisait l’effet d’un très bon physicien, mais d’une sorte que je n’avais jamais imaginé possible […]. Ce genre d’expérience – les pièces qui soudain s’assemblent et s’arrangent d’une nouvelle façon – est la première caractéristique générale du changement révolutionnaire que j’élirai comme telle […]. Même si les révolutions scientifiques laissent de côté beaucoup de fragments à prendre en compte par la suite, le changement central ne peut pas être vécu de façon fragmentaire, étape par étape. Il implique plutôt une transformation peu structurée et relativement soudaine dans laquelle une partie du flux d’expériences se range lui-même différemment et rend évidents des modèles qui n’étaient pas visibles avant4.
Je n’hésiterai pas à rapprocher ces moments précis de l’histoire de Kuhn et de Forrester de celui où Lacan, dans son texte de 1949 sur le stade du miroir, invoque explicitement le Aha Erlebnis de Köhler5pour qualifier la découverte soudaine de l’identité spéculaire chez le jeune enfant. Dans tous ces cas, ô combien dissemblables, une fulgurance est venue imposer la cohérence d’une unité qui n’était pas là l’instant d’avant, en conférant à cette unité nouvelle une force appelée à organiser le champ où elle est apparue, pour peu qu’un sujet s’en fasse l’agent.
Ce n’est pas pour autant que tous les mystères se sont dissipés, loin de là. Qu’est-ce que Kuhn a si soudainement intuitionné pour voir en Aristote « un très bon physicien » ? Qu’est-ce que Forrester a compris de plus sur les rapports entre travail et chaleur en découvrant sa proximité imaginaire avec Joule ? On ne le saura pas vraiment. Mais on peut ne pas douter qu’un événement a eu lieu qu’il est permis de situer dans l’ordre de la pensée, introduisant une construction symbolique jusque-là inédite ou absente, qui met en scène un sujet dont la perception a basculé. On ne peut guère s’en approcher plus : on sait seulement qu’il y a un avant et un après, dans l’exacte mesure où un témoin vient l’attester.
Face à ce genre de survenue, on serait tenté de se faire gestaltiste : une forme s’est imposée en trouvant une unité inédite jusque-là. Yadl’un ! – de cet « un » du moins que Lacan devait par la suite qualifier d’« unien » –, tel pourrait bien être le cri générique proféré par qui vient de capter cette forme unifiée qui désormais s’impose, comme elle avait déjà su le faire lors de l’assomption jubilatoire (dixit Lacan) de ce que j’ai appelé le « lasso spéculaire », cette puissance première du stade du miroir à s’imposer comme la matrice de toute image à venir en tant qu’elle se boucle et, ce faisant, appelle à identification, réclame un sujet.
Après son « épiphanie Aristote », Kuhn, qui jusque-là se préparait à une carrière de physicien, bifurque et devient historien, de la physique d’abord, et des sciences « dures » en général par la suite, jusqu’à presque révolutionner ce champ. Pourquoi ? Parce que, dans le cours de cette épiphanie, ce qui s’est alors révélé à lui, c’est comment… « grimper dans la tête des gens ». Rien que cela ! « To climb in other’s people heads ». Lui qui n’est pas resté un chaud partisan de la psychanalyse, mentionne pourtant, à plusieurs reprises, qu’une des rares choses qu’il doit à ses deux ans passés sur un divan, c’est cela : qu’il lui était alors offert de « grimper dans sa propre tête » – de piger ce qui s’y passe quand la pensée se déroule au fil de la parole et de ses énoncés. C’est ce moment analytique qu’il se propose de réactualiser lorsqu’il s’approche en historien d’une découverte scientifique pour en décrire la genèse chez le savant dont il parcourt les textes : il veut retrouver le mode de raisonnement intime qui aura produit la découverte, il veut en percevoir à son tour la force persuasive, il veut réactualiser la découverte de son propre chef.
On est ici très proche du Descartes invitant tout lecteur du Discours de la méthode à refaire en lui-même l’expérience du doute hyperbolique pour déboucher de son propre mouvement sur le cogito, qui n’a valeur de vérité qu’énoncé en première personne. Il y a dans cette personnaison une donnée imprescriptible de toute réflexion sur le cas, lequel peut valoir pour beaucoup de monde, mais toujours sur le régime du « un par un », pour autant qu’il est dans sa nature d’advenir sur la base de ce couplage d’une image et d’un sujet.
Je propose donc de considérer que c’est d’abord sur le prototype du schéma vide de l’image spéculaire que se construit postérieurement cette unité fermée sur elle-même qui constitue la singularité du cas, lui assure son individualité, tout en lui conférant sa capacité de migrer d’un sujet à l’autre.
En privilégiant cette « épiphanie » à la Kuhn, je force bien sûr le trait en proposant de suivre une ligne de crète, une ligne sommitale de ce qu’il est permis d’appeler « cas » puisque nous assistons ici à la naissance de la puissante notion de « paradigme », sorte de super cas destiné à organiser le vaste champ d’un nouveau savoir. Mais aussi impressionnant qu’apparaisse un tel concept dans l’histoire des sciences, il n’est pas pour autant à concevoir dès le départ comme quelque chose de public et régnant dans de larges collectivités, scientifiques ou nationales. Son possible élargissement à une plus vaste audience ne nécessitera pas moins que la répétition indéfinie de cette bascule du sujet qui a eu lieu lorsque quelqu’un a perçu, pour la première fois, la nouvelle unité qui s’offrait alors à lui. Sans la possibilité de cette répétition, de ce glissement qui met chaque fois en œuvre un sujet déterminé, l’événement resterait limité à son point de surgissement, et sombrerait corps et âme. Tout cas aspire de lui-même à de nouveaux sujets pour se fortifier. C’est vrai des plus grands et des plus fameux comme des plus modestes.
Combien de fois, parlant du concept de « cas », on invoque son étymologie latine pour en faire ce qui chute, ce qui tombe, ce qui se sépare et, de ce fait même, se singularise en s’offrant comme de lui-même à un public ? Mais on néglige alors l’opération qui a conduit à ce résultat, à savoir la soudaine cohésion d’une forme unifiée et de l’assentiment du sujet qui la soutient. L’une et l’autre sont les deux faces d’une même pièce, et c’est cette cohésion qui constitue le cas comme tel.
À mon sens, l’intérêt principal de postuler une matrice spéculaire au bouclage du cas tient à ce que l’on peut alors questionner l’un de ses aspects princeps, à savoir l’autorité que le cas détient – ou pas. Elle est patente dans le domaine juridique, même si elle se décline très différemment dans les pays de Common Law et ceux régis par le droit qu’on dira pour aller vite « continental 6 ». Dans les premiers, il suffira que le cas présenté puisse être aligné sur un cas précédent pour que l’autorité de ce dernier rejaillisse par principe sur le cas présent et entraine la décision du juge. Dans les pays de droit continental au contraire, le pouvoir du cas n’est que second : au juge de saisir à quel point il relève de la loi que le Législateur a produit à cet endroit, ou aux environs de cet endroit. L’identité qu’à chaque fois le juge doit chercher à atteindre pour armer sa décision portera, d’un côté sur des ressemblances formelles entre deux cas, de l’autre côté sur la dépendance formelle du cas singulier à la loi générale. On remarquera cependant que, d’un côté ou de l’autre de la Manche, il est toujours précisé que cette nécessaire décision du juge doit venir de son for intérieur, de sa libre capacité à adopter ou à rejeter l’identité, même partielle, entre deux éléments. L’assentiment d’un sujet est toujours requis pour qu’un cas parvienne à s’insérer dans le tamis jurisprudentiel.
Reste l’immensité des autres cas de toutes sortes, dans l’ordre du savoir, de la morale, de la politique, des sciences, de l’histoire et plus encore de la médecine, pour ne rien dire de la psychopathologie et de la psychanalyse, bref : partout où le penser par cas montre peu ou prou le bout de son nez : sur quoi s’y règle l’autorité, vu la profonde hétérogénéité du terrain casuel ?
Du fait de notre hypothèse spéculaire, la réponse peut être double : tantôt l’image en jeu est elle-même perçue d’emblée comme porteuse d’ordre et de sens et gagne aisément la partie, se propage sans grandes difficultés ; tantôt la cohorte des sujets qui l’ont soutenue, le prestige de certains d’entre eux, tout cela impressionne au point de forcer l’assentiment des nouveaux venus. Il est tout autant possible que les deux facteurs s’additionnent pour provoquer de véritables mouvements de foule dans l’adoption de cas – tout spécialement dans le champ politique où le facteur émotionnel pèse lourd et façonne le terrain identificatoire.
Il y a aussi les innombrables tentatives où le « faire cas » échoue pour les deux mêmes raisons spéculaires : l’image produite ne trouve pas l’unité qui permettrait de la saisir d’un coup, de capter ce qu’elle articule au-delà ou en deçà de la pluralité de ses éléments constitutifs ; il se peut aussi que le sujet qui la soutient n’ait pas grand pouvoir d’incitation, ne jouisse d’aucun crédit préalable. L’affaire alors retombe parce que s’étiole et disparaît le courant identificatoire qui fait glisser d’un sujet à l’autre, à l’instar du mot d’esprit dont la qualité se mesure à l’envie de le propager comme si on l’avait soi-même inventé. Ainsi, beaucoup de cas, dans beaucoup de secteurs, tournent court et rejoignent les invisibles congrégations de mort-nés qui peuplent la « littérature ».
Mais c’est aussi par là que je reviens à mon préjugé de départ : ne serait-ce point quelques traits référentiels du cas – donc je ne sais quelle réalité hors discours – qui, une fois reconnus à travers le récit du cas, installeraient ce dernier dans sa pérennité, sans plus prendre appui sur l’autorité préalable de son sujet ou la capacité de son image à faire de l’un ?
Je retrouve ici ce que j’ai appelé concernant Lacan « l’hypothèse Schliemann » : pourquoi, au fil de ses années borroméennes, a-t-il tant voulu s’assurer que les innombrables présentations du nœud étaient toutes réductibles à un seul et unique nouage ? Je me le suis longtemps demandé en vain, jusqu’à la séance du 9 janvier 1979 où Lacan, plutôt dépité, reconnaît que tel n’est pas le cas et qu’il doit donc, d’une certaine façon, reprendre ses billes et convenir que son « Il n’y a pas de rapport sexuel » ne tient, pour finir, qu’à son énonciation à lui. Qu’avait-il donc espéré pour buter sur une telle déconvenue ? Cela ne peut tenir qu’à de discrètes mises en place antérieures : si le mot « rapport » doit être compris comme un nouage de deux consistances qui se traversent l’une l’autre, alors le nouage borroméen peut valoir comme un lien qui n’est pas un rapport, et qui peut-être mérite le nom de non-rapport. En exhibant un nœud qui aurait valu pour tous les nœuds borroméens, Lacan aurait alors pu apporter univoquement la preuve de l’existence d’un mode de lien qui méritait de s’appeler « non-rapport », et que donc « il n’y a pas de rapport sexuel » ne se réduisait pas à une affirmation négative universelle de son cru, mais méritait aussi d’être envisagé comme un fait puisque tout un chacun pouvait avoir accès à une forme de « non-rapport », sans plus avoir à le croire lui, mais en ouvrant les yeux ou en faisant confiance à ses mains7.
On devine aisément qu’il y a dans ce genre de mouvement vers le « hors discours » une tentative effrénée de sortir des incertitudes du cas « par le haut », si j’ose dire, en s’efforçant de gommer, déplacer, atténuer, rendre diaphane et presque faire disparaître l’énonciation qui aura présidé à la mise sur orbite du cas. Chez l’inventeur, ça pourrait s’expliciter ainsi : « Certes, je l’ai dit, il le fallait bien, mais ce n’était là qu’une anticipation heureuse ; aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de refaire tout mon chemin : ouvrez les yeux, et regardez. Le cas parle enfin de lui-même ». Et d’ailleurs, s’il reste en lui quelques traces de l’énonciation qui l’a porté sur ses fonds baptismaux, cette énonciation fait maintenant partie intégrante du texte à lire, elle n’est plus sa source obscure, son ombilic subjectif, son trou noir, mais seulement une sorte de tissu conjonctif, lui aussi livré au regard, lui aussi désormais passible d’une lecture comme le reste du texte.
Cet espoir d’une éradication subjective est à prendre au sérieux si l’on tient à considérer, dans la dynamique du cas, ce mouvement asymptotique par lequel le discours et ses agencements ambitionnent d’atteindre au réel, par les voies langagières du symbolique, certes, mais arrimées à la puissance émotive de l’imaginaire et à sa capacité de bouclage unitaire. Une construction casuelle trouve sa consistance lorsqu’elle parvient à faire image en s’appuyant sur un sujet qui rêve de disparaître parce que ce serait là sa plus grande réussite. Ceci n’est pas là une histoire de cas ; c’est l’histoire du cas.
.