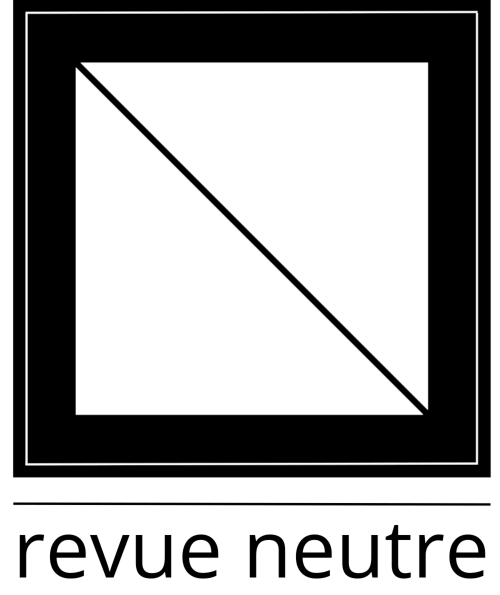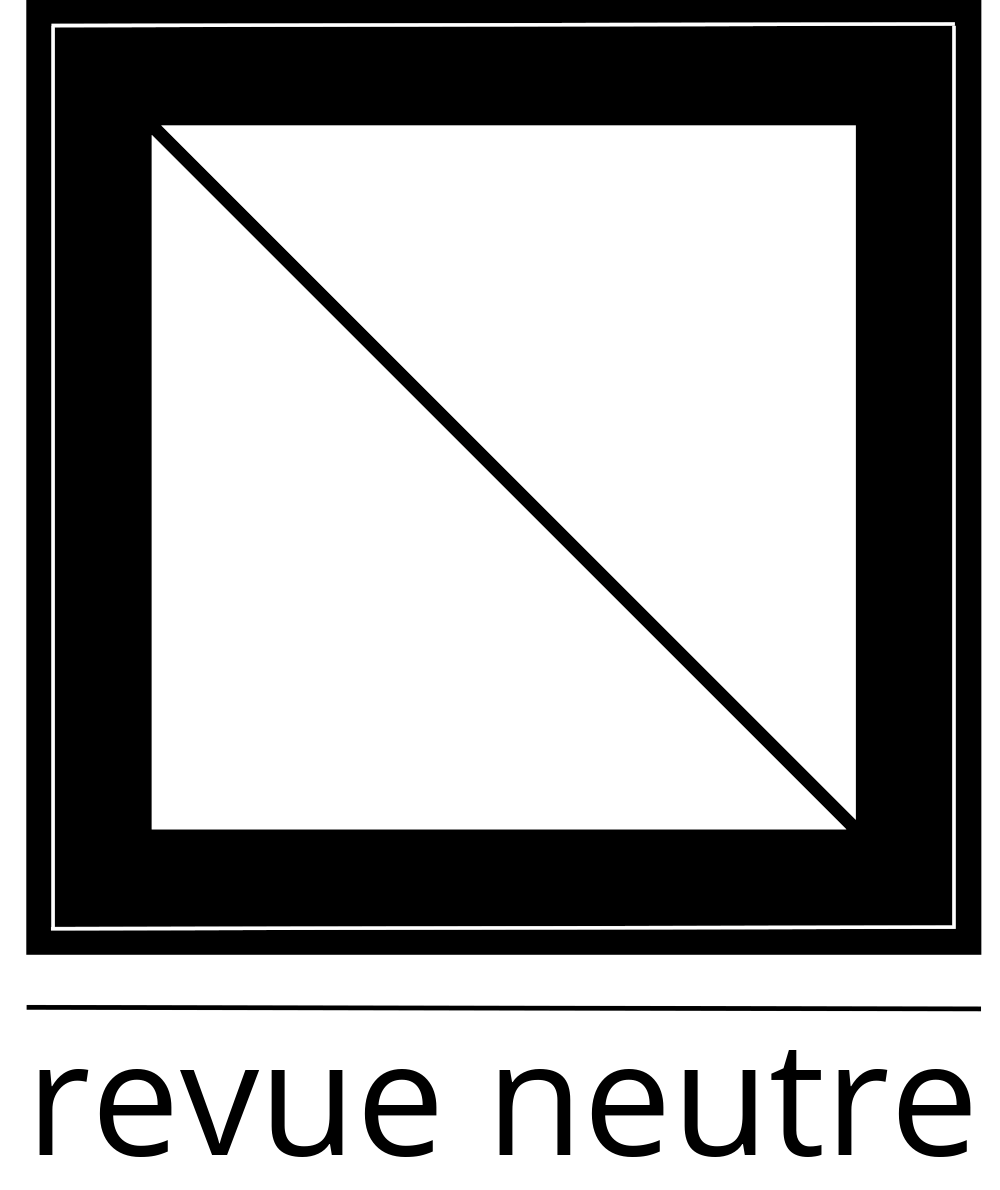TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE
Le neutre, effet de la castration
Charles-Henry Pradelles de Latour
En reprenant le séminaire, La relation d’objet, (1956-1957), de Jacques Lacan, on se propose de montrer que le manque symbolique inhérent à l’opération de la castration ouvre la possibilité d’une position à la fois sociale et subjective correspondant à celle du neutre1. Selon les tripartitions proposées, la castration a pour agent, le père réel, pour objet, le phallus imaginaire, dont la perte est soldée par un manque symbolique. La castration dont il est fait état se rapporte à l’Œdipe, au père castrateur séparant l’enfant de sa mère ; c’est le seul exemple connu en Occident. D’autres possibilités existent si on accepte de se déplacer dans les sociétés traditionnellement orales, riches en situations parentales variées, où l’interdit de l’inceste ne relève pas forcément de la seule loi du père selon la filiation. L’Œdipe n’est pas universel. L’ethnographie des systèmes de parenté africains, tel que celui des Bamilékés du Cameroun, est à cet égard instructive, car elle met en évidence une modalité d’interdit de l’inceste inédite. Celle-ci n’est pas instaurée par le couple parental, mais par la relation d’alliance matrimoniale rituellement scellée entre deux lignages patrilinéaires au cours de trois temps scandés par les trois positions subjectives – frustration, castration et privation – définies par Lacan dans les tripartitions2.
L’interdit de l’inceste dans une chefferie bamiléké
Pour saisir la spécificité africaine de cet interdit de l’inceste, il faut admettre que la notion d’« allié » recouvre une toute autre réalité que celle admise en Occident. Pour nous, les alliés sont toutes les personnes auxquelles nous sommes apparentés par le mariage à commencer par les beaux-parents, les beaux-frères, les belles-sœurs, et ceux qu’on appelle communément les pièces rapportées. Dans une société patrilinéaire, mes alliés sont en premier lieu mes parents maternels qui ont cédé une femme, ma mère, au groupe de filiation de mon père. Selon cette ordonnance, les parents maternels sont mes alliés et mes paternels mes consanguins, les parents auxquels je suis relié par la filiation. Autrement dit, pour les Bamilékés, les parents maternels, alliés, ne sont pas considérés comme des consanguins.
En 1973, à Bangoua, chefferie bamiléké, où j’ai mené une mission ethnologique, lorsque le fiancé faisait part de sa demande en mariage à ses futurs beaux-parents, ceux-ci lui demandaient de leur remettre une grosse somme d’argent en guise de dot et d’offrir de nombreux cadeaux à leurs proches en suivant un rituel préétabli. Il s’agissait d’entériner le passage de leur fille d’un groupe de filiation patrilinéaire à l’autre.
Lors du premier temps de rite de passage, le fiancé, aidé par son père et ses aînés, amassait tous les biens dont il pouvait disposer pour satisfaire cette demande. Mais le père de la fiancée trouvant que ces présents étaient insuffisants en réclamait davantage. Le fiancé s’exécutait et s’arrêtait lorsqu’il n’avait plus rien à donner. Frustré, le demandeur de femme se sentait trahi, car il avait beaucoup donné sans rien recevoir en retour.
Le deuxième temps s’ouvrait sur l’intervention du père de la mère de la fiancée, soit son grand-père maternel. En tiers entre les deux partis, en tant que donneur de femme en titre, il cédait au fiancé sa petite-fille utérine, une alliée pour lui, contre un prix conventionnel insignifiant : une chèvre et une calebasse d’huile de palme. Le fiancé, libéré de la demande impossible à satisfaire de son futur beau-père, contractait alors une dette symbolique, c’est-à-dire une dette sans créance, pour l’épouse qu’il recevait du grand-père maternel de sa fiancée. La fille « incestueusement » attachée à son père était alors séparée de sa famille consanguine et devenait statutairement une alliée, donc une épouse disponible, une femme sexuée, pour son futur mari.
Lors du troisième temps, la fiancée, accompagnée de ses parents et amies qui portaient son trousseau sur la tête, arrivait dans la résidence de son époux, où elle était promue statutairement « épouse-future mère d’enfant ». À partir de ce moment, le mari contractait envers ses beaux-parents une seconde dette remboursable, tout au long de la vie de sa femme, par les aides occasionnelles qu’il devait leur apporter pour faire les moissons et contribuer aux frais des deuils.
Durant les trois temps du rite, le fiancé passait par trois phases subjectivement distinctes. En effet, de la frustration réelle qui l’avait déstabilisé, il était libéré de la demande incessante de son futur beau-père par la coupure instaurée par la dette symbolique, vide de contenu, contractée pour l’épouse reçue. Ayant perdu ainsi la femme-phallus, objet imaginaire du désir, il acquérait dans le troisième temps de ce rite de passage l’épouse-future mère d’enfants souhaitée, laquelle privée de la jouissance phallique (cédée pour rien) n’était pas toute. Si le mari et ses enfants respectaient les deux dettes, les statuts de l’épouse-alliée et celui de l’épouse-future-mère étaient séparés. Dans ce déroulement, était validé l’interdit de l’inceste séparateur des donneurs de femme, les alliés, et des preneurs de femme, les consanguins.
En d’autres termes, l’analyse de ce rite de passage montre que les statuts parentaux y exercent finalement la même fonction que celle qu’opèrent dans l’inconscient les signifiants en Occident. Dans ce régime matrimonial, une femme dotée est en effet représentée par le statut d’épouse, alliée, pour un autre statut, celui d’épouse-mère intégrée au groupe de filiation de son mari, sans qu’il n’y ait de rapport entre eux. Dans ce cadre, une femme dotée, est donc divisée de façon normative pour elle et les siens par des statuts sociaux (épouse et épouse-mère) qui, n’ayant aucun rapport entre eux, font fonction d’interdit de l’inceste. Une femme dotée, divisée statutairement, ne doit donc rien à la logique du don et de l’échange.
La coupure symbolique qui fait loi n’est pas seulement sociale, en tant qu’elle sépare pour tout sujet les consanguins (les parents appartenant au groupe de filiation du père) des alliés (les parents de la mère), elle est aussi subjective. La coupure de l’interdit de l’inceste sépare en effet, pour la mère et les siens, la sexualité prégénitale reliant l’enfant à l’épouse-mère de la sexualité génitale rapprochant l’épouse et son mari. Autrement dit, la castration sépare les objets a aliénant les enfants à leur mère du phallus. Lequel perdu ouvre un manque symbolique libérateur qui préside aux relations entre alliés.
Pour en revenir au discours de la psychanalyse, cette division a amené Lacan à opposer deux fonctions distinctes, nommément la demande d’amour et le désir3. Chez les Bangoua, demande d’amour et désir sont socialement et subjectivement tranchés. La demande d’amour relie entre eux les membres du groupe de filiation du père, et le désir se rapporte aux membres du groupe de filiation de la mère, les alliés du père. La demande et le désir sous-tendent ainsi deux types de relations parentales répondant à des logiques contrastées.
La demande d’amour implique une relation duelle, moi/autre. Ancrée dans la relation primordiale et objectale à la mère, elle peut se transformer en sentiments de jalousie ou de haine et alimenter parmi les membres d’un groupe de filiation patrilinéaire tantôt leur unité et leur solidarité, tantôt la discorde et les antagonismes exprimés en termes de sorcellerie. Tandis que la demande d’amour est source de passions et de contradictions, le désir, pour sa part, impersonnel, répond au ternaire, imaginaire, symbolique, réel, de Lacan.
Dans le monde bangoua, le grand-père maternel appelé « père de derrière » occupe ce qu’on pourrait appeler la position subjective du neutre, définie de trois façons différentes.
Sur le plan imaginaire, le « père de derrière », père selon l’alliance matrimoniale, ne se prévaut pas de ses honneurs, de son titre de noblesse et du siège qu’il occupe dans les sociétés secrètes du palais du chef, lesquels auréolent son prestige du côté de la filiation. Le père de derrière est hors réciprocité. Il ne donne rien à ses petits-enfants utérins de son vivant, et ceux-ci n’héritent de rien après sa mort. Dans la vie publique, il ne prend parti ni pour ni contre eux en cas de conflit. Dans la vie privée, il ne confie pas de secrets aux enfants de ses filles et, en aucun cas, ne les maudit. Ni intimité ni complicité, pas d’amour entre eux.
Sur le plan symbolique, la génération du grand-père maternel et celle de ses petits-enfants sont inversées dans le langage. Lorsqu’un notable a pour titre de noblesse menkap, ses petits-enfants utérins ont pour nom d’éloge, Mè menkap, « Mère de menkap », et Tè menkap, « Père de menkap ». Selon cette appellation utilisée quotidiennement par leurs proches pour les interpeller, les petits-enfants utérins sont supposés sur le mode de la plaisanterie être plus âgés que leur grand-père, donc symboliquement supérieurs à lui. La relation d’alliance matrimoniale est ainsi banalisée, nominalement désacralisée4.
Enfin, sur le plan réel, lorsque les petits-enfants utérins sont en souffrance, en proie d’une manière ou d’une autre aux affres de la sorcellerie, leur grand-père les abrite s’il y a lieu et, surtout, il reçoit les offrandes de nourriture qu’ils lui apportent. Il en remet une petite partie sur le crâne de ses ancêtres, afin que ses petits-enfants puissent dans l’après-coup de cet acte se réinscrire dans la dette symbolique d’alliance matrimoniale scellée par leur père lors de son mariage.
Dans ce contexte, le neutre ne se réduit pas à une option, telle la bienveillance ou la tolérance, il est fondé sur une structure du sujet où chacune des trois « dit-mentions » joue un rôle prépondérant sans que l’une soit plus déterminante que les deux autres. Le neutre, défini par Roland Barthes, se rapporte aux principales caractéristiques de cette structure de façon circonstanciée. Neutraliser, dit-il, c’est déjouer une force, l’annuler, « revenir au degré zéro5 », soit, selon ma lecture, retourner à l’absence originelle du phallus. Le neutre, précise-t-il, est au départ exemption, l’annulation d’un terme premier tenu pour équivalent général, soit une origine du symbolique, manquante : « Le neutre est déprise du sens6 », abolition des limitations. Il ne s’agit pas d’un rejet, facteur de refoulement, mais d’une levée d’interdiction, la libération d’une aliénation, impliquant une suspension, « une avantageuse imprécision7 ».
Un neutre fondé sur la dette symbolique d’alliance matrimoniale est en somme une absence de tiers élément, c’est-à-dire une absence de contenu – de pouvoir, d’avoir ou de savoir – posée en préalable aux discours courants. Ce neutre est en cela « imprédicable8 ». Ni actif, ni passif, ni masculin, ni féminin, le neutre est sans qualité. Sans affect, sans jouissance ou souffrance, sans image ni reflet en miroir, il est extérieur aux oppositions et aux contradictions. C’est en tant qu’effet que le neutre peut se substituer dans l’après-coup à la cause d’une tension, et qu’ « il est levée des conflits9 », suspension des passions. Comme donneur de femme en titre de la fille de sa fille, en charge de conclure pacifiquement l’alliance matrimoniale scellée avec son fiancé par la dette symbolique, le père de derrière est le représentant de la position subjective du neutre. Il suspend la violence, désamorce l’enjeu des accusations de sorcellerie et banalise les relations entre alliés. Cette position, sociale et subjective, étrangère à la hiérarchie des valeurs, honneur, richesse, réussite, prônées par les règles usuelles de la vie en société, est validée à Bangoua par un quatrième terme, à savoir les ancêtres agnatiques du père de derrière qui, garants en dernière instance de la dette symbolique d’alliance matrimoniale, sont en position de tiers du tiers.
Le désir, apport de l’ethnographie africaine
Dans la civilisation occidentale, la demande d’amour, qui préside aux mariages et aux relations parents/enfant, implique l’association étroite des pulsions orales et de la jouissance phallique. En revanche, dans l’Afrique subsaharienne traditionnelle, la séparation de ces deux types de sexualités détermine l’ordre du désir, oublié dans notre société, où les rites de passage ont disparu depuis longtemps. L’ethnographie de ces rites peut donc être instructive pour la psychanalyse en panne d’exemples pour rendre compte de sa pratique afférente au désir. Qu’est-ce que le rite d’alliance matrimoniale des Bangoua nous apprend ?
Tout d’abord, il nous rappelle que le sujet du désir n’est pas agent, mais agi. Ce sujet, qui n’est pas doté d’intentions, ne reconnaît la cause qui l’a déterminé à son insu que dans l’après-coup de l’acte. Le désir est ainsi de façon paradigmatique acte à la suite de la perte du phallus opérée dans l’après-coup de la castration. La chute de la jouissance sexuelle soldée par un manque symbolique a pour caractéristique – ignorée de la psychanalyse – de se présenter comme la restitution de l’origine manquante du phallus instituée sous forme de dette symbolique. Ni Freud, ni Lacan n’ont conféré dans leur théorie une origine définie et localisée au phallus. Comment se fait-il que cette origine spécifiée en termes de dette symbolique soit garantie en dernière instance par les ancêtres du père de derrière auprès desquels les descendants utérins du lignage peuvent se réinscrire en tant que sujets divisés pour guérir ?
Dans ce rite, l’objet du désir, la femme désirée en position du phallus, est divisée à l’instar du sujet du désir inscrit dans la chaîne langagière non pas entre deux signifiants mais entre deux statuts parentaux distincts, l’épouse, alliée, et l’épouse-mère procréatrice d’enfants pour le groupe de filiation de son mari. Cette division statutaire, rituellement établie, a valeur de loi à la fois sociale et subjective. Elle sépare effectivement pour la femme dotée, son mari et ses enfants, le lignage des alliés d’où elle sort du lignage de la filiation où elle est intégrée comme épouse-mère. Dans le même mouvement, la femme divisée sépare aussi subjectivement la sexualité génitale, phallique, de la sexualité prégénitale des objets a. Le rite de passage a pour caractéristique spécifique d’établir ainsi la loi de l’interdit de l’inceste selon un complémentarisme, validé autant sur le plan collectif que sur le plan subjectif. Au titre de ce complémentarisme, il apparaît donc que la perte du phallus, modalisée en dette symbolique, qui est supposée diviser et fonder rituellement le sujet du désir10, lors de chaque mariage, est normative et curative. L’absence de jouissance intrinsèque à la dette symbolique, qui fait office d’interdit de l’inceste, est formatrice de la position subjective et pacifique du neutre. Et ce manque du phallus est représenté et garanti en dernière instance par les ancêtres de derrière pour que leurs descendants utérins affligés puissent se réinscrire dans la dette symbolique en tant que sujets divisés. Ces ancêtres sont socialement institués en tiers de tiers, dans une sorte d’Autre vide, différent de l’Autre de la filiation, étranger à la culture européenne.
L’ethnographie des rites d’alliance matrimoniale nous indique ensuite clairement que l’établissement du sujet du désir et sa réinscription après-coup dans la dette symbolique, pacifique et désacralisée, lors des conflits et des maladies, sont totalement extérieurs au domaine de l’action et des fonctions qui régissent la vie quotidienne. C’est pourquoi le désir et son objet sont structurés par les trois phases des rites de passage, qui leur confèrent leur extraterritorialité et leur atemporalité. Le rite est en ce sens le cadre spatio-temporel propre aux manifestations du désir, que nous connaissons sous la forme individuellement ritualisée des symptômes et des fantasmes dépendants du grand-Autre. C’est dire que la gestion de la jouissance sexuelle a d’abord été ordonnée collectivement par les rites de passage avant d’être totalement individualisée dans la société moderne occidentale. Le passage du collectif à l’individualisme est essentiellement signifié subjectivement non pas tant par un changement de mentalité suspect de parti pris, comme cela a été largement soutenu en anthropologie, mais par l’effacement progressif des rites de passage attenant à un déplacement du lieu de l’Autre.
L’ethnographie des rites d’alliance matrimoniale qui nous a introduit dans les arcanes rituels du désir nous a fait enfin découvrir l’aspect ternaire, imaginaire, symbolique et réel, qui détermine la position à la fois sociale et subjective d’un neutre, fondé sur l’absence du phallus, l’absence de signifié. Tel est le point central que la rédaction de mon dernier livre m’a fait découvrir. Lorsque, dans une société traditionnelle, société structurée par un ensemble de rites, la sexualité phallique est d’une manière ou d’une autre plus marquée que la sexualité prégénitale, ses instances sociales dominantes sont trois. L’ordre symbolique estampé originellement d’un manque s’oppose à toute unité. En revanche, lorsque, dans une société traditionnelle, sexualité orale et anale sont prédominantes, plus marquées que la sexualité phallique, les institutions supérieures de la société sont subsumées par une instance supérieure unique relevant de l’imaginaire.
.