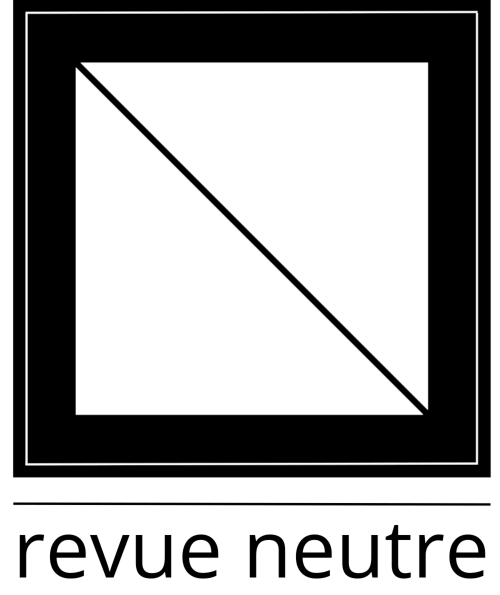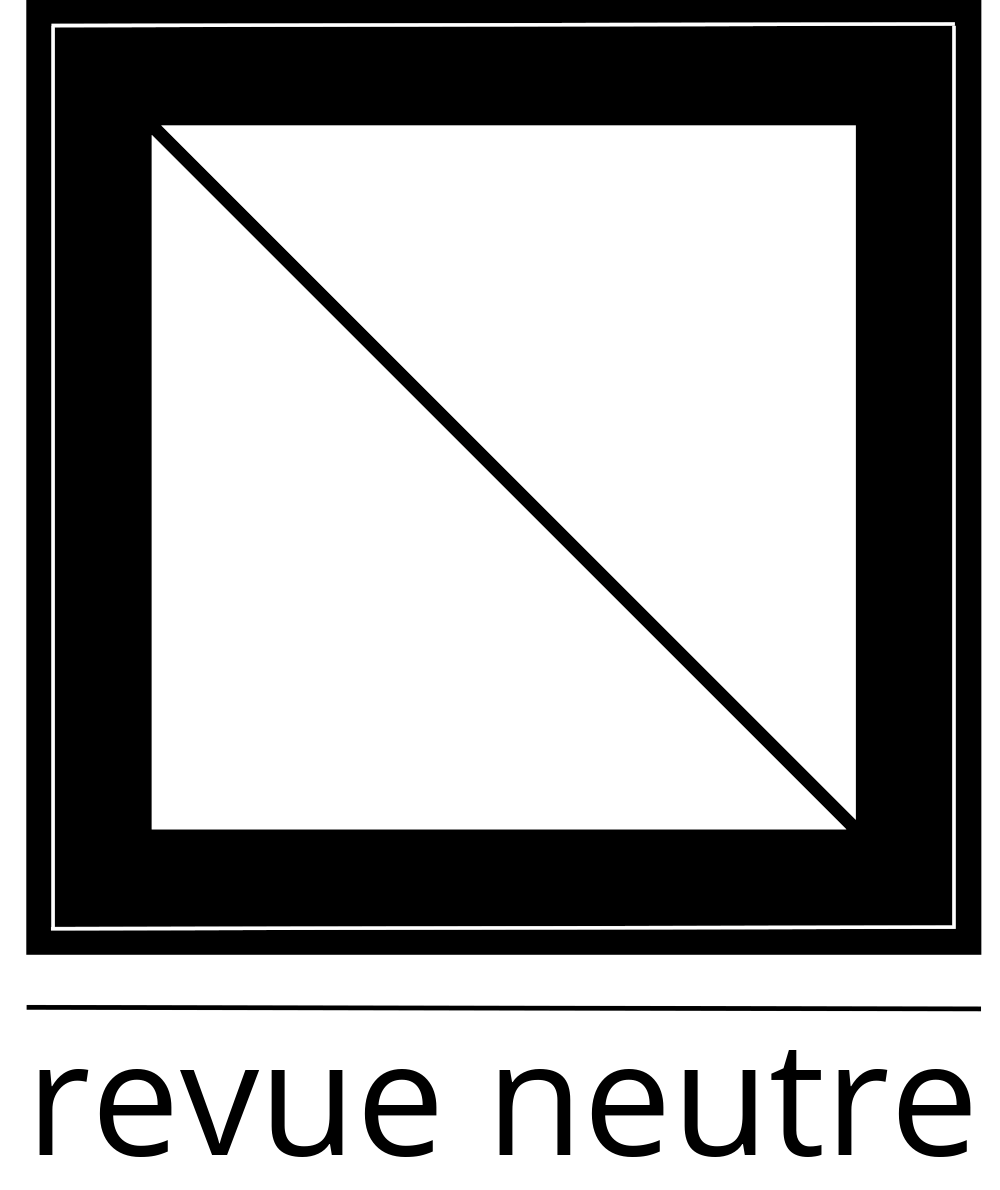TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE

Ne riez pas trop de ce connard, c’est un piège
Danielle Arnoux
Il n’y a aucune autre raison d’aimer Dieu, si ce n’est que peut-être il n’existe pas1.
Jacques Lacan
De Platon à Claudel
En dégageant de sa lecture de Lacan une partition entre deux analytiques du sexe, Jean Allouch note que d’autres auteurs ont eux aussi avancé une distribution de l’érotique dans deux registres différenciés. Il construit un tableau à la page 18 de Pourquoi y a-t-il de l’excitation sexuelle plutôt que rien ?2
Platon figure en bonne place dans cette liste. Les deux registres distingués par lui sont indiqués comme « désir sexuel » et « érotique métaphysique ».
J’ai proposé d’ajouter Paul Claudel au tableau, en ayant questionné le voisinage Platon/Claudel offert par Lacan pour parler du transfert dans son séminaire de 1960-19613. Au Banquet, dont le commentaire ouvre le séminaire, succède la Trilogie claudélienne (L’Otage, Le Pain dur, Le Père humilié). Sur le tableau, on peut noter à la ligne Claudel : « la chair pas sans l’esprit » et « l’esprit pas sans la chair ».
|
|
Registre 1 |
Registre 2 |
|
Platon |
Désir sexuel |
Érotique métaphysique |
|
Lacan |
Analytique de l’objet a |
Analytique du rapport sexuel |
|
Foucault |
Dispositif de sexualité |
Dispositif d’alliance |
|
Rubin |
Sexe |
Genre |
|
Claudel |
La chair pas sans l’esprit |
L’esprit pas sans la chair |
Il m’est apparu que, s’agissant de l’amour, les deux auteurs, l’antique et le chrétien, quoique distants de vingt-cinq siècles partageaient un certain nombre de traits. De l’amour, en effet chacun d’eux élabore une figure singulière, distincte des mœurs ordinaires de son époque. L’erôs platonicien ne reflète pas les mœurs des anciens Grecs en matière d’erotika (un terme propre à Platon). Quant au fervent catholique devant l’Éternel, Claudel, il ne prône pas un amour que l’on puisse qualifier de « chrétien ». Il n’a rien non plus d’un anachorète. Il invente. Deux registres de l’érotique, deux modalités du sexuel sont clairement articulées par l’un et l’autre, lisibles, y compris dans le commentaire qu’en donnait Lacan en 1960-1961. Pour le dire dans des termes peu dégrossis mais permettant de mettre Platon et Claudel en série, le premier registre implique une forme de contentement immédiat, l’autre implique un délaissement du sexuel et permet d’accéder à une autre sorte de jouissance à visée d’éternité. Le passage de l’un à l’autre registre érotique n’est pas une donnée, la voie n’en est pas tracée par avance. C’est alors une conquête qui s’obtient, ou pas, au terme d’un parcours à la fois esthétique et spirituel. Il apparaît dans Le Banquet que le cheminement d’Alcibiade s’est précipité en court-circuit aboutissant à un ratage, tandis que Socrate se faisait comme absent (n’étant rien). Anticipant sur un potentiel « troumatisme4 », Lacan évoque les mots de Dante inscrits sur la porte de l’Enfer : « Vous qui entrez ici laissez toute espérance. » Aphrodite n’est pas souriante … Dans le théâtre de Claudel le sacrifice, parfois cruel, qui se présente sur le parcours, s’avère plus ou moins abouti. La présence d’un au-delà guide ces héros, ces purs, ces saints dans leur exploration de l’érotique. Une transcendance est déterminante. Socrate entend la voix étrange et familière d’un daïmon qui l’avertit des pièges où il pourrait glisser et l’invite à s’abstenir, quant à Prouhèze, l’amante du Soulier de Satin, c’est un ange gardien qui l’escorte et intervient à l’ultime instant où une décision s’impose.
Au moment où Lacan s’intéresse tout particulièrement à la place qu’occupe l’analyste dans le transfert, il en appelle à ces figures (l’amour platonique puis l’amour claudélien) qui auraient donc été susceptibles de fournir un éclairage pour l’exercice analytique. Mais alors à l’exclusion de toute transcendance : aucun ange, ni démon ne murmurent dans le consultoire lacanien.
Dans le lit plus ou moins douillet du tête-à-tête analytique, comment se fait-il que l’exercice ne débouche pas plus souvent sur des ébats sexuels ? C’est ce qu’il s’agit de cerner.
Jean Allouch consacre un chapitre à la mise en évidence des deux modalités de l’érotique platonicienne : « Deux instanciations d’erôs : Platon. » Je n’en dirai par conséquent que quelques mots. Celle du désir sexuel est incarnée par Alcibiade, l’autre proprement métaphysique, par Socrate. L’une réclame un assouvissement immédiat, l’autre vise à une eudaimonia (la possession perpétuelle du bien par l’amant). Diotime, dont Socrate restitue la parole, lui a enseigné les étapes, par degrés ascendants, d’une échelle d’ascèse, par laquelle l’amour du beau jeune homme élu au départ peut mener l’amant, qui s’offre à l’exercice initiatique, jusqu’à la contemplation du beau pur, sans mélange, détaché de l’objet aimé particulier, un Beau transcendantal.
Néanmoins, Lacan, dans sa lecture du Banquet, insistait davantage sur la mise au jour d’un merveilleux objet du désir, nommé agalma, qu’Alcibiade a aperçu et traqué coûte que coûte chez son amant, devenant /devenu aimé, Socrate. Cet agalma (sa notion) a pris plusieurs formes jusqu’à l’écriture de la « Proposition du 9 Octobre 1967 sur le psychanalyste de l’école5 ». L’objet petit a devenu cause du désir le relaie, la première analytique n’a pas dit son dernier mot.
Deux voies pour l’érotique claudélienne
Voyons plus précisément ce qui se présente ensuite, dans le théâtre de Claudel, en matière d’érotique.
Le mariage est consentement et même sacrifice du plaisir, du moins dans les deux premières pièces de la Trilogie. Deux chairs s’unissent pour une fin hors d’elles-mêmes. C’est une voie, il y en a au moins deux autres concernant l’érotique.
L’amour consiste en la rencontre d’un autre qui connaît votre véritable nom et vous appelle à l’existence, à « naître avec ». C’est même la seule manière de se connaître. Chacun possédant en quelque sorte la clé de l’autre, l’amour fût-il humain ou divin vise l’éternité. Cependant, le chemin n’est pas tracé d’avance, l’amour peut parvenir à sa réalisation, sexuelle ou pas, mener à la joie ou à la souffrance — en ce monde.
Un autre monde existe pour le poète, le sur-naturel — aussi réel que l’autre — avec lequel il va lui falloir s’arranger, s’ajuster, composer, dans la vie comme dans son théâtre.
Une voie, délaissant le sexuel, est attendue pour la réalisation de l’amour claudélien qui est véritablement une fusion des âmes promise à l’éternité, à ceci près que l’âme n’appartient pas à celui qui voudrait la donner.
Par conséquent, le passage de l’une à l’autre modalité de l’érotique claudélienne s’obtient par un sacrifice et implique la mort (« plus loin que la vie », « laisser le corps en arrière quelque peu »). La mort et l’immortalité ne sont pas contradictoires, « l’immortalité s’obtient au prix du passage par l’identification avec un dieu qui meurt6 . »
L’au-delà, première ou seconde mort, chez Lacan, n’implique pas cette immortalité, autant le noter tout de suite.
Le sacrifice claudélien va prendre diverses colorations au fur et à mesure de l’évolution des personnages au cours de l’œuvre théâtrale. Atroce dans L’Otage, au point de poser la question du salut de Sygne de Coûfontaine, il sera Joie dans Le Père humilié puis, dans Le Soulier de satin, délivrance des âmes captives.
Dans la préface de Claudel à l’édition en 1948 de Partage de Midi, on peut lire :
La chair, selon que nous en avons reçu avertissement [L’avertissement provient de saint Paul] désire contre l’esprit, et l’esprit désire contre la chair. Le premier aspect de ce conflit a fait l’objet de toutes sortes de poëmes [sic], romans et drames. Mais, d’autre part, est-il sûr que la cause de l’esprit qui désire contre la chair ait jamais été plaidée dans toute son atroce intensité, et, si je puis dire, jusqu’à épuisement du dossier7 ?
Il ne s’agit pas d’un conflit duel.
Comme le dit Sara Vassallo : « La chair est bonne et mauvaise, elle lie l’homme à l’esprit et l’en sépare. Bref elle est volonté divisée8 .» L’esprit est incarné dans le corps et le corps ne va pas sans l’âme. Les termes âme corps chair esprit se combinent chez saint Augustin mais aussi bien chez Claudel, sans parler de la volonté divisée. Ajoutons ici le Verbe, le Verbe fait chair.
Le terme chair procède d’incarnation. L’Evangile de saint Jean le dit ainsi : « Le Verbe s’est fait chair .» Lacan évoque à maintes reprises le tout début de la phrase, c’est-à-dire le commencement : « Au commencement était le Verbe, ce qui veut dire le signifiant9 .» Il paraphrase : « Au commencement de l’expérience analytique fut l’amour10 .» Il ironise :
S’il n’y avait pas le Verbe qui, il faut bien le dire, les fait jouir, tous ces gens qui viennent me voir, pourquoi est-ce qu’ils reviendraient chez moi, si ce n’était pas pour à chaque fois s’en payer une tranche de Verbe ?
De là procède le drame :
C’est quand le Verbe s’incarne que ça commence à aller vachement mal. Il [l’être charnel] ne ressemble plus du tout à un petit chien qui remue la queue, ni non plus à un brave singe qui se masturbe. Il ne ressemble plus à rien du tout, il est ravagé par le Verbe11.
L’Otage
Ce ravage (issu du Nouveau Testament, il n’était pas dans la tragédie antique), est ce que manifeste de façon exemplaire la figure de Sygne de Coûfontaine dans L’Otage.
Dans la tragédie de Sophocle, Œdipe à Colone, Œdipe maudit son destin, par le truchement du Chœur, (me phunaï, puissè-je n’être pas né), en effet, une malédiction a pesé sur sa naissance en raison de la faute commise par son père, « c’est de l’Até qui le précède qu’il est coupable12 », et de plus il ne savait pas, ni qu’il tuait son père, ni qu’il couchait avec sa mère. Sa fille Antigone obéit à son tour au destin tragique qui lui échoit.
Mais l’héroïne chrétienne est accablée d’un malheur plus grand que celui de ces héros antiques. Elle aussi est porteuse d’une charge venue des générations qui la précèdent, son nom de Coûfontaine l’inscrit dans une lignée qui implique des droits et des devoirs et donne sens à sa vie. De là son engagement de foi et d’amour envers son cousin. Elle explicite comme une alternative, l’alliance ou la fusion éternelle des âmes :
Coûfontaine je suis à vous ! Prends et fais de moi ce que tu veux.
Soit que je sois une épouse, soit que déjà plus loin que la vie, là où le corps ne sert plus,
Nos âmes l’une à l’autre se soudent sans aucun alliage
Laisse-moi donc renoncer à l’avenir !
Laisse- moi prêter serment comme un nouveau chevalier…
Jurer comme une nonne qui fait profession13 !
C’est là un sacrifice consenti prenant en compte ce qui arrive, la perte du futur impliquée par la mort des enfants pour lesquels Sygne reconstituait le patrimoine familial. Sauf qu’elle pourra ne pas tenir sa promesse, elle va se refuser à cet héritage-là.
C’est cet accomplissement même de son destin que Sygne va trahir, en le sachant, sacrifice au second degré, sacrifice du sacrifice. Lacan donne à ce refus abyssal le nom de Versagung. Il avait déjà introduit ce terme dans un autre contexte en le traduisant par la notion de dénonciation au sens où on dénonce un traité, il disait aussi « promesse et rupture de promesse14 ». Sygne va renoncer à honorer la dette même dont elle est chargée et, qui plus est, librement. Le Dieu du destin est mort, dit Lacan. Sygne exercera donc son libre arbitre en renonçant à l’engagement qu’elle vient de prendre et en épousant l’abominable Turelure, « le boucher de 93 », pour sauver le Pape retenu comme otage sous son toit.
Lacan :
À l’héroïne de la tragédie moderne il est demandé d’assumer comme une jouissance l’injustice même qui lui fait horreur.
Tel est ce qu’ouvre comme possibilité devant l’être qui parle le fait d’être le support du Verbe au moment où il lui est demandé, ce Verbe, de le garantir. L’homme est devenu l’otage du Verbe parce qu’il s’est dit ou aussi bien pour qu’il se soit dit que Dieu est mort15.
Dieu a besoin de sa créature. Le confesseur Badilon le fait entendre à Sygne. « Dieu n’est pas au-dessus de nous mais au-dessous 16», Dieu ne peut rien sans nous.
Sygne est invitée à s’identifier avec un Dieu qui, s’étant fait chair, est mort sur la Croix pour le salut des hommes.
Mais au dernier acte, Sygne se jette au-devant de la mort et dit non au pardon, non à l’enfant qui vient de naître. Refus du refus du refus, mise en abyme vertigineuse, Per-diction. Son salut est mis en question au point que Claudel invente une variante où l’ultime « dire non » de la sacrifiée ne portera pas sur l’adsum de sa devise. Dès lors, tout est épuisé, il ne s’agira plus de ne pas vouloir mais de ne pas pouvoir. Claudel avait constaté qu’aucune des forces en présence et pas même Dieu n’a le champ complètement à elle.
Le Père humilié
Dans la dernière pièce de la Trilogie, Le Père humilié, à la troisième génération renaît le désir, Pensée, la petite fille de Sygne dira oui à l’amour, au pardon, à l’enfant. Elle est fille de la juive Sichel et de Louis de Coûfontaine, alors ambassadeur de France dans une Italie en révolte. Pensée est aveugle. En même temps qu’elle est objet de séduction, elle incarne une figure sublime de la pudeur, elle est l’objet du désir. Elle prône une justice absolue aux antipodes de toute prêcherie religieuse.
Les frères de Homodarmes, neveux et soldats du pape, sont tous deux amoureux d’elle. Orian l’aîné est conquis alors qu’il entreprenait de se faire auprès de la jeune fille le messager de son frère Orso. Lequel Orso, un temps engagé chez les Garibaldiens, a toute confiance en ce grand frère qui l’a ramené dans le giron.
Pensée a porté son dévolu sur Orian, celui qui, aimant Dieu comme un sauvage, incarne l’impossible, celui qui refuse cet amour (Pensée est pour lui danger, fatalité).
Chacun d’eux se veut prêt à sacrifier cet amour à son frère, Orso parce qu’il a compris que c’est Orian l’élu, Orian parce qu’il lui faut mettre un irréparable entre la jeune fille et lui. Ils prennent alors conseil auprès de Pie, le pape, le Père.
Le pontife consulté ramène Orian, son fils préféré, vers sa vocation sacerdotale qui est d’apporter la Joie au monde. Ce qu’il sait être vocation à un amour de l’universel et non du particulier17.
Tu n’iras pas avec Dieu avant d’être débarrassé de ce que tu dois aux hommes ;
C’est pourquoi je mets cet Orso entre le bonheur et toi18.
Orian le saint (c’est Lacan qui le nomme saint) n’est pas fait pour ce bonheur-là, il a une idée de l’ascèse requise pour un désir plus fort, qu’il énonce comme une nécessité :
Il est nécessaire que je ne sois pas un heureux ! Il est nécessaire que je ne sois pas un satisfait !
Il est nécessaire que l’on ne me bouche pas la bouche et les yeux avec cette espèce de bonheur qui nous ôte le désir19.
« Cette espèce de bonheur qui nous ôte le désir » est une définition de la première analytique claudélienne. On y entend aussi la triade lacanienne besoin demande désir.
Orian a d’autres mots encore pour mettre en évidence les deux voies de l’érotique, qu’il désigne comme étant l’une du bonheur et l’autre du désir :
Je savais trop que ce que je vous demandais, vous étiez bien incapable de me le donner [seconde analytique], et que ce qu’on appelle l’amour, [première analytique]
C’est toujours le même calembour banal, la même coupe tout de suite vidée, l’affaire de quelques nuits à l’hôtel, et de nouveau
La foule, la bagarre ahurissante, cette affreuse fête foraine qu’est la vie, dont cette fois il n’y a plus aucun moyen de s’échapper
Et je sais les grands et incomparables liens que le mariage apporte
Mais je sais aussi que c’était tout autre chose, incompatible avec tout que demandait un désir comme le mien20.
Le refus d’Orian a une forme particulière.
Le bonheur, la satisfaction immédiate, dans ce dialogue relève de la première analytique. Ce qui s’en distingue alors porte le nom de joie (gaudium), d’où dérive en français le terme « jouissance » ainsi que l’explicite Jacques Le Brun21. Il s’agit là d’une notion à valeur théologique, ce bien qui s’acquiert par des sacrifices relève de la seconde analytique.
Le désir d’Orian (« un désir comme le mien ») aspire à cette « joie », comme une possession à visée d’éternité, ce qui fait dire à Lacan que le saint est un riche et se déplace dans le domaine de l’avoir. Sauf qu’il ne peut pas donner son âme puisqu’il ne la possède pas.
C’est ainsi qu’Orian argumente sa résolution de laisser la place à son frère. Il méconnaît que ce qui lui est demandé dans l’amour est ce qu’il n’a pas.
Il ne peut aimer Dieu que comme un nom de sa jouissance, et sa jouissance, au dernier terme est toujours assez monstrueuse22.
À Orso donc, le bon petit soldat, d’aller vers la voie du mariage. Et lui, quand bien même il sait n’être pas le préféré, espère conquérir la jeune femme.
Sauf que les choses ne se passeront pas ainsi. Pensée ne se laisse pas déposséder de son désir à elle, note Lacan, elle accroche son Orian au passage, Lacan ironise sur le désir « plus fort que la sainteté ». Avant de partir à la guerre, Orian connaîtra l’humilité de « l’insecte mâle qui n’est réglé que pour une heure23 ».
Au dernier acte, Pensée sent son enfant bouger en elle pour la première fois lorsqu’elle se penche, étendant les ailes de son manteau, sur une corbeille de tubéreuses. On va apprendre que c’est Orso qui lui a fait ainsi parvenir, dans le terreau de ces fleurs capiteuses, le cœur éviscéré de son amant Orian, son époux mystique, mort au combat. Anamorphose, capture de l’âme, vampirisme, l’image figurée de cette transmission des âmes est ici encore celle d’une femme crucifiée. Orso arrive bientôt, messager de son frère, il demande à Pensée, de la part du mort, qu’elle pardonne, qu’elle vive, qu’elle l’épouse lui. Et comme elle a un mouvement de recul, avant de consentir, il lui laisse entendre qu’elle doit se soumettre :
Il faut sauver le nom de l’insulte, comme on sauve le drapeau24.
Il s’agit seulement de donner un nom à l’enfant qui va naître. Lui repartira se battre en France et apportera à son frère le message qu’à son tour Pensée lui délivre, c’est-à-dire son âme qu’elle lui souffle dans la bouche.
C’est ici que Lacan réveille son auditoire :
Ne riez pas trop de ce connard, c’est un piège25…
Et plus loin :
Ce pauvre Orso qui nous fait sourire jusque dans cette fonction où il s’achève, de mari postiche, ne nous y trompons pas, ne nous laissons pas prendre à son ridicule, car la place qu’il occupe est celle-là même en fin de compte dans laquelle nous sommes appelés à être ici captivés26 .
Qu’est-ce à dire ?
Le piège serait de faire à propos de Claudel de la psychologie. Dire par exemple d’Orso ou aussi bien de Claudel, pourquoi pas, que c’est un grand refoulé ? C’est une bêtise. Ces personnages de théâtre sont à accueillir comme des figures, des symboles, c’est du moins ainsi que Lacan reçoit le mythe claudélien, une création qui peut nous servir pour situer la place de l’analyste dans le transfert en tant que « nous entrons pour quelque chose dans le destin du sujet27 ».
Là il s’agit de l’analytique de l’inexistant rapport sexuel. Le terme mis en avant à cet endroit est Versagung. Déjà avec Sygne il s’agissait d’un dire non abyssal, per-diction, un refus portant sur le dit. La Versagung est dans le registre du sagen, le dire, c’est l’émergence du signifiant en tant qu’il permet au sujet de se refuser.
Et Lacan évoque une Versagung originelle. Il indique au passage l’équivalence de cette notion de Versagung originelle avec le fait qu’il n’y a pas de métalangage, car dès que l’on parle, tous les effets de la parole sont engagés. La Versagung (terme parfois mal traduit par frustration) est un registre dans lequel « nous » opérons, selon plusieurs textes de Freud consacrés au maniement du transfert. Il y a là une forme spécifiée de refus, non pas refus d’amour mais de la satisfaction d’amour demandée dans le transfert où « nous nous dérobons », où nous nous faisons absent dans la présence même. Et de cette Versagung spécifiée nous sommes les messagers. Et voilà pourquoi le messager Orso ne nous fait pas rire, il occupe dans cette histoire claudélienne une place d’où il va au terme disparaître, troumatisme, analytique célibataire.
Le saint, le héros ne sont là que des supports pour repérer notre position. Et en effet quelques années plus tard, Lacan fait apparaître (à la Télévision ?) une tout autre figure de saint, plus affine avec la position de l’analyste. Celui-là est rebut de la jouissance, (« macache pour lui ») il décharite. Et comme « plus on est de saints plus on rit28 », Claudel lui aussi en présente plus d’une figure.
Le Soulier de satin
On aurait parfois le sentiment que Claudel plaisante avec Lacan :
Claudel :
Quel plus noble sujet d’inspiration que ces grands hommes qui, pendant toute leur vie, n’ont fait autre chose qu’enseigner le mépris des richesses et le respect de l’État29.
Lacan :
Un saint durant sa vie n’impose pas le respect que lui vaut parfois une auréole30.
Claudel :
[Les saints] maintenant au ciel, fonctionnaires perpétuels, partagent avec le soleil et la lune les honneurs du calendrier…31
Lacan
Ne peut-on pas renverser les choses ? – Et dire que les saints sont des administrateurs, les administrateurs de l’accès au désir32.
Des saints se manifestent diversement dans Le Soulier de satin.
Au début de la troisième journée, quatre saints évêques plutôt baroques viennent tour à tour tenir un monologue avant de rejoindre leur piédestal dans la cathédrale de la Mala Strana à Prague. Chacun affublé de symboles. Ce sont des personnages surnaturels qui sont là pour la délectation du spectateur. Claudel lâche ici la bride à son imagination poétique. Ainsi le dernier se nomme saint Adlibitum, (ad libitum, à volonté, au choix, de libere désirer) une des facéties de l’auteur. Introuvable dans le calendrier et pas non plus dans Voragine… « Précédé d’une sorte de Nymphe aux cheveux verts entremêlés de roseaux et tenant une rame dorée 33», son allure est bien païenne !
On trouve ensuite dans la quatrième journée Don Rodrigue, sur la mer, vieilli et grisonnant ; il a une jambe de bois, il est devenu marchand d‘images qui sont des « feuilles de Saints34 » très prisées par les pêcheurs. Il décrit des personnages hauts en couleurs, extra-ordinaires, campés dans des scènes fantastiques, qu’un Japonais, près de lui, réalise et grave. Et quand le Japonais lui demande :
Dites-vous que tous ces Saints sont des images de vous-même ? Don Rodrigue répond : Ils me ressemblent bien plus que je ne le fais à moi-même avec ce corps flétri et cette âme avortée35.
Claudel a rapproché le sujet du Soulier de satin d’une légende chinoise où
[…] deux amants stellaires, chaque année après de longues pérégrinations arrivent à s’affronter, sans jamais pouvoir se rejoindre, d’un côté et de l’autre de la Voie lactée36.
Rodrigue et Prouhèze sont possédés par un amour réciproque et un désir qui les pousse irrésistiblement l’un vers l’autre en même temps que l’union des chairs leur est interdite, Prouhèze est mariée, ce sacrement ne peut être défait, et l’adultère est impossible.
Alors une autre forme de sacrement s’invente, ils se sont dit : Non l’un à l’autre en cette vie, en un sacrifice sublime, réalisant « entre eux un véritable mariage dont la forme est non pas un oui mais un non, un refus donné à la chair dans l’intérêt de l’étoile37 ». Versagung, ce consentement à l’étoile est réitéré au cours de la pièce à chaque fois que les amants sont sur le point de se rejoindre par-delà les océans qui les séparent.
C’est par ce sacrifice qu’ils vont pouvoir s’apporter la Joie car : « C’est la joie seule qui est mère du sacrifice38 ». Et il est dit aussi que « On ne possède point la joie, c’est la joie qui te possède ». Prouhèze meurt pour accomplir le sacrifice : « Si nous allons vers la joie, qu’importe que cela soit ici-bas à l’envers de notre approximation corporelle 39. »
Rodrigue va encore vivre quelques aventures jusqu’à la toute dernière scène.
Il avait déjà perdu une jambe, un membre autrement dit… et sans regret ! puis à la fin il a tout perdu à moins que ce ne soit les choses qui l’ont abandonné. On le retrouve prisonnier enchaîné sur un bateau, en compagnie d’un moine et de deux soldats. Condamné comme traitre, ce qu’il n’est pas. Il a été vendu à ce soldat bête et méchant qui le nargue. Le moine a marié Prouhèze autrefois. Lui seul peut comprendre ce qu’il vient à ce Rodrigue mis aux fers de dire à la vue du ciel et des étoiles :
Oui, c’est une belle nuit pour moi que celle-ci où je célèbre enfin mes fiançailles avec la liberté40 !
Alors arrive la sœur glaneuse, celle qui ramasse « les déchets, les rognures, les balayures, ce qu’on jette, ce que personne ne veut », Rodrigue lui demande qu’elle le prenne lui avec les vieux drapeaux et les pots cassés et il s’ensuit un marchandage entre la chiffonnière qui charrie un peu et le soldat. Il vaut si peu qu’elle exige en plus une espèce de chaudron en fer.
Cette scène est une réplique joyeuse de la scène finale du Pain dur où le crucifix de bronze est ainsi mis à l’encan de manière sarcastique. Rodrigue devenu déchet laisse place à la délivrance de l’âme, il décharite41, libre enfin. Et il importe de remarquer que cette scène triomphale de la fin du Soulier de Satin fait exister en même temps l’évocation du déchet (qui ramène à l’analytique du petit a) et la liberté conquise (de l’absence de rapport sexuel).
Jean Allouch à propos du maniement du transfert dans l’exercice analytique :
Prendre comme guide le déchariter dans son lien avec la liberté érotique de l’analysant et donc le manque du rapport sexuel offre un biais plus accessible pour situer tout à la fois l’intervention de l’analyste et son possible effet libérateur. Car, oui, il n’est pas exclu et parfois même aisé de savoir si une intervention de l’analyste s’adresse ou non à la liberté de l’analysant42.