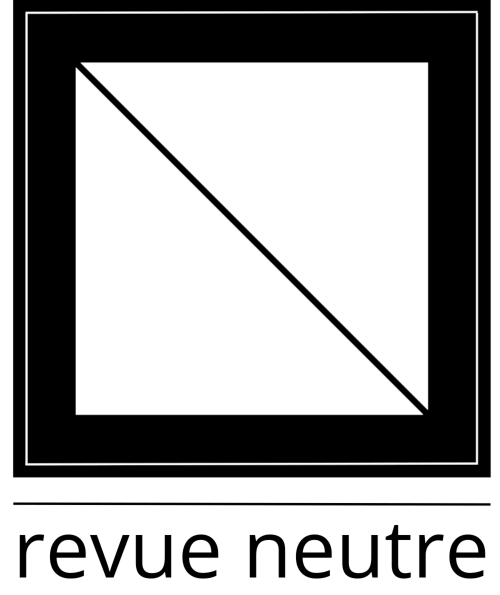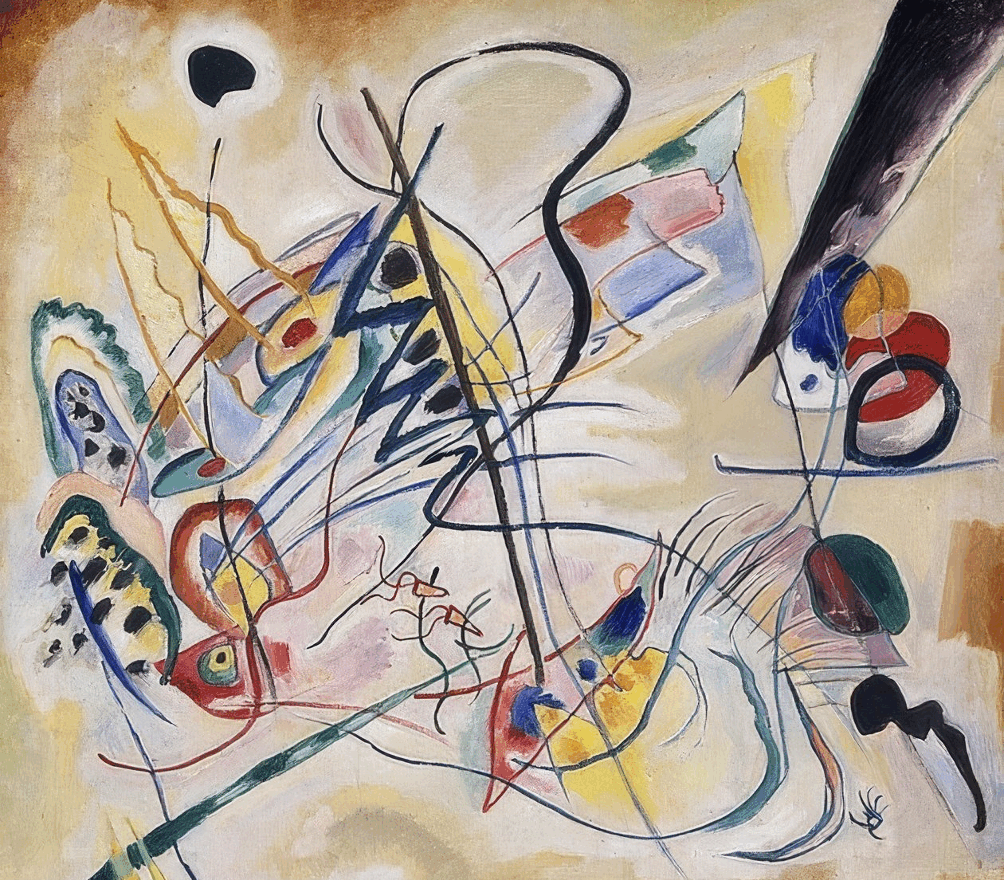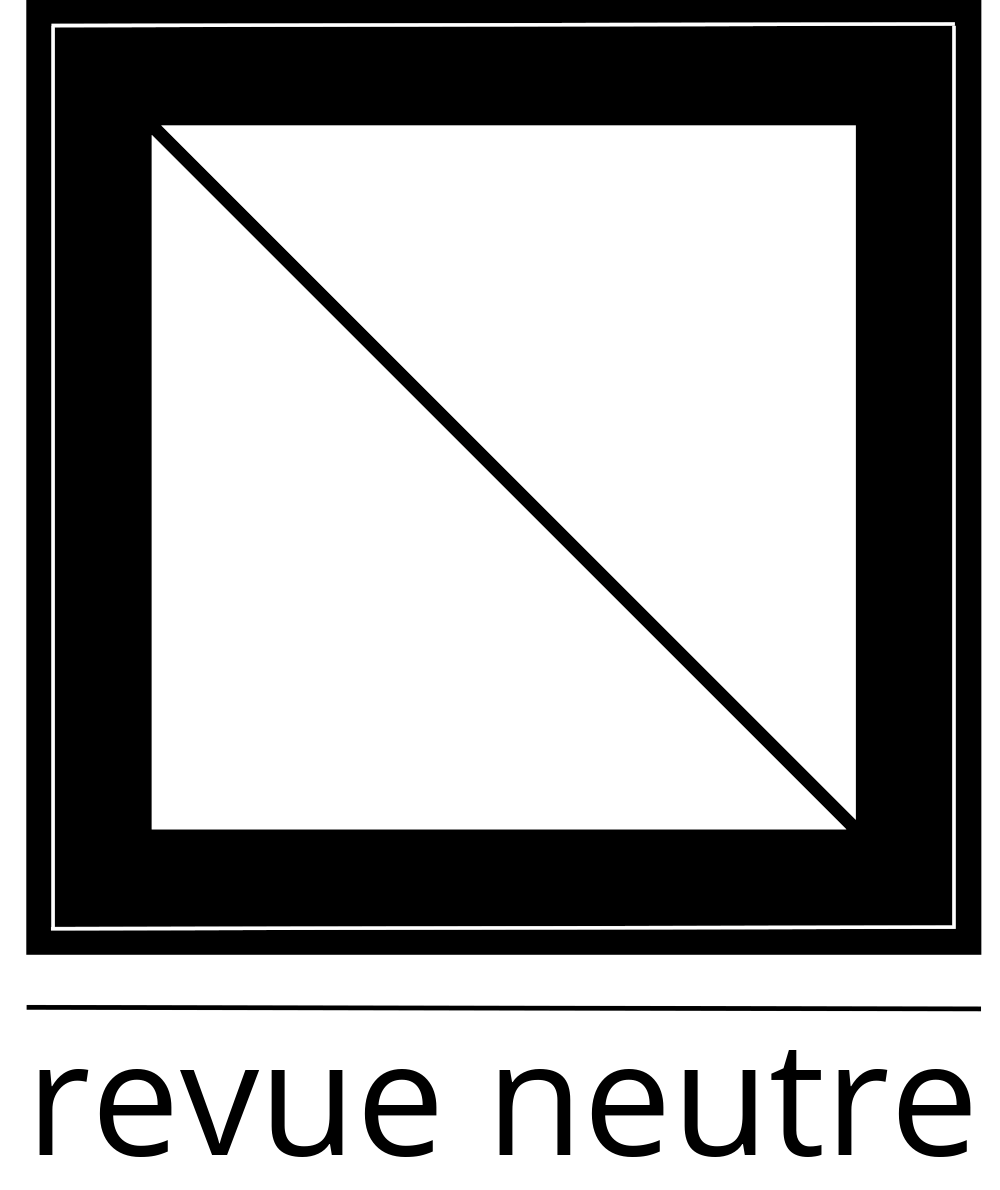TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE
Sur l’affaire Lancelin/Papin : Acheronta movebo1
Guy Casadamont
À revisiter aujourd’hui le crime des sœurs Papin, serait-on amené à […] discriminer, dans leur geste, tout à la fois un saut épique et un passage à l’acte ?
Jean Allouch2
Pour la revisitation de cette « affaire » appui sera pris de la méthode freudienne rappelée par S. Freud à l’encontre des adversaires de la psychanalyse, dans un texte de 1923 :
Contre la psychanalyse s’élève de nouveau le reproche qu’elle complique de manière pointilleuse des rapports simples, qu’elle voit des mystères et des problèmes là où ils n’existent pas et qu’elle arrive à cela en accentuant à l’excès de petits traits accessoires, tels qu’on peut en trouver partout, et en les élevant au rang de vecteurs des inférences les plus poussées et les plus étranges. Les adversaires diront que ces analogies et corrélations n’existent justement pas, mais qu’elles sont introduites par nous dans le cas avec une perspicacité superflue3.
Alors avançons à pas lents en continuant à accentuer « à l’excès des petits traits accessoires ». Dit autrement, soyons excessif.
Penchons-nous sur la déposition, non pas procès-verbal d’audition mais déposition écrite pour le juge d’instruction dont chaque mot a été manifestement pesé de René Lancelin, 63 ans, mari de Léonie et père de Geneviève Lancelin, juriste, ancien avoué.
L’étonnante et unique déposition pré-écrite de René Lancelin (11 février 1933)
Les sœurs Christine et Léa Papin à notre service depuis environ sept ans […] nous ont toujours donné du point de vue service, satisfaction entière4. […]
Pendant tout le temps où nous avons habité Place de la Préfecture nous n’avons eu qu’à nous louer de ces filles qui voyaient leur mère et sortaient avec elle.
Le seul ennui était que Mme Papin [divorcée de Gustave Papin, elle est Clémence Derée] revenait trop souvent à la charge pour demander des augmentations de gages. […]5.
En octobre 1929, les sœurs rompent avec leur mère.
Lancelin :
Cette brouille avec la mère a aigri certainement le caractère des filles qui sont devenues sombres et taciturnes. Depuis cette époque, ni ma femme ni moi nous n’échangions de conversations avec elles en dehors des besoins du service6.
Contrepoint, de son côté Erik Porge note dans une revue à l’existence improbable, qu’à cette date Christine et Léa « rompent, sans heurt, avec leur mère7. »
Sous les Lancelin, régime de maîtrise domestique de croisements à cinq sur fond de silence de plomb sous le même toit qui ne peut être le même, au 6 rue Bruyère, au Mans.
L’embrouille à la Mairie du Mans
Fin août ou début septembre 1931 est l’année de ce que l’on a appelé « L’incident de la mairie8 », que l’on pourrait aussi appeler « l’embrouille à la Mairie ». Francis Dupré cite le journal La Sarthe du 5 février :
Il y a deux ans, les sœurs Papin qui avaient pris la précaution de revêtir leurs belles toilettes, ayant aux mains de longs gants blancs, se présentèrent dans le cabinet de M. Arsène Le Feuvre, qui a cette époque était maire du Mans.
Elles tinrent devant lui d’étranges propos, accusant plusieurs personnes de les poursuivre et de les persécuter9.
Les poursuivre de quoi ?
Qu’ont-elles dit à trois autorités locales saisies chacune ce même jour ? Là les mémoires flanchent. Le maire, le secrétaire général de mairie et le commissaire central de police auquel le maire a finalement adressé les deux sœurs (pas moins) ne se souviennent pas des propos tenus par Christine Papin.
Quelques décennies plus tard, qui chronique ce moment pour le journal Libération du 20 décembre 2000, à l’occasion de la sortie du film de Jean-Pierre Denis, Les blessures assassines retient ceci : « […] elle [Christine] accusait leurs patrons de les persécuter et de les séquestrer10 ».
Ambiguë déposition de Lancelin sur ce point :
Il y a environ dix-huit mois, elles ont accusé M. Lefeuvre, Maire du Mans, de je ne sais trop quoi [nos italiques] et l’ont menacé à la mairie. M. le Commissaire Central m’a mis au courant de cet incident qui s’était produit pendant une de nos absences. Quand j’ai été de retour, il m’a dit que mes domestiques lui avaient paru toutes deux fort exaltées ; mais je ne me souviens pas qu’il m’ait conseillé de ne pas les garder à notre service11.
Le 21 mars, le Commissaire de police du Mans dépose en des termes… contraires :
M. Lancelin ne contesta pas qu’elles étaient un peu bizarres mais ajouta quelles donnaient entière satisfaction au point de vue service, qu’il ne pouvait les renvoyer [cet impouvoir est-il une impuissance soit un pouvoir ne pas les renvoyer.] Je me suis permis de dire : si j’avais des domestiques de ce genre, je ne les garderais pas longtemps.
J’avais en effet à ce moment-là, l’impression que les sœurs Papin avaient quelque chose d’anormal qu’elles se croyaient persécutées [croyance sans fondement ?]. Quand M. Lancelin quitta mon cabinet je vis bien qu’il avait toute confiance en ces deux jeunes filles12.
Le président des assises pose cette question à Christine :
— Au mois de septembre 1931, vous et votre sœur êtes allées trouver le maire du Mans. Pourquoi ? Qu’aviez-vous à lui demander ?
— Christine : C’était pour un acte de naissance13.
Une naissance ?
Plus loin, R. Lancelin dans sa déposition :
Je ne me suis aperçu d’aucun changement dans leur attitude depuis cette époque [1931] — si ce n’est peut-être [nos italiques.] une aggravation de leur mutisme — mais je ne crois pas que dans les derniers mois qui ont précédé leur crime14, elles aient reçu la moindre observation désagréable de ma femme, ni de ma fille.
Soit, mais alors … ?
Il poursuit :
Les ordres leur étaient donnés par ma femme, le matin lorsqu’elle remettait à Christine l’argent nécessaire ; je crois qu’elle ne leur parlait plus guère le restant de la journée. […] Quant à la femme de chambre, Léa qui naturellement [sic] se trouvait davantage dans les appartements, les ordres lui étaient donnés, au fur et à mesure des besoins et je n’ai jamais entendu la moindre récrimination de sa part15.
Puis, cette déclaration récapitulative :
Nous avons traité les domestiques avec beaucoup d’égard16 :
Elles avaient toute liberté compatible avec le service et les usages admis. La cuisinière sortait tous les jours pour les approvisionnements et restait dehors une heure, une heure et demie sans qu’on lui ait jamais fait d’observation sur le temps qu’elle mettait à faire ses courses17. […]
Depuis deux ans environ, [février 1931] leurs sorties du dimanche sont devenues plus rares sans qu’elles aient donné de motifs18. […]
Nos habitudes étaient très réglées19.
Observations de René Lancelin à propos de Léa :
Intelligence bornée [laquelle ne l’est pas ?] — acceptant toujours les observations sans rien dire et faisant mécaniquement son travail et ne cherchant jamais à faire conversation avec ses maîtres [René Lancelin laisse poindre ici un désir de… « faire conversation » avec Léa]. Ma femme la commandait très doucement [nos italiques] et jamais je n’ai entendu de sa part un mot plus haut que l’autre20 [tous également hauts ?]. […]
Puis, cet étrange constat :
Physiquement, [Léa] avait depuis quelque temps maigri et se rapprochait de plus en plus comme ressemblance de sa sœur aînée [la sœur aînée de Christine et Léa, Emilia, vient d’être méconnue par le maître de maison].
Curieusement, René Lancelin délivre un remarquable certificat de… moralité aux sœurs Papin :
Nous n’avons jamais rien remarqué qui puisse laisser supposer qu’elles aient une mauvaise conduite, ni même légère. Aucune visite suspecte, aucune correspondance [surveillance de la correspondance ?] n’a jamais été surprise. Lorsqu’elles sortaient elles étaient toujours mises, plutôt avec élégance, et paraissaient aimer la toilette. […].
Nous n’avons jamais rien remarqué d’anormal dans leur vie privée, ni dans les relations qu’elles pouvaient avoir entre elles21.
Comment ne pas lire en filigrane cette déposition comme un plaidoyer pro domo — comment dire mieux ? — relatif à une domesticité déclarée parfaite côté maîtres et aussi côté domestiques dans la maison Lancelin de telle sorte que le maître n’a nul grief à articuler contre les deux sœurs et d’ailleurs… elles non plus. Souveraines sœurs Papin ?
Tout serait donc le meilleur des mondes dans la domesticité Lancelin/Papin.
1960/1963, une correspondance entre confrères
Préparant une étude sur l’affaire Papin, Louis Le Guillant, médecin-psychiatre à l’hôpital psychiatrique de Villejuif, écrit le 21 avril 1960 à son confrère et ami Pierre Schützenberger premier expert commis par le juge d’instruction, afin de se documenter sur l’affaire, puis trois ans plus tard, une autre lettre le 25 novembre 1963, — il en résultera un article publié dans la revue Les Temps Modernes en novembre 196322. Schützenberger lui écrit le 10 décembre 1963 évoquant, je cite, « cette période d’il y a presque 20 ans23 ! ». Presque vingt ans ? Non, trente : 1933/1963. Quelque chose aurait-il été vain dans l’expertise des médecins ?
Un évènement d’archive se produit ! Isabelle Bedouet reçoit par la poste et venant d’une belle-fille de Schützenberger, — Anne Ancelin-Schützenberger — des archives de son beau-père sur l’affaire Papin dans lesquelles on peut lire ceci après qu’il ait lu l’article de Le Guillant paru dans Les Temps Modernes :
Tu feins de critiquer (bien légèrement) les experts mais tu ne pouvais dire leur opinion vraie que (pour deux au moins) ils avaient tu… notre « commission » car nous étions en 1934 encore dans le règne de ce que Guiraud appelait plaisamment la « paléo-psychiatrie » ne faisait aucune allusion à l’explication psychologique du crime et ce domaine était fermé à nos investigations officielles… [ah bon… ?]
L’expert « chevronné » Truelle24 en connaissait un bout comme on dit, mais les affaires Gorguloff/Doumer et Violette Nozière où il avait eu bagarre l’avaient incité à une prudence extrême et à ne « pas sortir du cadre de sa mission »… dans cette affaire où
les magistrats par solidarité avec Lancelin l’avoué, […] n’avaient25 aucun intérêt à dire si les Lancelin avaient été humaines… si la condition de bonne n’avait pas été ce qu’elle était dans cette affaire… donc le bon Truelle n’avait aucune envie de soulever le rideau de la vie privée Lancelin […] personne n’a voulu y prêter attention et c’est pourquoi il s’est tenu à l’écart et n’a pas répondu à des questions qu’on ne lui posait pas, si nous avions évoqué le vrai motif26 quel tollé aux assises, excuser les Papin c’était gratuitement [sic] porter ombrage aux (bourgeoises) victimes…
Nous nous souvenons très bien ma femme et moi que ce bon Truelle ait vu clair sur la haine et les motifs qui l’avaient inspirée manifestée par les Papin et sur le plan psychologique aurait peut-être constitué une excuse… mais en réalité tout cela était de la « bouffonnerie » c’était la défense de la société bourgeoise d’un des leurs par ses pairs… et les jurés campagnards suivaient… les Sarthois sont madrés [malins] et riches… […].
Oui Truelle et moi avons bien vu le vrai motif mais on ne nous le demandait pas et il eut été mal accepté que nous dérogions aux us de la justice, peut-être penseras-tu que nous aurions dû le faire mais je te dirai qu’en 1934 en province surtout on était les experts encore esclaves d’un certain conformisme… […]27.
On songe à Lacan citant Boileau : « Il n’y a pas de degré du médi-ocre au pire28. » Donc, ce « vrai motif » aurait été su et tu par au moins deux des trois médecins-experts.
De ce « vrai motif » l’instruction criminelle ne dira mot ; on remarquera que cette lettre en forme de semi mea culpa ne l’écrit pas non plus à un confrère et ami — le soulignement reste ici une forme vide de contenu.
Une lettre de l’aumônier de la prison adressée au premier expert commis
Il y a possiblement du neuf dans cette affaire Papin si l’on veut bien se pencher sur une lettre de l’aumônier de la maison d’arrêt du Mans, adressée trois jours après le drame, ce 5 février 1933, au Dr. Schützenberger premier expert commis dès le 3 février et le premier à visiter les sœurs Papin à la maison d’arrêt.
Voici cette lettre (manuscrite) :
Monsieur le Docteur,
Veuillez me permettre une suite à notre conversation de ce matin à la prison. Vous n’êtes pas de ce pays dont moi-même, y étant né, je ne suis que par un seul de mes quatre grands-parents. Voici deux dictons locaux qui pourraient vous donner quelques lumières sur la singulière mentalité du cru « pur jus ».
Mauciau, combien ton viau ?
— Deux mois.
— Quel âge a-t-il ?
— Dix pistoles
— Bonjour, Mauciau.
— Mauciau, j’fauche,
— Pour qui fauches-tu ?
— J’gagne un écu.
[…]
Ce petit renseignement psychologique, dont vous pourrez vérifier la valeur par l’expérience, vous aidera au besoin à comprendre l’incompréhensible [pas moins]. Certainement on est loin ici d’un paradis terrestre [quel rapport ?].
Veuillez agréer, Monsieur le docteur, en attendant le plaisir de nous rencontrer à nouveau, l’expression de mes sentiments respectueux.
J.-M.-C. Verseux
Aumônier de la prison depuis 15 ans29.
Sur quoi Isabelle Bedouet écrit : « Une vérité inconvenante à révéler ? Tout est envisageable30 ». Puis, elle va à la ligne et… passe à autre chose, n’envisageant rien31.
Dans un texte préparé pour le 1er Congrès de l’École lacanienne de psychanalyse (Paris, le 17 novembre 1985) portant pour titre « Destitution subjective » Jean Allouch note que « c’est au faux que porte l’analyse, non au mentir-vrai cher à Aragon mais au parler-faux. Ce parler ne tient pas à la parole mais au langage32. » Jean Allouch tenait le parler-faux pour une modalité décisive du dire. Il lui est arrivé de relater que lors de sa passe33, il a fait fuir l’un de ses passeurs en lui parlant-faux. Parler-faux, c’est parler d’autre chose que de « la chose même » pour que celle-ci puisse s’entrapercevoir par le biais d’un déchiffrement.
Mon hypothèse est donc que l’aumônier de la prison a adressé au médecin-expert un texte chiffré. C’est à son chiffre qu’il s’agit d’accéder.
Dès lors, reprenons :
Mauciau, combien ton viau ?
— Deux mois.
— Quel âge a-t-il ?
— Dix pistoles
— Un viau = le veau, le petit de la vache et du taureau, âgé de deux mois ou en gestation depuis deux mois. Une période de temps est d’emblée précisée. On aura noté l’inversion, deux à deux, du jeu des questions et des réponses. Pour le plaisir du jeu ? Pour surprendre ? Pour intriguer ? Pour faire signe.
À la précision de l’âge est associé un coût en argent. On pourrait croire à un marché aux bovins, à une discussion entre un vendeur et un acheteur d’un veau âgé de deux mois. Le prix demandé est-il prix d’une vente possible du veau, ou le prix d’autre chose ?
Continuons.
— Bonjour, Mauciau.
— Mauciau, j’fauche,
— Pour qui fauches-tu ? [pas de réponse]
— J’gagne un écu. [prix de la fauche]
— « Bonjour Mauciau. » Qui est ce « Monsieur », dans l’histoire au plus effroyable du drame Lancelin ? « Mauciau, j’fauche », « Monsieur, je fauche ». Offre d’un faire, d’un fauchage. Faucher quoi ? Le veau âgé de deux mois ? Le veau à naître alors à deux mois de gestation ?
« Monsieur, je fauche. » Mais qui est ce « Monsieur » ? Celui que les sœurs Papin appellent… « Monsieur » ? S’agit-il alors de lire : « Monsieur Lancelin, je fauche. » Question du « Monsieur » tutoyant le faucheur : — « Pour qui fauches-tu ? » Oui, pour qui ? La discrétion commande que le « qui » ne soit pas nommé. D’où une réponse à côté : à le faire, « J’gagne un écu. »
Dans les parages du droit civil, le discours coutumier avance cet adage : Is fecit cui prodest : « Il l’a fait, celui qui en profite34. »
« Mauciau »/« viau », l’aumônier ne néglige pas les assonances. « Mauciau » écrit m a u c i a u, ces trois dernières lettres étant les mêmes trois dernières lettres que celles de v i a u, alors qu’est aussi d’usage l’écriture « mossieu », ainsi sous la plume de Clémence Derée dans une lettre du 7 août 1934 adressée au « Directeur Chef » de l’asile d’aliénés de Rennes35. Dans cet asile, Christine Papin sera finalement internée, elle s’y laissera mourir de faim, son décès survenant le 18 mai 1937.
On s’interroge : Le viau de Mauciau ? L’aumônier attire l’attention de son unique lecteur sur la portée de sa lettre, comme s’il lui disait : « Ne croyez pas que je vous parle d’un parler local en l’exemplifiant du marché des bovins ou d’une autre activité agricole. »
Relisons :
Ce petit renseignement psychologique, dont vous pourrez vérifier la valeur par l’expérience, vous aidera au besoin à comprendre l’incompréhensible. Certainement on est loin ici d’un paradis terrestre.
« Comprendre l’incompréhensible », l’enjeu de cette lettre du 5 février, trois jours après le drame, n’est pas mince, pour devoir ainsi se conclure. Loin d’un paradis terrestre, pour un prêtre ce doit être près d’un enfer terrestre.
Mon hypothèse, fragile comme toute hypothèse, David Allen aime à le rappeler, tient sur un fil, — mais peut-être est-ce un fil d’Ariane36 —, est que l’aumônier de la prison fait état dans cette lettre adressée à Schutzenberger futur rédacteur du rapport d’expertise, de quoi ?
D’un avortement pratiqué sur… Léa Papin faisant suite à un viol par le maître de maison.
En ce cas, et pour faire écho au titre de la traduction par Guy Le Gaufey du livre de John Forrester, Thinking in Cases, Si p, alors quoi ?37, la formule en serait exemplairement :
Si viol ancillaire — suivi de grossesse — suivie d’un avortement sous le toit Lancelin, alors… Alors quoi ? Alors l’enfer pour la famille Lancelin, Madame et Mademoiselle étant prises pour cibles ; la rupture avec « Monsieur » ayant été d’ores et déjà actée38, avec lui plus aucune conversation ne vaut.
C’est le moment de rappeler que Emilia (née le 12 février 190239), sœur aînée de Christine et Léa aurait été violée par son père Gustave alors qu’elle était âgée de 11 ans. La romancière mancelle Paulette Houdyer y revient à de multiples reprises tout au long de son livre40. Fixant une photographie des cadavres de Geneviève et Léonie Lancelin, Gérard Gourmel, chroniqueur judiciaire et pratiquant minutieux des archives judiciaires et policières écrit ceci :
Les deux femmes gisaient sur le plancher les jambes écartées. Leurs jupes étaient retroussées. Le pantalon de dessous, abaissé, portait les empreintes de mains sanglantes. Les chairs étaient dénudées et lacérées. Un trousseau de clés entre les genoux de l’une. S’imposent à l’esprit des actes de sadisme perpétrés après un double viol41.
Comme si se répartissaient deux viols dans l’histoire désormais dite Lancelin/Papin, Emilia et Léa victimes de viol et puis double viol sur la famille Lancelin, d’une mère et de sa fille, deux viols agis dans ce massacre annoncé à un moment du drame ; laissant Lancelin seul42.
Moments d’un geste
R. Lancelin fait état d’une « conviction », cela il le sait :
Ma conviction est que ces filles — sans aucune explication, ni provocation — ont dû se précipiter sur ma femme et ma fille [nos italiques] au moment où celles-ci gagnaient le palier du premier étage.
Elles devaient être embusquées sur les premières marches du 2ème étage et par conséquent ne pouvaient être vues par les personnes montant le [au] 1er étage43.
Il n’y a pas à douter de cette précipitation, engagement initial de l’attaque. Ambiance plus qu’électrique, exclusivement du côté des sœurs Papin. De cela Christine témoigne : « Une étincelle a jailli du fer et l’éclairage s’est éteint dans la pièce ou je me trouvais44. » Étincelle sur fond d’obscurité.
Le 12 juillet le juge interroge Christine :
Votre sœur, voyant Mme Lancelin sur le point de se relever, a dit qu’elle s’était précipitée sur elle, lui avait pris la tête et la lui avait heurtée sur le plancher ?
Christine : Je le lui avais dit.
Le juge :
Vous lui avez dit aussi d’arracher les yeux de Mme Lancelin, a-t-elle déclaré, ce qu’elle a fait aussitôt. Puis elle a frappé Mme Lancelin à la tête avec le pichet en étain dont vous vous étiez servie vous-même pour fracasser la tête de Mlle Lancelin après lui avoir arraché un œil.
C’est moi qui avais passé le pichet en étain à ma sœur après m’en être servi moi-même.
Pivotement subjectif, après les premiers coups portés :
Christine :
Voyant que je ne venais pas à bout de Mme Lancelin, je me suis mise en furie, [lire sans contradiction : elle est mise en furie] je lui ai enfoncé mes ongles dans les yeux et je les lui ai arrachés. C’est alors qu’elle est tombée45.
Le 2 février au soir, Christine répond en ces termes :
Ensuite, je suis descendue précipitamment à la cuisine et suis allée chercher un marteau et un couteau de cuisine ; avec ces deux instruments, ma sœur et moi, nous nous sommes acharnées sur nos deux maîtresses, nous avons frappé sur la tête, à coups de marteau et nous avons également frappé avec un pot en étain qui était placé sur une petite table sur le palier. Nous avons changé plusieurs fois les instruments de l’une à l’autre [nos italiques. Folle et en cela même rigoureuse coordination], c’est-à-dire que j’avais passé le marteau à ma sœur pour frapper et elle m’a passé le couteau, nous avons fait la même chose pour le pot d’étain46.
Le 12 juillet :
Le juge :
Ensuite, de cet usage du pichet en étain par vous et par votre sœur, on eût pu croire que votre fureur était apaisée, mais il n’en était rien. D’après votre sœur vous lui avez dit à ce moment dans un état de surexcitation extrême [nos italiques] : « Je vais les massacrer ».
Christine : Je ne m’en souviens pas [nos italiques47].
Considérons que cette amnésie n’est pas feinte, elle serait alors la marque d’un passage qui s’amorce, dans ce moment de pivotement subjectif, Christine n’étant plus co-agent de l’attaque initiale mais sujet au… crime lequel déploie son mouvement, sa conscience s’altérant, sa mémoire s’estompant.
Léa témoigne de ceci : « Ma sœur paraissait furieuse. Elle criait et respirait en soufflant bruyamment48. […] Ma sœur et moi nous poussions des cris au cours de la lutte49. »
Les deux sœurs se savent engagées dans une lutte à mort. Léa : « Comme ma sœur, j’aime mieux avoir eu la peau de nos patronnes, plutôt que ce soit elles qui aient eu la nôtre50. »
Les déclarations d’après-coup de juillet 1933 donnent l’impression d’une maîtrise celle qui relèverait du saut épique51, soulèvement52 sororal à l’endroit d’un intolérable sexuel (le viol) et sexué (l’avortement), pré-méditation et préparation. Schématiquement, on peut distinguer trois temps subjectifs. 1/L’attaque pot d’étain en mains est alors de mise, c’est le premier temps, les sœurs Papin aux aguets se sont précipitées sur leurs cibles leur fracassant la tête ; 2/ deuxième temps qui dans la procédure judiciaire s’écrit « ensuite », soit un moment de pivotement qui se dit par Christine : « Je vais les massacrer. » 3/ Troisième temps, les sœurs Papin s’armant plus encore (couteau et marteau) vont être précipitées plus qu’elles ne se précipitent. Non pré-méditation et fulguration, c’est ce que dans l’affaire Nozière (à un moment précis)53, est appelé « le passage du crime ». C’est « lui » qui passe — impersonnel — tandis que le sujet au crime en est le passeur ébloui, moment de désubjectivation accentuée.
Cela, Christine le déclare remarquablement au juge à sa façon : « Je vous assure que nous n’avons pas prémédité ce coup-là, s’il l’avait été il n’aurait certainement pas été si bien fait54. »
Hegel dans la longue Préface à la Phénoménologie de l’esprit (1807) lue par Jean-Luc Nancy : « Il n’y a pas de continuité du passage qui ne soit aussi bien déchirure d’un éclair55 ». Très bien, mais alors quoi passe dans la « déchirure d’un éclair » qui est un temps bref et précipitant d’éblouissement ?
Délirons quelque peu. Et si l’attaque initiale en tant qu’elle se sera prolongée d’un inutile massacre avait été le décalque mimétique sauvage des scènes du viol et de l’avortement, d’un faire (Christine et Léa auront parlé du fer à repasser et de sa panne) — passant et repassant ? Acharnement, a-t-on dit. C’est de chair meurtrie dont il aurait été question.
Le passage de la seconde analytique du sexe (un désir épique de vengeance effectif, armes par destination à la main) à la première analytique du sexe56 finalement poussée à son paroxysme, s’effectue tel un glissement à la Escher, dans une accélération foudroyante qui est ici celle de l’éclair57.
Dans cette affaire désormais Lancelin/Papin, il n’y avait plus place que pour une sainte colère et une vengeance armée qui iraient à leur terme celui de l’épuisement pulsionnel des porteuses et servantes du crime. Sainte colère et vengeance relatives au viol et à l’avortement planant au-dessus de cette attaque surprise pour ses/des cibles se prolongeant d’une fulgurance déclenchant en un éclair un massacre sans autre reste que celui de deux cadavres méconnaissables gisant au sol. Le passage du crime dans sa pointe extrême et terminale (première analytique du sexe) vient redoubler le motif (seulement parlé entre les sœurs) de l’épopée vengeresse (seconde analytique du sexe). En quoi nous croyons répondre à la question posée par Jean Allouch rappelée en exergue de cette présentation.
Christine dégrisée :
J’étais en furie, et ne me suis calmée qu’après les avoir frappées avec les objets saisis, avoir vu leur état [ce que donc, jusque-là elle n’avait pas pu voir] et tout le sang répandu58.
Quant à Léa, elle n’a rien à dire sur cette scène du théâtre judiciaire à quoi comme sa sœur elle se montre indifférente, c’est que les deux scènes qui comptent se sont jouées sous le toit Lancelin, la suite judiciaire est un « théâtre » dérisoire : Prosopopée Léa : « Je n’ai rien à (vous) dire. »
« Pour moi, je suis sourde et muette59. »
Christine, lors de l’interrogatoire du 12 juillet :
Je ne vous ai pas dit toute la vérité [la dire toute est impossible selon J. Lacan60] […] Je ne me rappelle pas bien d’ailleurs comment tout s’est passé61.
« D’où avaient-elles tiré cette énergie diabolique surgissant d’on ne sait où ? » interroge Francis Dupré62 qui s’abstient de répondre afin de ne pas rabattre un tel tirage, réservant un reste inexplicable63.
La formule virgilienne Acheronta movebo posée avec Freud et son accentuation par Foucault est comme la formule condensée du passage du saut épique (sainte colère agissante, seconde analytique du sexe) virant au passage du crime « lui-même » (première analytique du sexe) pour reprendre les termes de la problématique avancée par J. Allouch. Notons que préalablement à cet engagement du saut épique se trouve une condition possiblement suspensive de l’acte épique : « Si […] je ne peux fléchir les dieux d’en haut (le Maire du Mans, le Secrétaire général de Mairie, le Commissaire central de police), je ferai agir l’Achéron ». Plutôt qu’une défaite portée à vie à même la chair, bondit la possibilité du soulèvement sororal dans une lutte à mort, scandé par un temps bref de pivotement qui aura ouvert le passage au crime. Chez ces deux femmes traversées, il n’aura pas été transigé avec l’honneur.
À resserrer le propos, le soulèvement des deux sœurs Papin apparaît relever d’une quasi-superposition de la seconde et de la première analytique du sexe (dans cet ordre temporel), celle-ci poussée à son paroxysme de sang ; cette configuration rejoint le passage du crime dans son impersonnalité, là où il n’est (plus) personne.
Les ultimes mots de Christine Papin
En 1983, Francis Dupré s’en va trouver le Docteur Guillerm exerçant à l’asile d’aliénés de Rennes. Ce dernier lui confie n’avoir jamais oublié Christine Papin. Ce médecin relate qu’il la voyait tous les jours lors de sa visite à son lit, et parfois il la faisait venir dans son bureau :
[…] Rien n’accrochait dit-il, je m’en souviendrais : je la sentais ailleurs, pas dans le service. […] J’ai essayé de parler avec elle du crime proprement dit mais aussi d’elle, de son histoire. Une seule fois, assez longtemps après son hospitalisation, elle a lâché quelques paroles sur le maléfice des bijoux Lancelin [nos italiques]. C’est la seule fois qu’elle a parlé64.
Deux additifs :
1. De l’une de ses patronnes à propos de Christine Papin, ce témoignage :
Impartialement je dois dire que c’était une domestique stylée, possédant d’excellentes qualités et dont j’ai regretté le départ. C’est sa mère qui, pour un motif que j’ignore, l’a fait quitter son emploi. [… ] Elle était très propre, soigneuse, courageuse, très honnête et sa conduite m’a toujours paru irréprochable. Très gaie, sociable, prévenante, elle était douée d’un très bon caractère. Jamais elle ne s’est emportée et, sans être timide, elle a toujours eu une attitude déférente à mon égard. En aucune occasion il ne m’a été donné de soupçonner qu’elle ne fut pas normale. Au contraire, il m’a toujours semblé que ses facultés étaient parfaitement équilibrées65.
2. Sur les ondes de France-Culture66, dans une émission portant sur l’affaire Papin, Nadjma Bouakri, journaliste, pose cette question à brûle-pourpoint à Jean Allouch : « Elles sont soulagées ? » Jean Allouch marque d’abord un bref suspens, puis répond :
[…] oui sans doute sans doute en un certain sens soulagées oui oui et en un autre sens soulagées en ce sens que c’est fait, c’est fait, quelque chose, on sait pas dire quoi, mais quelque chose a pris fin ! Et donc comme si une vie était accomplie à la limite, vous savez on dit ça, on dit que on peut mourir plus facilement si on a eu une vie accomplie, si on a eu une vie, avec un certain nombre de réalisations et pour Christine en tout cas oui quelque chose s’est accompli comme le Christ en croix, quelque chose a eu lieu et donc il n’y a rien à ajouter [un léger rire s’entend].
.