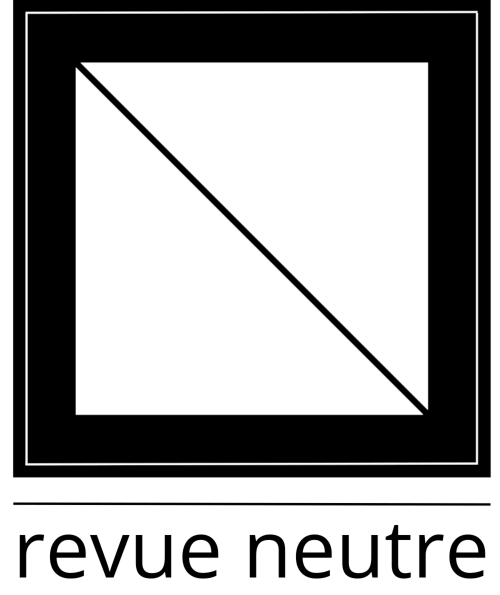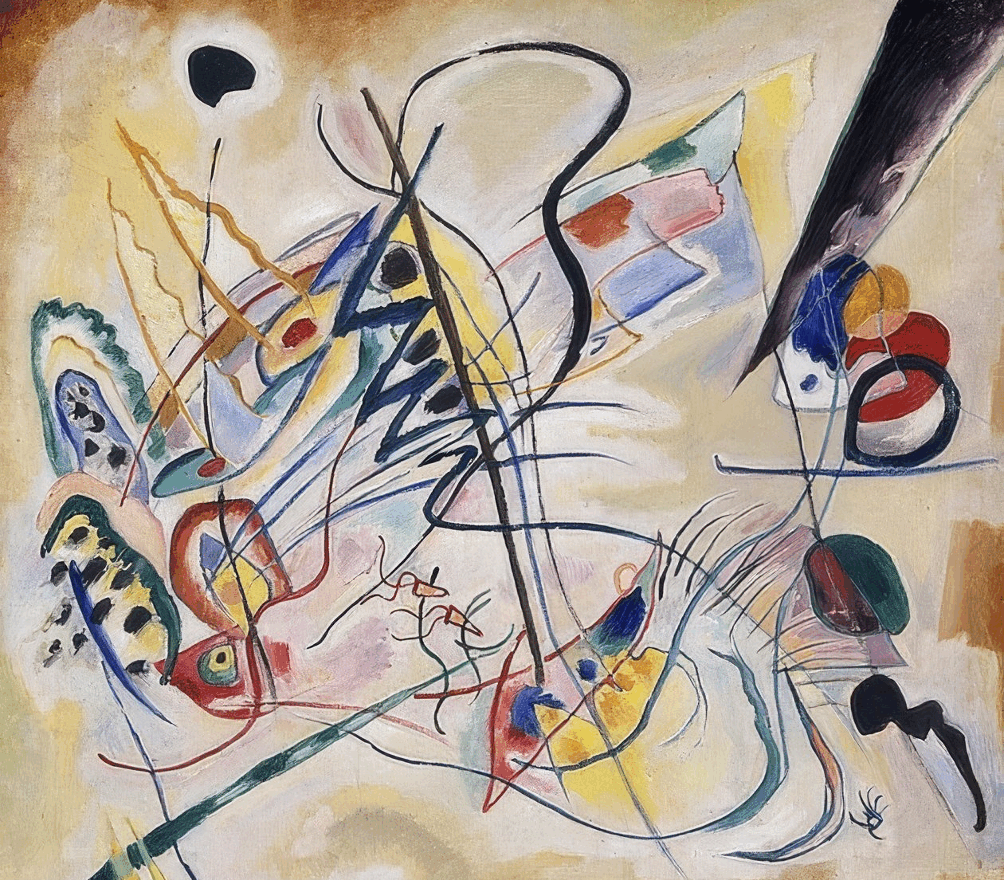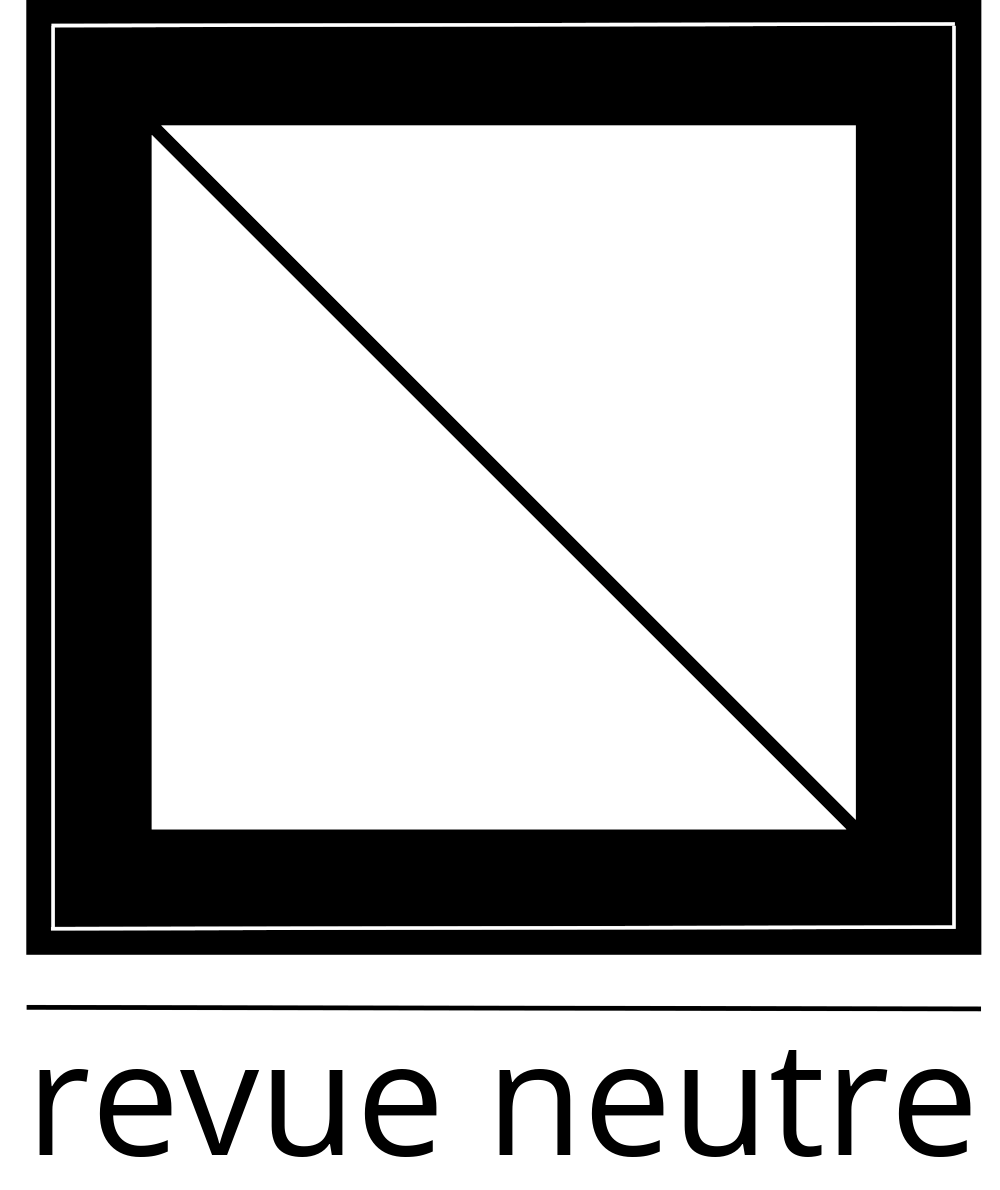TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE
Chemin faisant avec l’ouvrage « Le désir et ses rites »
Emmanuel Pic
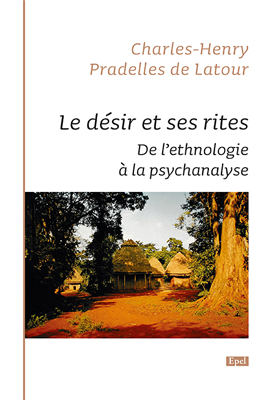 Introduction
Introduction
C’est un sacré voyage et même un voyage sacré auquel invite « Le désir et ses rites1 » de Charles-Henry Pradelles de Latour qui, dès le sous-titre, précise l’orientation de l’étude : « de l’ethnologie à la psychanalyse ». Et en effet l’intérêt majeur de cet ouvrage peut résider dans cette orientation. Dans une démarche à rebours, on s’attardera ici à mettre à l’épreuve certaines données de la recherche de l’auteur pour voir comment elles se comportent au regard d’autres approches rituelles et en particulier celles issues du christianisme. Ce cheminement se fera en trois temps : le premier s’interrogera sur une possible lecture du ternaire lacanien dans les rites de l’initiation chrétienne, le second tentera une recherche du neutre dans les liturgies chrétiennes et enfin le dernier temps fera place à des questions nouvelles que suscite une telle exploration du désir.
Mais avant d’entrer dans cette recherche, un préambule est nécessaire. En effet Charles-Henry Pradelles souligne dans son travail « le discrédit dont souffre le rite en anthropologie2 ». Avec un autre regard, celui de la théologie, on constate qu’il en va de même concernant, par exemple, le christianisme : Les récits mythiques qui traversent les écrits et l’histoire des Églises séduisent davantage les psychanalystes que les pratiques rituelles développées dans les sacrements3 et les sacramentaux4 de la tradition chrétienne. Certes des auteurs ont exploré une lecture psychanalytique du Nouveau Testament et des articles de la foi chrétienne5. La sélection qui suit n’est pas exhaustive et se concentre sur des contributions significatives dans le monde francophone :
Dans le domaine de la théologie et de la psychanalyse : Louis Beirnaert (1906-1985), jésuite et psychanalyste, a exploré l’intégration de la psychanalyse dans l’aide pastorale et la théologie spirituelle6. Antoine Vergote (1921-2013), prêtre, théologien, philosophe et psychanalyste, a étudié l’interaction entre ces disciplines7. Denis Vasse (1933-2018), jésuite et psychanalyste, a combiné psychanalyse et anthropologie, notamment dans son ouvrage sur le désir8 qui a considérablement marqué la formation des clercs à partir des années 70.
Dans le domaine de l’herméneutique et de la critique des institutions : Paul Ricoeur (1913-2005), philosophe protestant, a proposé une critique de la religion à travers Freud9. Michel de Certeau (1925-1986), jésuite, a interrogé les institutions ecclésiales et leur lien avec la fragilité humaine10.
Dans le domaine de la psychanalyse des textes bibliques : Françoise Dolto (1908-1988), pédiatre et psychanalyste, a apporté une lecture psychanalytique des Évangiles et du catholicisme11. Marie Balmary (née en 1939), psychologue et psychanalyste, interprète les textes bibliques avec une approche psychanalytique12.
Dans le domaine de l’éthique et de la spiritualité : Maurice Bellet (1923-2018), prêtre et écrivain, a questionné le déclin du christianisme institutionnel13. Véronique Margron (née en 1957) théologienne dominicaine et membre de la CIASE14, met l’accent sur la vulnérabilité humaine et la relation avec autrui15, à la suite de Xavier Thévenot (1938-2004), prêtre salésien, qui avait intégré la psychanalyse dans sa réflexion sur l’éthique chrétienne.
Cependant les uns et les autres n’ont pas pu/su/voulu questionner les rites eux-mêmes dans lesquels ils ont pourtant baigné, voire plongé (c’est le sens du mot baptême en grec) pour beaucoup à leur naissance. En effet il semble difficile de s’extraire d’un contexte qui dès l’enfance a structuré et rythmé une temporalité à la fois personnelle, sociale et cosmique. Cette difficulté apparaît à travers les réticences ou distances que l’auteur exprime au fil des pages vis-à-vis du christianisme, alors que cette imprégnation chrétienne se révèle essentielle dans le récit biographique de son « cheminement personnel entre psychanalyse et ethnologie16 », présenté à la fin de l’ouvrage.
Réel, Imaginaire et Symbolique dans les rites d’initiation chrétienne
Dans les pages consacrées à « l’ordre ternaire du phallus à Bangoua et à Athènes17 », il est explicitement fait référence à l’élaboration de Lacan autour du symbolique, de l’imaginaire et du réel. Or si le ternaire lacanien est applicable à deux traditions très différentes – celle des rites athéniens du ve siècle et celle de la société Bangoua du Cameroun au xxe siècle – pourquoi n’en serait-il pas de même pour les sacrements de l’initiation chrétienne qui appartiennent à une tradition tout aussi ancienne ?
« Quelque chose d’opératoire »
Cette démarche constitue un écho ou une résurgence des questions soulevées par Lacan sur l’opérativité des sacrements18. Ceux retenus ici sont au nombre de trois : Le baptême, l’eucharistie et la confirmation. Ils sont directement reliés à des épisodes de la Pâque de Jésus de Nazareth dont ils sont à la fois anamnèse et actualisation, « signe visible d’une réalité invisible » pour reprendre saint Augustin. La réception de chacun de ces sacrements s’adresse à des personnes désireuses d’entrer plus profondément dans une existence configurée à la personne du Christ. Le baptême s’enracine dans la mort et la résurrection du Christ, l’eucharistie est directement à relier au récit de la dernière Cène, la confirmation renouvelle l’explosion spirituelle de la Pentecôte.
Répartir les sacrements de l’initiation chrétienne selon les catégories de la triade lacanienne semble une perspective séduisante telle que la suggère Charles-Henry Pradelles. Que peut produire un tel rapprochement ?
Le baptême peut s’envisager comme la construction imaginaire d’une nouvelle identité
- Le baptême marque l’entrée dans la communauté chrétienne et la naissance d’une nouvelle identité en tant qu’enfant de Dieu. Cela relève de l’imaginaire qui participe à la construction d’une nouvelle image de soi.
- L’utilisation de l’eau (ondoiement ou immersion), le vêtement blanc dont est revêtu le catéchumène, l’imprégnation du saint-chrême et la transmission de la flamme du cierge pascal sont autant d’éléments rituels et visuels qui participent à former cette nouvelle identité.
- L’accueil au sein de la communauté produit un effet de transfert subjectif, où les attentes et les croyances de la communauté sont intégrées par le nouvel initié, confirmant et renforçant cette nouvelle identité.
La confirmation donne à entendre un langage et une structure symboliques :
- La confirmation implique un engagement personnel et public dans la foi chrétienne. Le symbolique concerne le langage, les règles et les structures sociales. Au fil de la liturgie le confirmand reçoit une parole au moment de l’onction « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » à laquelle il répond « Amen ».
- Le fait que la confirmation soit administrée par un évêque ou son représentant renforce son caractère institutionnel et symbolique.
- La chrismation (onction avec le Saint Chrême utilisé également pour les ordinations sacerdotales et épiscopales) est un signe visible d’une réalité invisible, inscrivant le confirmand dans une structure symbolique plus vaste.
L’eucharistie manifeste/dévoile la présence réelle, la communion et le mystère sacré
- L’eucharistie est considérée comme la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin, ce qui transcende la simple symbolisation et touche au réel lacanien en ce qu’il échappe au langage et à une représentation totale.
- En recevant l’eucharistie, les fidèles entrent en communion intime avec le Christ, une expérience directe et immédiate qui dépasse la symbolisation.
- Le mystère de la transsubstantiation (le changement du pain et du vin en corps et sang du Christ) est une réalité sacrée qui ne peut être pleinement comprise ou représentée. Elle participerait davantage au registre du réel, d’un impossible qui échappe sans cesse.
Cette répartition, qui associe le baptême à l’imaginaire, la confirmation au symbolique et l’eucharistie au réel, est cohérente intellectuellement. Cependant, une telle construction, aussi jouissive soit-elle au niveau du sens, n’en demeure pas moins artificielle. Et ceci pour au moins deux raisons :
- La position subjective de chaque analysant : la pensée de Lacan n’est au service ni d’une singularité de la personne19, ni d’une visée universaliste, qu’elle soit universitaire, politique ou catholique. Dire qu’un sujet est singulier pourrait laisser croire à une identité pleine, alors que chez Lacan, il y a toujours un manque, une béance. Ce qui distingue un sujet, c’est la manière dont il noue l’imaginaire, le symbolique et le réel, et toute tentative de généralisation risque de trahir cette possibilité.
- L’histoire sacramentaire : Dans les premiers siècles du christianisme, ces trois sacrements n’étaient pas dissociés. Ils étaient donnés ensemble aux adultes (hommes et femmes de toutes conditions et provenances) qui adhéraient au kérygme, marquant ainsi une unité sacramentelle dans le processus d’initiation.
Vaciller jusqu’au n’importe qui
Si les sacrements de l’initiation chrétienne sont à comprendre comme une seule entité sacramentelle participant d’un même mouvement, il est possible d’envisager un rapprochement du ternaire lacanien non avec les sacrements eux-mêmes, mais avec les personnes de la Trinité auxquelles le futur chrétien est modelé, associé et rendu participant au terme de son intégration dans la communauté. Une telle hypothèse permet des rapprochements significatifs qui respectent la position subjective propre à chaque sujet pour non pas s’élever à être quelqu’un mais vaciller jusqu’au n’importe qui20.
Cette position subjective n’est pas à entendre comme une quête d’unicité car pour Lacan le sujet est toujours pris dans le désir et le regard de l’Autre. Son être est en partie constitué par ce qui lui est extérieur, par ce qui le précède et l’excède. Ainsi, l’unicité de la personne n’est pas une notion lacanienne. Ce qui est unique chez un sujet ne se trouve pas dans une essence propre, mais dans la manière dont il se noue aux structures du langage, du désir et du réel. Ainsi l’approche de la Trinité s’en trouve renouvelée :
- Réel et Dieu-Le-Père : Dans « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse21 », Lacan décrit le réel comme ce qui échappe à toute symbolisation et représentation. Aussi paradoxal que cela puisse paraître le « Père éternel » peut être associé au réel en tant que origine et fondement ultime de l’existence, transcendant toute symbolisation et représentation. Le Père représente l’origine incommensurable et absolue.
- Symbolique et Jésus-Le-Fils : Dans Écrits et notamment dans « La lettre volée22 », Lacan explore le symbolique en tant que domaine du langage et des structures sociales. Aussi Jésus-Christ, Verbe fait chair23, incarne pour une part cette dimension symbolique du langage. Par sa vie, ses enseignements et ses sacrements, il médiatise la relation entre Dieu et l’humanité. Le Christ est signe visible de l’amour divin et médiateur entre Dieu et les hommes.
- Imaginaire et Saint-Esprit : Lacan présente l’imaginaire dans la fameuse conférence sur SIR en 1953 comme ce qui rend le sujet « susceptible d’un déplacement24 » ou bien encore en affirmant « que toute relation à deux est toujours marquée du style de l’imaginaire25 ». Aussi le Saint-Esprit serait à situer dans la dimension imaginaire du nœud borroméen dans le sens qu’il est source d’inspiration et de transformation pour le sujet croyant, créant une nouvelle identité en lui en tant qu’enfant de Dieu. L’Esprit Saint dynamise, vivifie, déplace tant le baptisé que la communauté qui se laisse inspirer par lui, favorisant une identification au Christ, un rapport transférentiel à sa personne.
En conclusion, cette tentative de relecture psychanalytique des rites de l’initiation chrétienne à travers le prisme lacanien ouvre de nouvelles perspectives tant sur le plan anthropologique qu’ethnologique. Sur le plan anthropologique voire théologique, elle permet une interprétation novatrice des rituels sacramentels chrétiens comme des processus d’identification et de transformation individuelle, médiatisés par des éléments symboliques et imaginaires qui engagent à la fois l’individuel et le collectif.
En ce qui concerne le passage de l’ethnologie à la psychanalyse, cette expérience du sacré peut être qualifiée comme « un acte hors contexte » pour reprendre la distinction que rappelle Charles-Henry Pradelles entre action et acte. En effet l’expérience de transcendance et du mystère vécue par le catéchumène à travers l’initiation chrétienne s’inscrit dans un ordre social ecclésial « qui ne connaît ni la réflexivité, ni la réciprocité, ni la nécessité26 ». Cette perspective peut surprendre si l’on reste attaché à une vision traditionnelle du baptême comme acte de foi et de liberté personnelle, ce qu’il est effectivement.
Or, l’intégration dans un ordre social ecclésial implique une forme de désappropriation. Les nouveaux baptisés entrent dans une tradition et une communauté dotées d’une histoire, de rituels et d’une structure organisée. Cette intégration nécessite une adaptation aux normes et aux attentes de cette communauté, qui peut être perçue comme un processus de dépouillement (kénose) de l’individualité au profit d’une identité chrétienne commune27.
Par ailleurs, le baptême ne répond pas à un besoin au sens strict. Ce sacrement n’est pas une simple réponse à une nécessité personnelle qui garantirait un droit d’accès automatique28. Ainsi, le baptême apparaît-il moins comme la réponse à l’exigence d’un besoin que comme un désir spirituel et/ou religieux, désir assez similaire à ce qu’exprime Marie de la Trinité dans ses séances avec Jacques Lacan : désir de revivre les grâces reçues de Dieu29 et de retrouver un apaisement ainsi qu’une cohérence personnelle30. Et c’est précisément dans la relation à ce désir que la question du neutre se pose et est posée dans « Le désir et ses rites ».
La place du neutre dans les rites liturgiques chrétiens
Le thème central de l’ouvrage de Charles-Henry Pradelles consiste à montrer comment dans la société Bangoua « la division subjective est représentée non pas par des signifiants, mais instituée par des statuts féminins – épouse cédée/épouse-mère acquise – sous une forme neutre, sans aucun lien avec un savoir31 ». On retiendra ici l’utilisation d’une certaine forme du neutre tout particulièrement dans la première partie de l’ouvrage.
L’usage qui en est fait s’ancre sur l’articulation entre une expérience et une définition :
- L’expérience est celle d’une neutralité dans un conflit entre le chef de village et le secrétaire de mairie : « À ma grande surprise, lorsque les membres des deux partis sont sortis de cette réunion de réconciliation, deux d’entre eux, représentant chacun leur faction, sont venus nous féliciter ma femme et moi, de n’avoir pas pris parti pour un des deux camps32. »
- Quant à la définition, c’est en s’appuyant sur une certaine interprétation de Roland Barthes que l’auteur donne sa propre conception théorique du neutre : « Ni actif, ni passif, ni masculin, ni féminin, le neutre est sans qualité. Sans affect, sans jouissance ou souffrance, sans image ni reflet en miroir, il est extérieur aux oppositions et aux contradictions. C’est en tant qu’effet impassible que le neutre peut se substituer dans l’après-coup à la cause d’une tension33. »
Ce « discours neutre, restaurateur de relations pacifiques et du désir qui, partant de rien, est revitalisé34 » est-il aussi une caractéristique présente dans les rites chrétiens ? Pour répondre examinons d’abord trois récits du Nouveau Testament, puis l’emploi de vocables liturgiques spécifiques, et enfin une adresse rituelle hautement personnaliste et pour le moins impersonnelle.
Parcours néo-testamentaire
Les liturgies chrétiennes se font l’écho des textes évangéliques ou des lettres apostoliques adressées aux premières communautés soit par leur proclamation, soit parce qu’elles ont inspiré la rédaction de prières rituelles. Certains péricopes de la vie du Christ semblent correspondre à cette description que l’ethnologue donne de la neutralité dans la société traditionnelle Bangoua : « Cette position neutre dépourvue de tensions est supposée être en cette circonstance facteur d’apaisement, à défaut d’être génératrice de guérison35. » Nous retiendrons trois récits des Évangiles pour illustrer cela :
Une femme adultère (Jean 8, 1-11) : Dans ce passage, Jésus démontre sa neutralité en restant silencieux et en écrivant dans le sable alors que la foule réclame une condamnation, une lapidation. Ce geste désamorce la tension sans confrontation directe. Sa réponse, « Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre », invite chacun à réfléchir sur sa propre responsabilité. Ce comportement neutre apaise la situation, transformant un moment de possible violence en un appel à la miséricorde.
Le passage à travers une foule hostile (Luc 4, 28-30) : Face à une foule furieuse, Jésus traverse sans opposition ni conflit. Cette action signe une maîtrise pacifique des tensions. En ne réagissant pas agressivement, il maintient une neutralité qui empêche l’escalade du conflit, montrant une capacité à apaiser par sa seule présence.
Une guérison le jour du sabbat (Marc 3, 1-6) : Dans cet épisode, Jésus guérit un homme sous le regard critique des pharisiens, qui cherchent un prétexte pour l’accuser. En posant la question, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ? », il met en lumière l’absurdité des tensions religieuses tout en restant calme. Son action, bien que controversée, illustre une neutralité qui transcende les lois rigides et démontre que le bien de la personne prévaut sur la Loi.
Dans chacun de ces récits, la neutralité de Jésus semble permettre d’apaiser les tensions en transcendant les divisions. En n’adoptant pas un camp et en invitant à la réflexion, il rétablit l’équilibre et souligne une justice au-delà des lois humaines. Dans cette approche, l’harmonie sociale et la compréhension mutuelle remplacent la stricte application des règles, offrant ainsi une forme de guérison et de réconciliation qui dépasse les conflits.
Une telle lecture – si séduisante soit-elle – n’est-elle pas simplificatrice ? Ne passe-t-on pas à côté d’une autre « vitalité du neutre36 » que Jean Allouch a approché tout en refusant de la définir pour ne pas l’enfermer ? En effet dans cette exégèse évangélique comme dans l’interprétation de Charles Henri Pradelles l’insistance porte sur la résolution ou la clarification des conflits. Or le neutre tel que défini par Roland Barthes n’est pas une simple neutralité. Il ne s’agit pas d’une absence d’engagement ou d’un refus de se positionner : « Je donne du Neutre une définition qui reste structurale. Je veux dire par là que, pour moi, le Neutre ne renvoie pas à des “impressions” de grisaille, de “neutralité”, d’indifférence. Le Neutre — mon Neutre — peut renvoyer à des états intenses, forts, inouïs. “Déjouer le paradigme” est une activité ardente, brûlante37. » Jean Allouch parle lui d’un « principe de délicatesse38 » qu’il convient d’entendre et qui insiste sur la manière dont les situations restent suspendues, ouvertes, et comment elles intègrent une présence marquée par l’absence ou le non-dit39.
Appliquée aux trois récits évangéliques, ces perspectives en transforment profondément la lecture.
Une femme adultère (Jean 8, 1-11) : Dans ce passage où une femme est accusée, Jésus reste silencieux et écrit dans le sable, une action qui n’apporte pas de réponse immédiate ni de résolution claire au conflit entre la femme adultère et ses accusateurs. Son silence et son geste sont une manière de maintenir la situation dans une zone d’incertitude et d’ouverture. Au lieu de combler le vide avec une réponse définitive, un espace est créé où les participants sont confrontés à leurs propres dilemmes moraux sans imposer une solution. Cette absence de jugement direct est une forme de présence dans le vide, une manière de souligner la tension qui reste en suspens et de permettre une réflexion individuelle sans conclusion imposée.
Le passage à travers une foule hostile (Luc 4, 28-30) : Lors de son affrontement avec une foule en colère, Jésus traverse calmement la situation sans confrontation. Cette action est une manière de maintenir la situation dans un état de suspension. Plutôt que de répondre à la violence par la violence ou de tenter une résolution immédiate, Jésus se retire sans combler le vide de l’hostilité par une réponse directe. Ce retrait crée une forme de présence paradoxale, où son absence d’action intensifie le sentiment d’incertitude et d’attente chez la foule, tout en maintenant un espace ouvert où le conflit latent persiste sans dénouement.
Une guérison le jour du sabbat (Marc 3, 1-6) : Dans ce récit, Jésus pose une question provocatrice qui expose l’absurdité de la rigidité des lois du sabbat. En guérissant l’homme, il ne se contente pas de répondre aux critiques, mais il laisse la question du sabbat ouverte et en suspens. Sa question sur le bien et le mal le jour du sabbat, et son action thaumaturgique, soulignent une présence au lieu d’une résolution. La guérison elle-même est un acte qui défie les normes sans apporter une réponse claire aux tensions légales en jeu, créant ainsi un espace où les contradictions restent ouvertes et sans solution définitive.
Dans ces relectures, le « neutre » se manifeste par une présence qui accentue l’absence ou le vide, offrant un espace pour la réflexion et l’exploration plutôt que pour une résolution immédiate. Cela rejoint et/ou questionne la fonction de l’analyste40. Cette approche est en accord avec l’idée que le neutre peut être une présence intensifiée par l’absence elle-même, un lieu où les questions demeurent et les tensions persistent41.
Exploration de vocables liturgiques
Dans l’analyse des rites chrétiens, la manière dont le langage est utilisé peut refléter des dimensions spécifiques du neutre. Dans son dernier ouvrage, Jean Allouch l’a déployé brillamment à travers la parole eucharistique de Jésus au moment de la Cène : « Prenez, mangez, ceci est mon corps (Matthieu 26, 26)42 ». De la même manière, certains termes liturgiques méritent une attention particulière pour comprendre comment ils fonctionnent comme expressions impersonnelles et non genrées. Ces mots, loin de se limiter à des affirmations individuelles ou à des émotions personnelles, jouent un rôle fondamental dans la structuration des rites religieux. L’étude de leur étymologie et de leur utilisation dans la liturgie permet de saisir comment ces vocables expriment une dimension neutre dans l’expérience religieuse.
- « Amen » : En hébreu, sa racine signifie « être fidèle » ou « être ferme ». Il peut se traduire par « certainement » ou « ainsi soit-il ». La racine hébraïque est neutre en ce sens qu’elle n’a pas de genre grammatical spécifique. Elle exprime une qualité de fidélité et de vérité sans connotation liée à un genre. Il s’agit donc d’un terme de réponse ou d’approbation qui ne transmet pas d’émotions ou de pensées personnelles, mais sert plutôt de confirmation collective dans les prières ou les bénédictions. Dans les contextes religieux, « Amen » fonctionne comme une déclaration d’accord qui représente un consensus plutôt qu’une expression individuelle. Il est utilisé pour conclure les prières ou bénédictions. C’est à une époque très récente et à la faveur de mouvement pentecôtiste que cet « Amen » s’est chargé de connotation émotionnelle forte.
- « Gloria » est un terme latin signifiant « gloire », « honneur » ou « splendeur » qui est utilisé dans la liturgie chrétienne pour exprimer la louange et la magnificence de Dieu. En hébreu, le concept de gloire kavod se réfère à l’idée de poids ou de grandeur, indiquant quelque chose de précieux ou de significatif. La racine hébraïque est également neutre sans référence particulière à une identité sexuelle ou à une distinction masculine ou féminine. Dans le cadre d’une expression liturgique « Gloria » est chanté comme un hymne de louange par la communauté. Son usage ne reflète pas des sentiments individuels.
- « Alléluia » provient de l’hébreu qui signifie « Louez Yah » ou « Louez le Seigneur ». Il est utilisé comme exclamation joyeuse de louange et d’adoration. Sa racine hébraïque est également neutre en termes de genre grammatical et son usage est impersonnel. Dans la liturgie chrétienne, « Alléluia » est utilisé pour marquer des moments de célébration collective et de joie partagée qui n’est pas centrée sur l’individu mais sur une acclamation communautaire.
En conclusion, les termes « Amen », « Gloria », et « Alléluia » possèdent des racines hébraïques et latines qui sont linguistiquement neutres. Dans leurs usages liturgiques, ces mots rythment les rites. Plutôt que des expressions de sentiments personnels individuels, ils expriment d’abord un consensus collectif ou une louange universelle et davantage. En effet le registre neutre qu’ils véhiculent permet de saisir, d’observer non un ou des sujets à l’œuvre mais un objet manquant, une absence, un vide qui marque une attente, qui suggère un désir beaucoup plus vaste qu’un simple contexte liturgique qu’il déborde43.
Réflexions sur l’adresse rituelle à la Trinité
Après avoir questionné plusieurs récits évangéliques et approfondi le sens de certains vocables liturgiques, l’adresse rituelle « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » qui ouvre et conclut les rites chrétiens apparaît sous un nouveau jour. Cet éclairage semble contredire l’affirmation de Charles-Henry Pradelles pour qui « la Trinité est restée essentiellement un dogme, une théologie44 ». Certes l’élaboration des premiers siècles du Christianisme a donné lieu à une riche effervescence intellectuelle mais qui s’ancre sur une expérience qui n’est pas qu’intellectuelle. Cette nouveauté conceptuelle devait être à la hauteur d’un inédit, d’un impensé, d’un ineffable dans une société en pleine mutation (Pax Romana, syncrétisme religieux, accentuation des inégalités économiques, etc.) Sans aucun doute Augustin d’Hippone fut le premier à en saisir toutes les promesses et les implications, lui dont l’ancrage premier fut précisément un savant mélange de culture hellénistique, de religions traditionnelles et de manichéisme.
L’adresse liturgique « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » structure – comme il a été vu – les textes et les rites liturgiques chrétiens pour permettre que s’accomplisse une œuvre ou un travail45 de la personne dans sa relation avec la Trinité. À l’exemple de l’œuvre de Dante Alighieri (1265-1321)46 où les principes trinitaires trouvent une application concrète au cœur même de la personne en relation qui admet, elle aussi, le sunt et l’est. Au fil de la Divine Comédie se révèle l’originalité de cette vision dantesque de la personne. Cette spécificité du regard porté sur la personne se révèle par exemple dans la poésie de certaines créations linguistiques :
- « Dio vede tutto, e tuo veder s’inluia » : « Dieu, lui, voit tout : et ta vision s’en-lui-e47 ».
- « Già non attendere ’io tua domanda, s’io m’intuassi, comme tu t’inmii » : « Moi, je n’attendrais pas tes questions, si je m’en-toi-yais, comme toi tu t’en-moi-es48 ».
- « E però, prima che tu più l’inlei, rimira in giù, e vedi quanto mondo sotto li piedi già esser ti fei » : « Avant donc que toi-même tu t’en-elle-s, regarde en bas, et vois la part du monde que j’ai déjà fait venir sous tes pieds49 ».
Ces élégants néologismes permettent à Dante d’exprimer la nouveauté de sa perception, en particulier les implications dans la relation interpersonnelle. Cette compréhension de la relation est nouvelle car il ne s’agit pas d’un simple dialogue entre deux identités mais d’une connaissance réciproque qui modifie intimement l’être des personnes. La relation entraîne une altération, apporte une modification. La relation à autrui touche au plus intime : inluia, intuassi, inmii, inlei.
Mais cette même adresse liturgique « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » dépasse la relation élémentaire entre la personne et la Trinité. Plus récemment une autre personnalité italienne, Chiara Lubich (1920-2008) a apporté un éclairage novateur sur cette dimension50 qui est au cœur de sa pensée et de son action œcuménique, inter-religieuse et sociale. Pour elle, il n’y a pas uniquement le regard de l’homme face à Dieu, mais une vision de l’humanité directement située en Dieu « en se trinitisant ». Elle explique que cette trinitisation signifie devenir un, comme les personnes de la Trinité qui sont à la fois parfaitement unies et singulièrement distinctes. Pour elle, cette expérience ne se limite pas à une simple identification au Christ, mais plonge au cœur des relations péricorétiques, c’est-à-dire des échanges entre les personnes de la Trinité. Cette expérience mystique permet de voir l’humanité non seulement en relation avec Dieu, mais comme intégrée dans la divinité elle-même. Ainsi, la trinitisation dépasse la logique habituelle où deux réalités doivent se nier pour devenir une. Chiara Lubich le résume ainsi : « dans le sein du Père, l’ombre et la lumière ont la même valeur51 » permettant aux réalités de rester distinctes tout en étant unifiées.
Paradoxalement l’adresse rituelle « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » véhicule aussi une dimension impersonnelle : En effet ce n’est pas en son nom propre que le chrétien s’exprime, mais au nom d’un autre auquel il est configuré. Cela illustre l’essence du christianisme, combinant l’unité trinitaire et le mystère pascal. Emmanuel Mounier (1905-1950), fondateur de la revue Esprit, a défini cette dynamique vitale comme intégrant toutes les dimensions de l’existence personnelle et communautaire, et offrant une plénitude de l’expérience spirituelle. Le spirituel52 est à entendre dans son sens premier car est ici souligné le lien étroit entre la personne et la communauté avec l’Esprit Saint, troisième personne de la Trinité. Le chef de file du personnalisme français précise que l’Esprit est une réalité impersonnelle permettant l’unité du Père et du Fils :
Il n’y a pas de troisième personne. Il y a une première personne, une seconde personne, et l’impersonnel […]. Et si l’on cherche de hautes chicanes, rappelons que la Troisième Personne de la Trinité n’est pas une figure grammaticale, mais le lien vivant et substantiel de la Première et de la Seconde conversant éternellement et parfaitement entre Elles53.
Ainsi, l’examen de cette formule liturgique se révèle plus complexe qu’il n’y paraît. Si la dimension interpersonnelle et relationnelle de l’adresse « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » a été largement explorée au fil des siècles, son caractère impersonnel – qui s’apparente aussi à une position neutre – ouvre la voie à des développements anthropologiques et théologiques moins fréquemment abordés. Une perspective psychanalytique pourrait, par exemple, permettre de percevoir un au-delà de la posture d’objet et de sujet en revisitant les catégories augustiniennes54 : Le Père en tant qu’« aimant » est « sujet de son désir », le Fils en tant qu’« aimé » est « objet du désir d’autrui » et le Saint-Esprit est tant qu’« amour » assume cette position neutre qui permet la relation entre le Père et le Fils. Il est espace, lieu, véhicule. Par voie de conséquence, l’être humain est perçu comme capable de mettre en acte ces différentes potentialités : aimant, aimé, amour. Dans cette perspective, les rites chrétiens ne sont pas à opposer aux rites de passage des anciens Athéniens ou de la chefferie Bangoua du Cameroun mais doivent être considérés comme une modalité autre.
Des questions et des perspectives nouvelles
Cette rapide étude qui a permis d’interroger d’abord la place du ternaire lacanien dans les rites d’initiation chrétienne, puis celle du neutre dans les rites liturgiques chrétiens, fait émerger des questions nouvelles dans la lecture de l’ouvrage « Le désir et ses rites » et les implications possibles dans le cadre d’une clinique analytique.
S’enfermer dans une dualité ou s’enrichir mutuellement ?
Au fil des pages, plusieurs fois, l’Occident et l’Afrique sont fréquemment mis en parallèle au risque d’accentuer un dualisme ou une opposition systématique qui peut surprendre :
- Ainsi sur « le versant des sexualités55 » où il est dit que pour les uns les deux ordres sexuels (génitalité et analité) sont associés, alors que chez les Bamilékés ils seraient séparés56.
- Ou encore que les uns seraient davantage intéressés à ce qui sort (production de biens de consommation) et les autres à ce qui entre (commensalité valorisée et anthropophagie redoutée).
- Ou enfin « pour les Occidentaux, le rapport au mystère de la parole porte principalement sur le sujet (Qui parle ?) et dans les sociétés orales sur l’objet (De quoi on parle) ?57 »
Ces comparaisons, bien que révélatrices, peuvent aboutir à une vision simplifiée du sujet du désir, où pour l’Occident il est défini par une division des signifiants (entre énonciation et énoncé) et pour la culture Bangoua par « les statuts parentaux dans lesquels il est socialement et subjectivement inséré58. » Or plutôt que de maintenir ces oppositions, ne serait-il pas plus pertinent d’intégrer ces différentes conceptions du surgissement du sujet du désir dans une clinique plus ouverte ? Cela permettrait de reconnaître que ces approches ne sont pas aussi géographiquement distinctes ou situées qu’il n’y paraît, et qu’elles sont communément présentes, sous un mode naissant ou plus développé, quel que soit l’ancrage historique ou sociologique des individus.
Pour y parvenir, il est nécessaire d’identifier plusieurs filtres interprétatifs qui marquent et limitent la compréhension, tels que l’idéalisation (c’est mieux ailleurs), la nostalgie (c’était mieux avant), ou la culpabilité (face à un passé colonial ou paternaliste). Ces filtres peuvent constituer des dimensions qui n’ont pas encore émergé, tant dans l’analyse personnelle que dans la réflexion collective sur le plan historique.
Mythes et rites ne sont pas fossilisés ni cristallisés. Au contraire, le travail herméneutique et la pratique liturgique les vivifient, comme le montre l’exemple des « Rêves » du peuple Warlpiri en Australie. Ne serait-il pas possible d’envisager que d’autres traditions fonctionnent de manière similaire ? De plus, la rencontre entre Marie de la Trinité et Jacques Lacan illustre comment l’apport de la psychanalyse peut enrichir une lecture spirituelle et comment le travail psychanalytique des mystiques peut éclairer la compréhension de l’inconscient59.
Il serait donc utile d’examiner comment les expériences rituelles, qu’elles soient liées à la religion, à la sociologie, à l’économie ou à la politique, permettent d’approcher le désir sous divers angles. En les distinguant de leurs ancrages institutionnels (ecclésiaux, tribaux, sociétaux), elles peuvent devenir une source de croissance, de créativité, d’épanouissement, bref de plus grande liberté.
Entre silence et sexualité quelles articulations ?
Dans le chapitre vi intitulé « Pulsions orales, jouissance phallique et cliniques locales60 », des thèmes sont rapprochés de manière assez surprenante : soit par une comparaison binaire comme la sorcellerie et les vols de sexe, soit dans une juxtaposition qui questionne, telle que l’homosexualité et certains conflits inconscients comme les phobies et les névroses obsessionnelles. Ces rapprochements visent une finalité explicite : montrer que « la dette symbolique d’alliance matrimoniale, qui, en tant que loi sociale principale, divise tout sujet en deux entités sexuées, génitale et prégénitale, n’est pas sans incidence dans la clinique locale61. » Cependant, une dimension implicite reste dans l’ombre et apparaît problématique, notamment dans la manière dont est traitée l’homosexualité.
Pradelles avance ainsi que : « Dans les sociétés traditionnelles africaines, elle [l’homosexualité] n’est jamais mentionnée par les ethnologues. Durant mes séjours sur le terrain chez les Bamiléké et chez les Pèrè sur plusieurs années, je n’en ai jamais entendu parler62. » Plus loin, il reconnaît que « dans plusieurs pays africains ayant été en contact avec des Occidentaux depuis plus de deux siècles, il existe des associations d’homosexuels socialement reconnues63. » Enfin, il affirme que « chez les Bamiléké où les deux sexualités [génitale et prégénitale] étaient séparées, personne ne se disait être l’un ou l’autre [homosexuel ou lesbienne]64. »
Ces affirmations posent problème à plusieurs égards. Tout d’abord, l’argument du silence ethnographique ne saurait être interprété comme une preuve d’inexistence. Que l’homosexualité ne soit pas « mentionnée » ne signifie pas qu’elle soit absente ; c’est plutôt le signe d’un cadre conceptuel et méthodologique qui n’a pas cherché à la percevoir, voire qui l’a volontairement évacuée. Ensuite, l’auteur laisse entendre que l’homosexualité ne devient visible qu’à travers le contact avec l’Occident, ce qui alimente une vision figée des cultures selon laquelle certaines sociétés africaines seraient imperméables à cette réalité, sauf sous l’effet d’influences extérieures65. Or, de nombreuses recherches en anthropologie et en histoire montrent au contraire que des formes d’homo-érotisme, de relations entre personnes de même sexe et de configurations sociales acceptant ces pratiques ont existé bien avant la colonisation.
En associant l’homosexualité à une simple catégorie occidentale et en la maintenant en dehors du champ des possibles africains, Charles-Henry Pradelles perpétue une lecture dépassée et idéologiquement chargée, qui occulte la complexité des dynamiques de genre et de sexualité sur le continent. Cette posture relève d’un double déni : un déni historique, en ignorant les multiples formes de reconnaissance des relations entre personnes de même sexe dans diverses sociétés africaines ; et un déni contemporain, en ne questionnant pas la manière dont les discours politiques et religieux modernes ont contribué à la marginalisation et à la criminalisation de l’homosexualité66.
Or, si le silence autour de l’homosexualité dans certaines sociétés africaines, et en particulier dans la tradition Bangoua, peut s’expliquer par une absence de problématisation sociale ou religieuse spécifique, cela ne signifie pas pour autant une absence de pratiques ou d’identités homosexuelles. Au contraire, cette absence de catégorisation explicite peut être interprétée comme une forme d’intégration tacite, où les relations entre personnes de même sexe ne nécessitaient pas d’être nommées pour exister.
Il est donc essentiel de déconstruire ces lectures réductrices qui, sous couvert d’analyse, contribuent à renforcer l’idée que l’homosexualité en Afrique serait une importation étrangère ou un phénomène récent. Une telle approche empêche non seulement une compréhension fine des réalités locales, mais participe également, de manière insidieuse, à la perpétuation des discriminations jusqu’à la violence67.
Pour illustrer l’impact du silence face aux questions de sexualité-identité-subjectivité, il est intéressant de revenir sur le récit des vols de sexe, qui auraient commencé en 1960 durant la période de décolonisation de l’Afrique, tel que les présente Charles-Henry Pradelles68. En parallèle, un passage des Évangiles synoptiques, dans lequel Jésus guérit une femme souffrant d’hémorragie69, peut être analysé. Ces deux récits, bien que venant de contextes très différents, offrent un contraste frappant face à l’incertitude et à la menace perçue.
Les vols de sexe auraient des scénarios assez similaires. Ils se déroulaient dans des milieux urbanisés, suite à un contact entre deux personnes lié à la promiscuité, par exemple lors d’un déplacement en voiture ou d’un frôlement sur un marché. « La victime poussait un cri pour alerter les passants du vol de son sexe70 ». La réaction collective intense qui en résultait se concluait par le lynchage atroce et expéditif du présumé coupable. Le cri et la violence qui en découlaient peuvent être envisagés comme des tentatives pour combler le vide laissé par une angoisse irrationnelle. La panique collective et la recherche d’un bouc émissaire visaient à restaurer un ordre perturbé par l’agression. Ici, le silence est inexistant, recouvert par une folie bruyante et meurtrière.
En opposition, la réaction de Jésus face à la femme souffrant de pertes de sang – et donc considérée en état d’impureté rituelle – offre un autre rapport au vide et à l’incertitude. Plutôt que de réagir avec une condamnation ou une accusation, Jésus pose une question ouverte : « Qui m’a touché ? » Cette question laisse place à un espace de silence qui n’est pas menaçant mais ouvert à une expression personnelle. La béance n’est pas perçue ici comme un espace inquiétant dans lequel il serait risqué de plonger, mais au contraire comme un lieu où puiser. Ce silence permet ainsi à la femme de se révéler, d’exprimer son désir et de recevoir une guérison à la fois physique et sociale.
Ainsi, le contraste entre ces deux récits met en lumière des modes différents de se situer qui ne sont pas liés à une culture particulière ou à un contexte historique précis. Dans le premier récit le cri de l’homme témoigne de peurs sous-jacentes. Le vide est perçu menaçant, fermé, mortifère. Tandis que dans le second la posture de Jésus relativement sereine révèle quel impact peut avoir la qualité du silence face à une situation inquiétante voire traumatique. Le vide s’avère ici constructif, ouvert, vivifiant. Ceci n’est pas sans rappeler les attitudes préconisées tant dans la cure analytique par Sigmund Freud ou Jacques Lacan71 que dans l’accompagnement spirituel par Maurice Zundel72.
La dimension ternaire, une fluctuation vivante et désirante ?
Au terme de cette réflexion et en reprenant le ternaire lacanien que Charles-Henri Pradelles a associé aux rites Bangoua et aux cultes athéniens antiques, une proposition peut être formulée ainsi : Pourrait-on envisager que la proposition chrétienne – souvent perçue comme rigide et dogmatique – soit en réalité de l’ordre d’une fluctuation permanente et mouvante ? Cette vision offre une perspective dynamique sur le rapport au désir, en particulier à travers trois temps spirituels, trois lieux théologiques : le catéchuménat, le néophytat et la vie mystique.
Catéchumène signifie celui qui fait retentir en lui, celui qui laisse vibrer la Parole. Cela implique l’idée de résonance, car l’enseignement est transmis oralement et fait écho dans l’esprit de l’apprenant. Le catéchumène peut être considéré comme objet du désir du Tout Autre (Dieu ou la communauté qui l’intègre). Pour y parvenir, cela passe par la découverte, l’écoute et l’apprentissage, comme une immersion culturelle et cultuelle avant d’être celle dans les eaux du baptême. Le futur chrétien est dans une position réceptive, où il se laisse transformer par les enseignements et les témoignages qu’il reçoit. Le Verbe se répercute en lui et produit un effet de réel.
Néophyte signifie littéralement « nouveau plant » ou « jeune pousse » et est utilisé pour désigner une personne nouvellement baptisée. Le néophyte peut être considéré comme sujet de son désir. Il est dans une phase où le désir évolue vers une mise en œuvre du don reçu en recevant les sacrements de l’initiation chrétienne. Il n’est plus seulement objet de l’enseignement, mais devient sujet actif de sa vie spirituelle. Le désir ici est celui de grandir, de se développer et de s’épanouir dans la foi chrétienne. C’est également une période de transition où le néophyte cherche à s’enraciner plus profondément dans sa nouvelle identité religieuse et où il fait sien le kérygme d’une communauté de croyants.
Mystique a pour étymologie « initié aux mystères ». On le préférera ici à spirituel pour opérer une distinction car si la spiritualité anime la totalité du cheminement du croyant, tous ne souhaitent pas pour autant s’engager dans une telle aventure empreinte de contradiction. Le paradoxe est que le mystique est quelqu’un qui souhaite vivre une union directe et intime avec Dieu et qui pour y parvenir doit aussi s’en détacher : en quelque sorte il s’agit pour lui de désirer sans désir. Il est dans un au-delà du désir. C’est un état où l’individu aspire à une expérience directe de la présence divine, au-delà des mots et des concepts. La personne mystique est marquée par une quête d’unité avec le divin. Il affronte une béance qui n’est plus comblée par la connaissance ou l’initiation, mais par l’expérience vivante de la grâce divine73.
Ainsi le désir, dans cette progression non linéaire, traverse et transcende les différentes étapes d’une vie chrétienne. Cette vision ternaire n’est pas un système figé car le rapport au désir dans cette perspective devient un cheminement continuel, une quête perpétuelle qui maintient en mouvement constant vers une compréhension toujours plus profonde sinon du divin, au moins de la complexité personnelle.
La psychanalyse, en particulier à travers les concepts de Lacan, éclaire cette dynamique du désir. Le catéchumène, en tant qu’objet du désir du Tout Autre, peut être vu à travers le prisme de l’imaginaire et du symbolique, où la parole et le langage jouent un rôle crucial dans la formation du sujet. Le néophyte, en devenant davantage sujet de son propre désir, navigue entre le symbolique et le réel, cherchant à intégrer les enseignements reçus dans une réalité vécue et pratiquée. Enfin, le mystique, en quête d’une union au-delà du symbolique et de l’imaginaire, aspire à toucher le réel dans une expérience de la jouissance divine. Le désir, dans cette vision psychanalytique, est ce qui pousse le sujet au-delà de lui-même, vers une rencontre toujours renouvelée avec l’Autre, dans une oscillation constante entre manque et plénitude, quête et découverte, parole et silence.
.