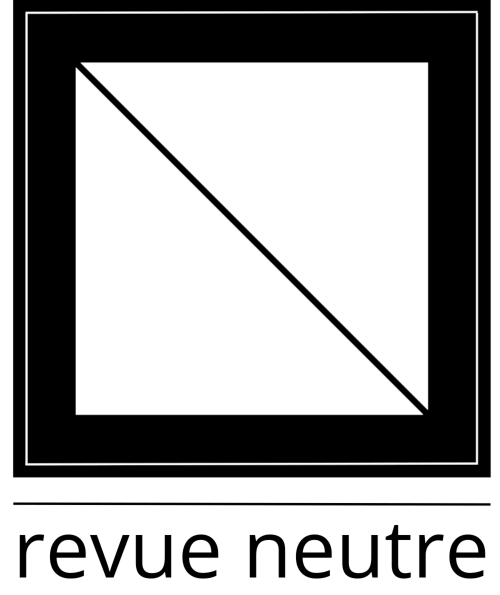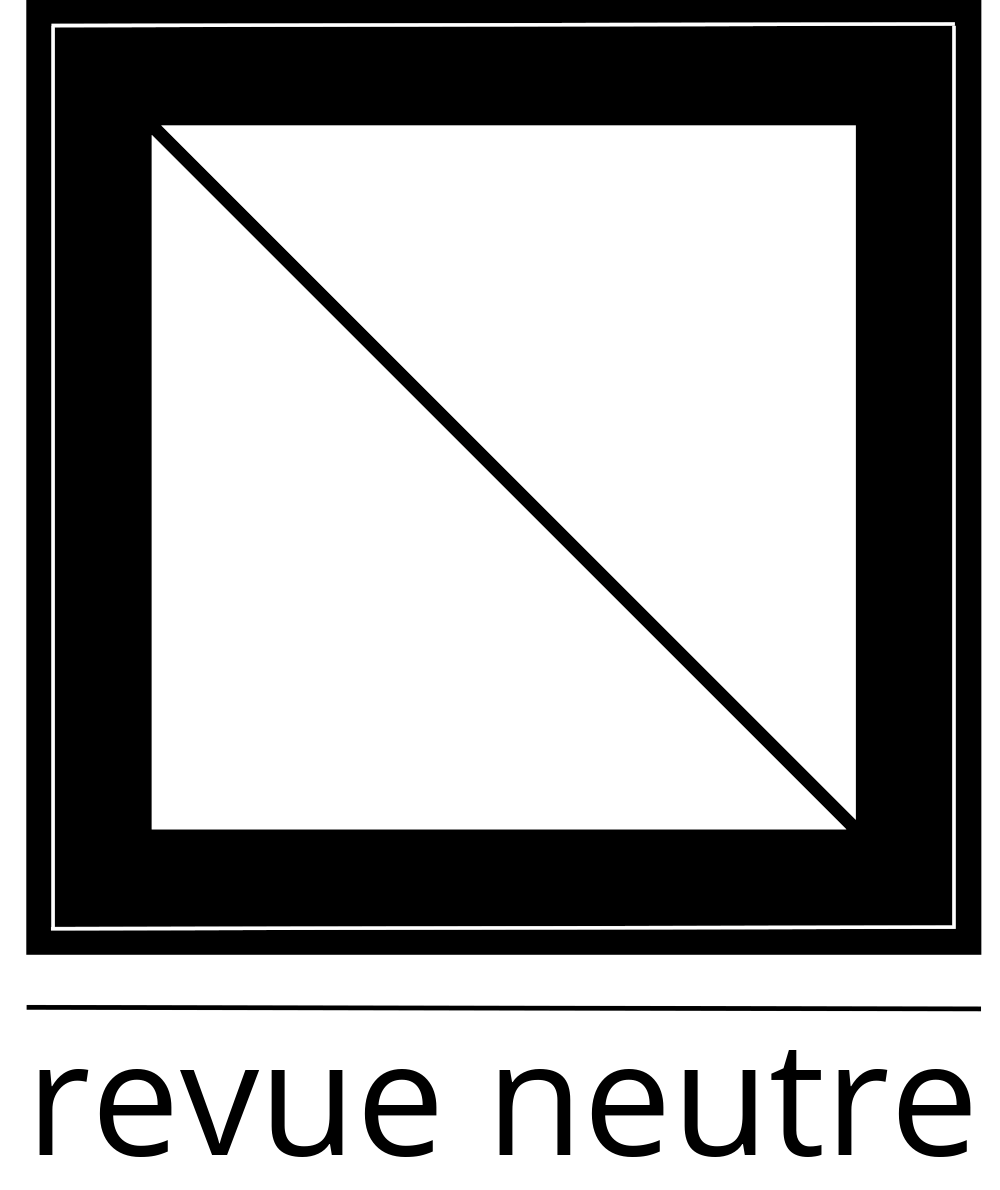TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE
Le désir et ses rites, témoignage de Charles-Henry Pradelles de Latour1
Silvia Artasánchez
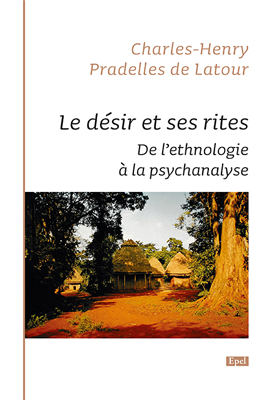 Introduction
Introduction
Le désir et ses rites. De l’ethnologie à la psychanalyse, est le reflet d’une vie de travail et d’expérience de Charles-Henry Pradelles de Latour. Embrassant des dizaines d’années de travail son ouvrage nous permet d’apprécier comment sa recherche d’ethnologue en Afrique s’entrecroise avec sa pratique d’accompagnement thérapeutique de jeunes immigrés africains en région parisienne. Cette trajectoire particulière a permis à C.-H. Pradelles de faire une lecture critique et novatrice du lien entre l’ethnologie et la psychanalyse, qui interroge l’idée d’universalité du complexe d’Œdipe, en s’éloignant des discours dominants de l’anthropologie et de la rationalité occidentale. Son hypothèse est que la réglementation de la jouissance phallique a été rituellement collective avant d’avoir été rituellement individuelle. « Du social à la subjectivité, le sujet du désir a pour point commun ici non pas un contenu – le mythe d’Œdipe ou un “inconscient collectif”– mais une forme rituelle, un même type de coordonnées spatio-temporelles2 ». Dans ce parcours, l’auteur a suivi quelques axes principaux : les structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss, les concepts de rites de Van Gennep, les trois registres de Lacan, la question du neutre et l’acte psychanalytique, entre autres.
À partir des nombreux fils de réflexion que l’ouvrage offre au lecteur nous tenterons d’interroger quelques points.
Témoignage des rites de passage
D’une grande rigueur intellectuelle, C.-H. Pradelles ne parle pas seulement d’un point de vue académique ou théorique, mais aussi de sa vaste expérience de terrain, au Cameroun où il a passé de longues périodes avec les Bamilékés, ainsi que de son travail avec les MNA (mineurs non accompagnés) en banlieue parisienne. Il décrit une série de situations qui lui sont arrivées tout au long de sa vie, liées à son processus de recherche en tant qu’ethnologue, à sa pratique d’accompagnement thérapeutique, aux expériences traumatiques qu’il raconte, à l’expérience de sa propre analyse et à la fin de celle-ci. C’est pourquoi, à partir des expériences subjectives que l’auteur raconte, expériences qui semblent avoir eu valeur de transformation comparables à des rites de passage, se pose la question de la possibilité de lire son livre, Le désir et ses rites, comme un témoignage de ces passages.
Nous partons de l’idée que le processus de recherche peut avoir des effets transformateurs pour l’ethnologue, voire constituer des rites de passage. Dans un premier temps, l’ethnologue est dans une quête pour comprendre la complexité des structures sociales et des pratiques culturelles, des interactions humaines, des croyances et des traditions, des liens interculturels qui peuvent révéler des modèles de comportement plus larges. Cette quête demande une immersion directe de l’ethnologue dans la communauté qui fait son objet d’étude, ainsi qu’une auto-réflexion constante qui lui permet d’analyser la manière dont sa présence peut influencer ou affecter la recherche. Le travail sur le terrain exige du chercheur qu’il s’immerge d’abord dans l’étude du contexte culturel de la communauté à étudier. Cette phase préparatoire n’a pas seulement une fonction de documentation ou de révision théorique, elle permet aussi à l’ethnologue de réfléchir au préalable à ses propres croyances et préjugés : il est ainsi confronté à sa propre identité et aux rôles qu’il joue. Il s’agit d’un parcours similaire au discernement, à l’introspection profonde que l’on observe dans les rites de passage. Pour parvenir à une compréhension plus profonde de la culture analysée, il faut une compréhension plus profonde de soi-même. Comme pour le psychanalyste, il existe pour l’ethnologue une profonde interconnexion entre l’expérience et la connaissance. La préparation est suivie du départ de son propre contexte culturel pour rejoindre la communauté d’accueil. La préparation et la séparation d’avec la vie antérieure, dans ce cas, de sa propre culture, font partie de la phase préliminaire3 des rites de passage et ils constituent les fondements des étapes suivantes.
Par la suite, à son arrivée dans la communauté d’accueil, l’ethnologue est exposé à des dynamiques sociales et culturelles qui lui sont étrangères. Malgré le choc culturel que cette transition implique pour lui, il doit parvenir à établir un lien fort et étroit avec les membres de la communauté afin d’avancer dans ses recherches. Ce moment est un événement important de mise à l’épreuve : saura-t-il s’adapter, résister au choc et aux défis de la rencontre avec ces nouvelles dynamiques totalement étrangères à ses propres cadres de référence ? Sera-t-il accepté par la communauté d’accueil ? Comme dans les rites de passage traditionnels, nous voyons ici se refléter les défis à relever, défis qui, s’ils ne sont pas surmontés, rendront presque impossible la collecte d’informations authentiques.
C.-H. Pradelles a vécu quelque chose de cette nature. Dans un premier récit au début de son livre, il raconte comment il a obtenu la nomination de Tiènja’ chez les Bangoua. Il y a une cinquantaine d’années au Cameroun, C.-H. Pradelles vivait avec sa famille, en tant qu’ethnologue, dans une chefferie Bamiléké appelée Bangoua, pour un séjour de 18 mois. Il menait des recherches sur le système de parenté et les rites qui rythment le cycle de la vie, sur l’organisation sociale et la tradition sociale ; il était en quête : « Telle était à l’époque la mission à laquelle on se consacrait, lorsqu’on était en quête de nouveauté et d’altérité4 ».
Un événement est venu ternir l’enthousiasme avec lequel il menait cette quête ; deux mois après son installation, un des serviteurs du chef a informé ce dernier qu’il avait entendu le secrétaire de mairie conspirer avec ses amis pour l’empoisonner par la sorcellerie. Le lendemain, le chef convoqua les habitants de la chefferie dans son palais, afin que son serviteur jure sur les mânes de ses ancêtres qu’il avait dit la vérité ; le serviteur prêta serment, il avait dit la vérité. Le peuple est alors divisé en deux factions qui se parlent à peine : les partisans du chef et les partisans du secrétaire de mairie. C.-H. Pradelles se trouvait pris entre ces deux factions, qui le poussent à prendre parti et à défendre leurs causes ; face à cette situation, il a décidé d’être prudent et circonspect avec ses interlocuteurs : « J’ai essayé de rester le plus neutre possible5 », ce qui n’a pas été sans difficultés, dit-il, car l’accusation et l’angoisse qu’elle suscitait étaient très sérieuses.
C.-H. Pradelles précise que le chef représentait la tradition qu’il était venu étudier, tandis que le secrétaire de mairie représentait l’administration moderne, à laquelle il appartenait de par son état civil :
J’étais pris, malgré moi, dans les contradictions opposant la tradition et la modernité, sans que je puisse en mesurer la portée ni les conséquences, et mon angoisse grandissait en même temps que mon enquête ethnographique piétinait de plus en plus6.
Neuf mois se sont ainsi écoulés, vécus dans l’inquiétude et dans une position de neutralité, période où l’on retrouve des éléments caractéristiques de la phase liminale des rites de passage : un entre-deux, espace indéterminé de transformation dans lequel le sujet a perdu son statut antérieur, mais n’a pas encore acquis le suivant. Pendant cette période, C.-H. Pradelles s’est trouvé dans une place marginale par rapport à la vie quotidienne, une période de suspension, de suspense et aussi de transition vers quelque chose d’inattendu par lui. Nous verrons vers quoi il a transité.
Au bout de ces neuf mois, les élites du pays ont organisé une réunion au cours de laquelle ils ont persuadé le chef et le secrétaire de mairie de se réconcilier, ce qui a été fait avec succès. À la grande surprise de C.-H. Pradelles, à la sortie de la réunion, un membre de chaque faction est venu le féliciter, lui et sa femme, de n’avoir pris parti pour aucune des deux parties. Une semaine plus tard, à l’occasion du grand marché inter-chefferies, la reine mère du pays, mère du défunt chef, qui jouissait d’une grande autorité, interpella de loin C.-H. Pradelles « en me donnant le nom d’éloge attribué aux enfants des filles du chef7 ». Il s’approcha d’elle et lui offrit un morceau de cola, ce à quoi elle répondit « Me lè zo Tiènja », c’est-à-dire « Je te remercie Tiènja ». « Quelques hommes ont ri et deux femmes ont poussé leur cri strident. Sans que j’en prenne conscience, et encore moins en réalise l’enjeu sur le moment, j’étais nommé8 ». C’est ainsi que les habitants de la chefferie l’appelleront désormais. À partir du moment où il était nommé Tiènja’, C.-H. Pradelles n’était plus un « étranger du dehors », adopté par le chef, mais il était devenu un « étranger du dedans », « assimilé statutairement au fils d’une fille du chef, c’est-à-dire à un de ses alliés9 ». Grâce à cette nomination, C.-H. Pradelles voit s’instaurer un nouvel ordre dans ses relations avec les habitants de la chefferie ; une fois transformé et reconnu comme l’un de ses alliés, les Bangoua sont devenus ses informateurs dans ses enquêtes.
Le changement qui s’est opéré chez C.-H. Pradelles avec sa nomination comme Tiènja’ n’a pas eu d’effets limités à cet espace-temps particulier ; nous conjecturons qu’elle l’a marqué et transformé de manière plus permanente et elle a continué à agir sur lui, même après sa réintégration dans son propre contexte culturel. L’expression et la présentation des données recueillies dans un récit cohérent, l’interprétation des informations obtenues par l’observation active et les entretiens avec les membres de la communauté, ont dû exiger de C.-H. Pradelles de nouvelles perspectives sur sa propre vision du monde. Comment concilier les résultats de sa recherche avec ses savoirs et ses compréhensions antérieurs, en apportant de nouvelles perspectives à son domaine académique ? Nous avançons que la nomination de Tiènja’ l’a ouvert à la compréhension du sens et des conséquences de la relation d’alliance et de la dette symbolique à l’égard du désir, dont il parle dans son livre. De même, la nomination continue d’agir sur lui dans son travail d’accompagnement thérapeutique avec les MNA, sur lequel il écrit que c’est l’expérience de l’ethnologue qui lui « permet de comprendre le positionnement subjectif des alliés à adopter dans ces circonstances10 ». Précisément, les rites de passage opèrent un changement de coordonnées spatio-temporelles, un changement d’état, encadré par un déplacement de lieu et exprimé par une transformation de comportement11. C’est la phase finale d’un rite de passage, la phase post-liminaire : l’établissement d’un nouvel ordre et la réintégration dans le monde, mais d’un sujet qui en sort transformé.
Dimension de rite de passage de la psychanalyse – fin d’analyse
Cette expérience sociale et subjective est relatée dans le préambule du livre. Une deuxième expérience subjective est relatée dans l’épilogue, où l’auteur raconte divers événements traumatisants qui lui sont arrivés dans l’enfance et à l’âge adulte, ainsi que les chemins qu’il a pris dans la vie à la suite de ces événements ; puis il évoque son analyse avec Lacan. Vivant à Strasbourg il devait se rendre à Paris pour quatre séances d’analyse par semaine, soit deux allers-retours de huit heures chacun que, dit-il :
Je passais dans le train à revisiter mes rêves et à tenter d’analyser mes divers comportements. Avec le recul, je me rends compte que j’ai été soumis durant quatre années de suite à une sorte de rite de passage de séparation qui s’est réalisé dans un cadre spatialement délimité par mes nombreux déplacements de la province à Paris, et temporellement par les séances courtes que Lacan effectuait systématiquement avec ses analysants12.
Et plus loin :
Lacan, ne le sachant probablement pas, ramenait ainsi par sa pratique très contestée à l’époque la cure psychanalytique à sa dimension d’un rite de passage, un rite de séparation où j’ai été plus passif qu’actif, ne me rendant pas compte du tout de ce qui se jouait sinon dans l’après-coup13.
Peut-on considérer l’analyse comme un rite de passage ? Certaines de ses dimensions peuvent effectivement être comparables à un rite, tel que le rite de séparation mentionné par C.-H. Pradelles. L’analyse peut amener une personne à traverser des étapes de réflexion, de redéfinition de son identité et d’une nouvelle façon de se rapporter au désir, pour ne citer que quelques éléments, comparables à la façon dont un individu émerge d’un rite de passage, avec un nouveau statut ou une nouvelle compréhension de soi. Dans l’analyse, comme dans les rites de passage il y a quelque chose de l’ordre de la transformation. Mais si la psychanalyse peut avoir des effets transformateurs pour chaque analysant, elle est une démarche individuelle, personnelle, tandis que les rites de passage impliquent une composante communautaire et culturelle, donc ils constituent une expérience partagée socialement.
Dans le cadre de ce qui fut son analyse et de sa fin, l’auteur raconte ce qu’il appelle son « expérience de castration ». Bien qu’il s’agisse d’une expérience personnelle et subjective, elle ne lui était pas totalement inconnue, puisque le rite Bangoua de l’alliance matrimoniale l’avait déjà introduit à la facette sociale de la castration et de la dette symbolique. Ainsi, tout au long de son ouvrage, C.-H. Pradelles développe la thèse selon laquelle, dans les sociétés traditionnelles d’Afrique subsaharienne, la prohibition de l’inceste est fondée sur une séparation entre sexualité prégénitale et génitale, et sur une séparation entre désir sexuel et demande d’amour. C’est quelque chose de cet ordre qu’il décrit comme son expérience de castration. C.-H. Pradelles fait le récit de deux rêves significatifs, pour lesquels il donne son interprétation. Sur l’un de ces rêves, celui de l’accouchement14, il fait la lecture que celui-ci a marqué pour lui un changement d’Altérité, un nouveau rapport au phallus, qui lui semble être le signe avant-coureur de « l’expérience de castration » qui, selon lui, a eu pour effet la levée de la névrose phobique qui l’affligeait depuis l’enfance. Peut-on parler ici d’un effet semblable à un rite de passage, où s’opère une transformation du sujet, d’un changement d’état, de l’établissement d’un nouvel ordre par rapport au phallus ? Cette « expérience de castration », qui lui est arrivée trente ans après avoir arrêté sa dernière analyse, soit quarante ans après sa nomination comme Tiènja’, a commencé, confie C.-H. Pradelles, par une image fantasmée qui s’est imposée à lui pendant plusieurs jours, suivi par de nombreux fantasmes qui se présentaient à lui sous des formes changeantes, jour après jour. « Ce fantasme inhabituel – sans jouissance – indiquait tout d’abord que l’objet majeur de mon symptôme avait disparu. La castration montrait là le bout de son nez15. » Plus loin :
Cette expérience montre deux choses. D’une part, c’est à la fin d’une analyse, lorsque le sujet supposé savoir du transfert est levé, que les fantasmes sont entièrement libérés. D’autre part, c’est par la dislocation de l’aspect synthétique des fantasmes que les sexualités génitale et prégénitale qui les sous-tendent peuvent être nettement séparées, et l’interdit de l’inceste être avalisé16.
Comment peut-on appréhender ou constater la transformation de quelqu’un qui émerge transformé d’un rite post-liminaire, ou qui sort à la fin de son analyse ? Est-il possible de le constater dans un témoignage écrit ? Quels sont les termes ou la mesure pour la constater ? Serait-ce la séparation entre la prégénitalité et la génitalité dont parle l’auteur ? La chute du sujet-supposé-savoir ? La disparition du symptôme ? Tout cela soulève des questions sur ce qu’on peut considérer comme une fin d’analyse et introduit aussi la question de la passe. Concernant cette dernière, une nomination peut avoir lieu et bien qu’il s’agisse d’une expérience individuelle, on peut y trouver une composante sociale, car elle se produit au sein d’une communauté, dans ce cas, une communauté analytique. La passe peut-elle pour autant être considérée comme ayant la dimension d’un rite de passage ?
Colonialité de la psychanalyse et de l’analyste : une problématique
En parcourant le livre de C.-H. Pradelles, on constate qu’il prend ses distances par rapport à la prétention universaliste que la rationalité moderne implique, en s’interrogeant sur l’universalité psychique, c’est-à-dire le fondement de « l’unité psychique de l’humanité » postulée par Devereux, où se pose la nécessité d’accorder le même statut éthique et scientifique à tous les êtres humains, à leurs productions culturelles et psychiques, à leurs modes de vie et de pensée, en dépit de leurs différences17. C’est ainsi que nous arrivons au troisième point qui a attiré notre attention : la problématique de la colonialité de la psychanalyse et de l’analyste. À cet égard, il est pertinent d’évoquer ce que Lacan raconte dans le séminaire L’envers de la psychanalyse, dans la séance du 18 février 1970, quand il parle des médecins togolais qu’il a pris en analyse :
J’ai pris en analyse très tôt après la dernière guerre – j’étais déjà né depuis longtemps – trois personnes du haut pays du Togo, qui y avaient passé leur enfance. Je n’ai pu avoir dans leur analyse de trace des usages et croyances tribales qu’ils n’avaient pas oubliés, qu’ils connaissaient, mais du point de vue de l’ethnographe… ce qui veut dire, étant donné ce qu’ils étaient : de courageux petits médecins qui essayaient de se faufiler dans la hiérarchie médicale de la métropole, dont nous n’ignorons pas – nous étions encore au temps colonial – que tout était fait pour les séparer… ce qu’ils en connaissaient donc du niveau de l’ethnographe était à peu près celui du journalisme. Mais leur inconscient fonctionnait selon les bonnes règles de l’œdipe… c’est-à-dire qu’il était l’inconscient qu’on leur avait vendu en même temps que les lois de la colonisation, forme exotique du discours du Maître, tout à fait régressive face du capitalisme qui est justement ce qu’on appelle impérialisme… leur inconscient n’était pas celui de leurs souvenirs d’enfance – là ça se touchait – mais leur enfance rétroactivement vécue dans nos catégories – écrivez le mot comme je vous l’ai appris l’année dernière – « femme-il-iales ». Et je défie quelque analyste que ce soit – même à aller sur le terrain – de me contredire. Ce n’est pas la psychanalyse qui peut servir à procéder à une enquête ethnographique, ceci d’ailleurs étant dit que ladite enquête n’a aucune chance de coïncider avec le savoir autochtone, sinon par référence au discours de la science dont malheureusement, ladite enquête, elle n’a aucune espèce d’idée de cette référence, parce qu’il lui faudrait la relativer18.
La modernité européenne, dans laquelle s’inscrit la psychanalyse, est inséparable de la colonialité19, de sorte que la pratique analytique se développe dans un contexte colonial. C’est précisément de cela qu’il s’agit dans l’observation de Lacan dans cette séance de son séminaire : son commentaire n’est pas seulement un point de vue clinique, mais aussi un point de vue social et politique. Comme il le souligne, le colonialisme est une forme du discours du maître dans sa facette impérialiste, de domination et d’obéissance, tandis que le dispositif analytique opère précisément en sens inverse, en ce que son traitement de la parole vise à émanciper le sujet, à le libérer de son obéissance aux signifiants-maîtres auxquels il reste fixé.
Ainsi, alors que la colonisation est l’envers même de la psychanalyse20, celle-ci apparaît comme une rupture ou une fissure dans le monde colonial, comme une anomalie qui vient trouer le savoir, la rationalité, la logique et le pouvoir. Dans le cas des médecins du Togo, Lacan a su écouter au-delà de ce qu’il appelle lui-même, non sans ironie, « les bonnes règles » de l’Œdipe21. C’est-à-dire qu’il constate que quelque chose ne va pas… pourquoi ces médecins africains ont-ils fonctionné selon les règles de l’Œdipe, alors qu’ils se souvenaient de leur enfance au Togo ? Le complexe d’Œdipe est-il universel, ou bien la colonisation leur a-t-elle imposé ces catégories « femm-íl-iales » ? Pouvoir se poser ce genre de questions implique de ne pas rester attaché, identifié ou colonisé par un savoir référentiel, dans une obéissance inaperçue aux paradigmes d’une théorie22.
.