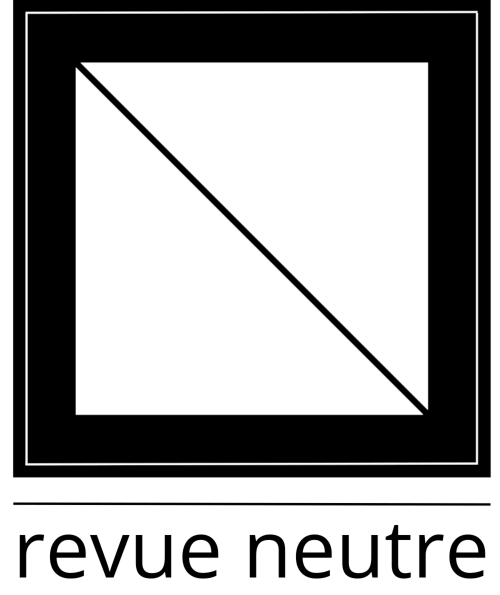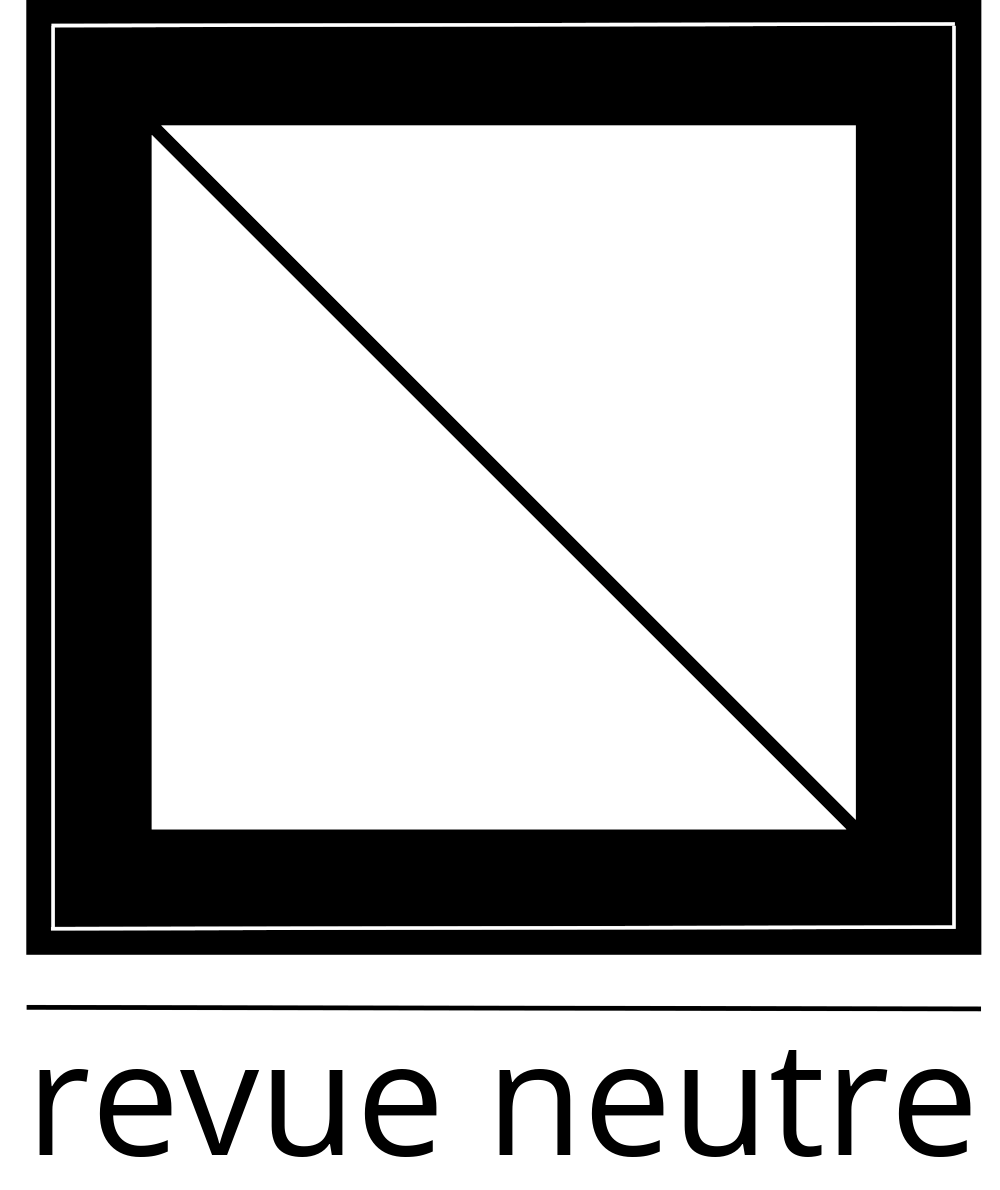TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE

Ninfa dansante, Ninfa amante
Rodolfo Marcos–Turnbull
Traduction : Dominique–Anne Offner
La désobéissance, pour qui connaît
l’histoire, est la vertu originelle de l’homme.
C’est par la désobéissance que le progrès
s’est réalisé, par la désobéissance et la révolte.
Oscar Wilde, L’âme de l’homme sous le socialisme1
La liberté n’est pas état ni idée, mais
mouvement et désir.
André Breton, Arcane 17.
Dans Une femme sans au-delà. L’ingérence divine III, Jean Allouch mentionne la tragédie d’Oscar Wilde Salomé. La curiosité m’a amené à en faire une relecture, et j’ai révisé mes idées préconçues sur ce personnage énigmatique.
Un biais crucial de ma lecture de la tragédie s’est focalisé sur la façon dont, à partir d’un élément, la voix, la voix de Iokanaan, la princesse fille d’Hérodiade se soulève de toutes ses forces face à son beau-père et aussi à sa mère, avec une puissance telle que les funestes conséquences que ce soulèvement provoque, deviennent pour elle une question mineure : il est simplement question de choisir la seule chose qui lui restera après son acte : mourir. Ou, selon les termes de Foucault, elle a préféré « mourir plutôt que mourir2 ».
La référence d’Allouch aux personnages de la tragédie wildienne se résume à un paragraphe :
Une telle expérience se présente à l’envers de ce qui se passe pour le Iokanaan de Wilde qui, lui, se trouve par sa croyance en Dieu empêché (en péché) ne serait-ce que de voir une femme qui l’aime3.
Cette expérience renvoie à la rencontre de quelqu’un comme Ferdinand Alquié « jeune amant désespéré » rencontrant « une femme en elle-même, et sans au-delà ». À partir de là, Allouch développe l’idée de l’existence de « femmes » ayant ces caractéristiques ; sauf que ma réflexion m’a conduit ailleurs, dans la mesure où, d’emblée, les éléments de l’introduction étaient bouleversés : la « femme » ou, plutôt, la personne qui dans ce rapport tenait la place de la « femme » n’était pas ce qui est communément et anatomiquement reconnu comme telle, mais un « homme » : Iokanaan ; et c’était Salomé qui en fait se trouvait dans une position semblable à celle d’Alquié, « frappadingue », selon Allouch. J’ai déjà développé cette proposition à propos de Salomé4. Disons ici, de façon succincte et en suivant Lacan, que « “ homme ” et “ femme ” ne sont que des signifiants et rien de plus5 .»
Voici l’histoire par laquelle on connaît Salomé, brièvement : elle est fille d’Hérodias (ou Hérodiade) et donc belle-fille d’Hérode Antipas. C’est pour cela qu’elle est une princesse. Elle est belle et a une série de prétendants qui veulent l’épouser, non seulement pour sa beauté, mais parce que, de cette façon, l’heureux élu obtiendrait le succès politique, social et, bien sûr, économique. Cependant, il y a quelqu’un d’autre qui veut quelque chose d’elle : le tétrarque lui-même, Hérode. Dans la version wildienne, Salomé s’interroge :
Je ne reste pas. Je ne peux pas rester. Pourquoi le tétrarque me regarde-t-il toujours avec ses yeux de taupe sous ses paupières tremblantes ?… C’est étrange que le mari de ma mère me regarde comme cela. Je ne sais pas ce que cela veut dire… Au fait, si, je le sais6.
De toute évidence, Hérode ne peut s’empêcher de la regarder si bien que Salomé, agacée par le harcèlement de ce regard, fait un premier geste (dans le sens défini par Georges Didi-Huberman7) : elle se retire de la salle de banquet où Hérode offre un grand festin.
Une fois sur la terrasse qui servira de scène pour le reste du drame, Salomé entend une voix qui surgit du sous-sol, une voix vigoureuse provenant d’une citerne aménagée en cachot et qui se trouve, selon les indications scéniques de Wilde lui-même, au centre de l’avant-scène. À la fin du drame, ce sera tout ce qu’il restera : ce lieu vide. Vous en connaissez sûrement la suite : Salomé ordonne qu’on lui amène cet homme à la voix puissante qui s’avère être Iokanaan, prisonnier d’Hérode. Ce dernier est terrifié par les pouvoirs surhumains qu’il suppose à son prisonnier, selon ce que rapporte la rumeur. Après l’avoir vu même sale, en guenilles et disant des sottises au sujet d’un « Sauveur », Salomé en tombe amoureuse et elle se prend de passion pour cet homme qui devient, de ce fait, sa « femme sans au-delà ». Il est en effet incompréhensible que Salomé soit possédée d’une telle manière par cette loque humaine, à moins que l’on sache la force de l’incarpation, qui trouve ici un exemple remarquable8. Elle veut l’embrasser, le posséder, l’aimer et être aimée de lui. Son seul désir est d’être à lui, de n’importe quelle façon et à tout prix. Comme Iokanaan la rejette, la vie de Salomé perd tout son sens. Hérode, de son côté, part à la recherche de sa belle-fille pour lui demander de danser pour lui, en lui offrant en échange quoi que ce soit qu’elle demanderait, « jusqu’à la moitié de son royaume ». Elle « finit » par accéder à sa demande et danse la fameuse « danse des sept voiles » (qui est une invention wildienne). Danse que Wilde lui-même a imaginée à plusieurs reprises, y compris en la faisant danser sur une mare de sang, ou dansant sur les mains ou même nue, seulement couverte de sept voiles. À la fin de son acte, le moment venu de recevoir son dû, et avec un Hérode très « satisfait », Salomé réclame la tête de Iokanaan servie sur un plateau d’argent. Après avoir beaucoup résisté et tenté de négocier, Hérode finit par tenir parole et la lui remet. Salomé embrasse pour la première et dernière fois les lèvres de Iokanaan. Hérode ordonne de la tuer. Nous pouvons résumer la puissance de cette danse avec quelques mots que Paul Valéry met sur les lèvres d’un imaginaire Socrate :
Par les dieux, les claires danseuses ! … ! Quelle vive et gracieuse introduction des plus parfaites pensées ! … Leurs mains parlent, et leurs pieds semblent écrire. .
Et, plus tard, cette fois-ci dans la bouche d’Éryximaque :
La divine pensée est à présent cette foison multicolore de groupes de figures souriantes ; elle engendre les redites de ces manœuvres délicieuses, ces tourbillons voluptueux qui se forment de deux ou trois corps et ne peuvent plus se rompre… L’une d’elles est comme captive. Elle ne sortira plus de leurs enchaînements enchantés ! …9 .
Le duende
Il y a un point de mon livre sur Salomé10 que je voudrais revisiter et retoucher ici parce qu’il porte sur un point décisif dans l’interprétation que je propose de donner du personnage : la relation de Salomé avec l’élection de sa forme d’expression, la danse. Il s’agit de l’approche d’une notion conceptualisée par Federico García Lorca et abordée sous l’angle des soulèvements par George Didi-Huberman : le duende.
Didi-Huberman se tourne vers Georges Bataille pour attirer l’attention sur la façon dont, du point de vue de celui-ci, opère le désir, et c’est Bataille, d’abord, qui prend comme référence l’idée d’un soi-disant esprit espagnol, le duende qui peut influencer envahir serait peut-être plus approprié l’artiste andalou, plutôt gitan mais, par extension, l’artiste en général, avec la puissance du soulèvement. Peut-être le plus curieux est-il que le « terme », le « concept », la « notion » ou ce que forme le duende, ait émergé au moins en ce qui concerne la réflexion intellectuelle dans une conférence sur ce sujet donnée par Federico García Lorca11 à Buenos Aires. Bataille, très impressionné par ce qui se passait en Espagne dans les prémices de la Seconde Guerre mondiale, voyait dans la Guerre civile espagnole des éléments pour identifier le mouvement libertaire du sujet.
Mais le duende se situe vraiment ailleurs.
De la même manière que le désir, dans la conception de Didi-Huberman qui prend appui sur García Lorca , le duende surgit d’un « intérieur » du sujet. Mais est-ce vraiment le cas ? Le duende est-il uniquement le produit de « quelque chose » d’isolé qui se déplace dans « l’intérieur » de quelqu’un ? Cela ne semble pas possible. Cela signifierait une autonomie qui n’est pas tout à fait possible. Il fonctionnera à condition que nous intégrions au concept l’approche que Lacan fait dans L’éthique de la psychanalyse en se référant à la sublimation, avec l’extimité12, c’est-à-dire, une « extériorité intime ». Je ne trouve pas beaucoup de différence entre ce que Lacan décrit par rapport aux artistes primitifs qui ont laissé leur empreinte dans les grottes d’Altamira, par exemple, et l’idée de l’artiste gitan, pour quiconque pourrait se tenir habité par le duende.
La conférence que le poète grenadin a donnée s’intitule : « Théorie et jeu du duende ». Là, elle cherche seulement à rendre compte du mouvement intérieur de l’inspiration artistique, réduite à trois arts ceux–là mêmes qui se retrouvent dans un genre par ailleurs proche de son cœur : le flamenco, qui doit inclure le cante jondo, la tauromachie et la danse flamenco musique, poésie et danse. Bataille, cependant, a vu dans le « concept » du duende quelque chose de plus étendu qui comprenait la peinture. Dans le Guernica de Picasso, le penseur français ne remarquait pas seulement des éléments de la « morale de la rébellion » apparentée au surréalisme français, mais surtout des éléments de cet anarchisme qui parcourait les peuples d’Andalousie et, plus encore, des éléments constitutifs de « l’Espagne libre ». Bataille percevait ces traits dans les tablaos13 où se réunissaient las peñas flamencas14 : de la peinture à la musique, à la danse, à la libération politique.
Il ne serait pas du tout étrange que García Lorca eût conçu aussi ces éléments s’il avait vu le terme avec les yeux de la rébellion, ou mieux, de la dissidence à laquelle il appartenait et qui a fini par lui coûter la vie, à 38 ans. Lui aussi a préféré « mourir plutôt que mourir ». Mais le fait est que sa conférence ne touche que des aspects intimes de la création artistique, sans pour autant exclure au moins un élément de son statut social, d’autant plus qu’il ne cesse pas de considérer que, s’il existe une chose telle que le duende dans la création artistique, celui-ci ne pourrait avoir lieu que grâce à la présence, dans la vie quotidienne, de la mort. Trait de l’Espagne, note le poète grenadin, d’une validité et d’une valeur uniques au monde et qui, selon lui, ne peut être assimilé qu’à un autre peuple, puisque là aussi « la mort y est autorisée » : le Mexique. L’importance de la mort dans cette question est telle que pour García Lorca, « […] le duende ne vient pas s’il ne voit pas de possibilité de mort, s’il n’est pas sûr pas qu’elle va rôder autour de la maison, s’il n’est pas certain qu’elle va secouer ces branches que nous portons tous, et que l’on ne peut pas, que l’on ne pourra jamais consoler15 ». En d’autres termes, avec le duende s’instaure une érotique qui implique comme condition que celui qui « l’a », c’est-à-dire celui qui « a un duende » comme on dit, n’aura aucun réconfort face à la perte, quelle qu’elle soit.
Selon Federico García Lorca, le flamenco ne peut atteindre son but que si l’on considère que celui qui le crée et celui qui l’exécute sont habités par le duende, par ce qui incarne, au regard du sentiment national, « l’esprit caché de la douloureuse Espagne »16.
Cependant, dans toute l’étude, sa référence constante est, pour l’essentiel, l’Andalousie. Il ne nie pas que le duende puisse avoir une présence dans d’autres lieux, même en dehors de l’Espagne, et fournit quelques exemples à ce sujet (Paganini expliqué par Goethe ; De Falla, grâce à ses « sons noirs » ; Sainte Thérèse ; Goya, certainement et en premier lieu ; la musique arabe ; même un anglo-saxon comme John Keats).
L’étymologie nous aidera à définir le duende. Selon le Dictionnaire Étymologique Corominas17, duende est une forme ancienne de « propriétaire d’une maison » comme contraction de « duen de casa » où le premier mot est la forme apocopée de propriétaire. Il veut dire : « Fantôme, esprit espiègle qui apparaît brièvement » ; plus concrètement, « l’esprit censé habiter dans une maison ». Moliner est plus percutant : « Fantôme. Esprit que les gens croient habiter dans un endroit, par exemple, dans une maison abandonnée… en Andalousie : grâce ou charme ineffable. En particulier celui qui s’apprécie dans le chant ou la danse ou dans ceux qui les exécutent18 ». Plusieurs éléments peuvent être mis en évidence : le duende, ineffable, se trouve dans une maison, mais peut-être pas n’importe où. En tout cas, la maison pourrait être la sienne, ou, plus encore, dans la maison qui est le corps propre ; peut-être dans des conditions d’extase, puisque, comme le souligne García Lorca :
J’ai entendu un vieux maître guitariste dire : « Le duende n’est pas dans la gorge ; le duende remonte par-dedans depuis la plante des pieds ». Ce qui veut dire que ça n’est pas une question de faculté mais de véritable style vivant ; c’est-à-dire, de sang ; de très vieille culture et, tout à la fois, de création en acte 19 .
C’est là ce qui précisément attire l’attention de Bataille et de Didi-Huberman. En d’autres termes, le duende surgit d’un intérieur extime au sujet qui s’attache au désir (velle), pour produire quelque chose qui ne peut pas être mis en mots mais qui peut être transmis. Mais alors, si le soulèvement occupe la place du désir, ou se trouve à ses côtés, le duende incarné dans la création ou l’exécution esthétique implique, également par nécessité, une participation à ce soulèvement : peut-être, dans ce cas, aux règles établies d’une expression artistique acceptée par la société. C’est-à-dire, le duende, ineffable, quand il a lieu, est un soulèvement artistique… et plus.
Le duende et le désir partent de « ces » profondeurs, s’enchevêtrent et deviennent une unité qui peut se manifester, selon le poète, « dans une idée, dans un son ou un geste20 ». Ainsi, par exemple, on ne peut danser le flamenco (ou une danse comme celle des sept voiles de Salomé, ajouterai–je) qu’à partir d’un soulèvement, avec l’intermédiaire du duende et ayant pour conséquence que les voiles sont littéralement levés (sept) dans un mouvement qui devrait être dionysiaque. Didi-Huberman dit à ce sujet :
Nous nous retrouvons donc très proches tant de la puissance nietzschéenne que du duende, selon García-Lorca […]. C’est une véritable puissance la danse dionysiaque, la danse jondo qui élève les âmes et les corps très loin de « toutes les volontés de pouvoir21 ».
Alors que García Lorca définit le « duende » (suivant Goethe), comme un « pouvoir mystérieux que tout le monde ressent et qu’aucun philosophe n’explique », il s’agit vraiment d’une puissance, parce que, premièrement, c’est une possibilité et le pouvoir est un fait. De plus, García Lorca précise que c’est l’esprit qui a embrasé Nietzsche. Il est plutôt, ajoute-t-il, l’héritier du Daimon socratique, lui aussi ineffable.
La vraie lutte, achève Federico García Lorca, est avec le duende.
Le/la duende
Le duende nous conduit aussi vers d’autres endroits. En effet, il a une caractéristique que García Lorca n’aurait pas pu considérer, et que nous proposons maintenant : le duende est une figure du Neutre. Donc : le/la duende est une figure du Neutre22.
Le Neutre a donné lieu à un cours de Roland Barthes, en 1978 au Collège de France, à la place de son précédent « séminaire ». Le cours, dit-il, devait s’appeler : « Le désir de Neutre ».
Barthes est clair concernant ce qui constitue une « figure » : elle est une « allusion rhétorique […] qui a un “air”, une “expression” : fragment non pas sur le Neutre, mais dans lequel, plus vaguement, il y a du Neutre23 ».
S’il est vrai que les figures du Neutre, telles qu’elles sont exposées par Barthes, n’ont pas donné figure humaine à l’approche du duende comme l’une d’entre elles, cela est permis en premier lieu à partir de sa même racine étymologique. Le Corominas revient à notre aide. Si duende est la forme apocopée de « dueño de », sa « masculinisation » est équivoque, et duende serait autant l’apocope de « dueño de » comme de « dueña de »24. C’est-à-dire que l’on ne peut pas penser le duende avec l’idée qu’il porte sur une figure dont le modèle serait un homme (ou, une femme). Ni… ni…, donc.
Lo duende ? Le problème est que l’usage idiomatique a associé au terme l’article du genre masculin, peut-être parce que, s’agissant d’un charme (neutre), un esprit (aussi neutre) ineffable (le mot dit presque tout), il s’est masculinisé (charme est encanto en espagnol, nom masculin, aussi comme l’est esprit : espíritu). Finalement, si dans une autre de ses définitions, on le considère comme fantôme (celui qui habite dans une maison), nous aboutissons à une situation similaire : le mot n’a pas de genre bien que nous soyons trahis par l’usage de la langue.
Alors, la première définition de duende du Diccionario de la lengua española doit être pensée dans ces termes, même si, en évitant l’étymologie, sa première acception la définit de la manière suivante : « Esprit fantastique avec une figure de vieillard ou enfant dans les récits traditionnels qui habite dans les maisons et est la cause de dérangements et vacarmes ».
On pourrait penser, alors, que la question du genre à lui attribuer a surgi dans l’académie qui avait donné une seule forme au duende, la masculine ; il reste encore à savoir quand, dans ces récits, on lui avait donné un tel genre et pourquoi l’avoir limité au masculin. N’y avait-il pas des duendes féminines dans l’antiquité espagnole ?
Allons au Neutre de Barthes « Notre visée n’est évidemment pas disciplinaire : nous cherchons la catégorie du Neutre en tant qu’elle traverse la langue, le discours, le geste, l’acte, le corps, etc.25 » Son argument précise : « Je définis le Neutre comme ce qui déjoue le paradigme, ou plutôt, j’appelle Neutre tout ce qui déjoue le paradigme. Car je ne définis pas un mot ; je nomme une chose : je rassemble sous un nom, qui est ici le Neutre26 ». Et quelle chose, introduite comme « un propriétaire de maison », « un charme », « un esprit ineffable », « un fantôme qui entraîne dérangements et vacarmes » peut échapper à cet argument minimal ? La visée de Barthes va au-delà d’un accident linguistique.
Le paradigme que le duende fait échouer serait d’un côté sa localisation dans un binarisme sexuel ; mais de l’autre, les formes mêmes de la danse qui, dans le flamenco, se manifestent, selon Didi–Huberman, dans les « solitudes ». « Refuser de plier son corps à la contrainte de l’unique et de l’unité. Tout faire, en revanche, pour se plier-déplier sans cesse, pour se multiplier soi-même. » Il est le « géomètre immédiat de son corps en mouvement. Il ne crée pas ses rhizomes à l’aveugle ou, si j’ose dire, par-dessus la jambe ». Pour souligner son caractère unique, García Lorca dit qu’: « il doit mesurer lignes, silences, zigzags et courbes rapides avec un sixième sens de parfum et de géométrie…27. »
Pour donner substance de quelque façon au Neutre, Barthes fait appel à une figure qui, d’autre part, est au centre même du flamenco : « la sourcellerie fantaisiste28 ». On ne peut pas comprendre la danse flamenco sans avoir à l’esprit son côté « sortilège ».
Mais, peut-être l’élément le plus important de notre approche du duende comme figure du Neutre, se trouve dans une autre figure : le pathos que Barthes fait équivaloir au désir. « Parce qu’il y a un désir de Neutre : un pathos (une patho–logie)29 ». Eh bien, ce pathos, toujours présent dans le flamenco, est « expérimenté par opposition à he pathé, état passif ». Barthes trouve le discours sur le pathos résumé dans la volonté de puissance de Nietzsche (de façon similaire au duende de García Lorca) : « la passion de la différence » ou le pouvoir d’être affecté, qui signifie « affectivité, sensibilité et sentiment ». García Lorca, pour sa part, le caractérise comme pouvoir plutôt qu’agir : c’est lutter par opposition au penser. L’on peut, même, approcher davantage le duende comme figure du Neutre quand on se rend compte qu’il s’agit aussi de ce qu’Aby Warburg appelle Pathosformel (formule du pathos) : il consiste, de façon très résumée, dans la conservation des gestes30 des cultures humaines. García Lorca ajoute : « La figure du duende présuppose toujours un changement radical de toutes les formes des plans anciens ». C’est ce « toujours » qui lui donne son aspect de formule, et en même temps indique qu’il est à l’origine d’un changement, que le geste s’accomplit, comme nous l’avons déjà vu31, comme tout premier exercice du soulèvement.
Barthes évoque, en passant, une figure « suggérée » du Neutre : la voix. Il nomme à son propos l’objet a de Lacan. Mais il s’abstient de développer cette possible figure de Neutre et l’écarte comme « un faux bon sujet32».
Cependant cet objet cause du désir s’avère décisif dans ce qui soulève Salomé.
Dans Salomé, de manière exemplaire, la voix suscite le désir de façon ravageuse. En d’autres termes, la voix étrange est le véhicule de la révolte intérieure de Salomé :
Salomé : Qui a crié cela ?
[…]
Salomé : Quelle étrange voix ! Je voudrais bien lui parler.
Premier soldat : J’ai peur que ce soit impossible, princesse. Le tétrarque ne veut pas qu’on lui parle. Il a même défendu au grand prêtre de lui parler.
Salomé : Je veux lui parler.
Premier soldat : C’est impossible, princesse.
Salomé : Je le veux.
La nymphe dansante
Des années avant de devenir commissaire de l’exposition Soulèvements, Georges Didi-Huberman a commencé à écrire une série de livres sur un motif et/ou « qualité » propre à la peinture du Quattrocento. Ce motif a d’abord captivé Aby Warburg et a entraîné, à la suite de ses analyses, un changement radical dans la critique esthétique. Ce que Warburg a découvert dans l’iconographie de la Renaissance (principalement italienne), c’est la présence de ce qu’il a nommé Ninfa. Didi-Huberman a écrit à ce jour quatre livres orientés tous par le même terme : Ninfa Moderna (2002), Ninfa fluida (2015), Ninfa profunda, (2017) et Ninfa dolorosa (2019). Le texte de présentation de l’exposition Soulèvements, qui comprend des références à la nymphe, a servi de base à la publication en 2019 de Désirer désobéir, Ce qui nous soulève.
Mais la nymphe n’est pas une découverte de la Renaissance, même si c’est là que Warburg a pu « concevoir » sa notion. La Nymphe « classique » est grecque, c’est-à-dire qu’elle se trouve dans les mythes33 des Grecs anciens : ou bien elle est une demi-déesse aux traits uniques ; ou bien, mortelle, elle est une héroïne. Mais aussi on appelle « nymphe » une fiancée. Quand on se réfère à une mortelle, c’est à sa condition sexuelle qu’on le fait. Les nymphes correspondent aux esprits de la nature qui habitent les champs, les rivières et les mers. Elles personnifient la grâce et la beauté de la nature et, bien qu’elles soient considérées comme des divinités secondaires, elles peuvent exercer une énorme influence sur d’autres dieux et sur les hommes et les femmes ; elles apparaissent souvent dans les récits où l’amour et/ou le sexe est présent. Elles sont impliquées dans les histoires de Daphné, Echo, Calisto, etc. Très souvent, elles sont liées, y compris sexuellement, avec les dieux primaires, Zeus, Apollon, Hermès, Dionysos ; l’une des principales est Némésis (rien à voir avec l’idée généralement associée à ce nom) qui deviendra Léda, la mère d’Hélène de Troie. En tout cas, les nymphes ont un pouvoir vital sur les hommes, à tel point que Socrate lui-même est considéré comme « possédé par elles », ce que nous verrons plus loin. Parmi les diverses caractéristiques des nymphes, une est particulièrement importante ici : elles aiment la danse. Didi–Huberman en décrit une notion « moderne » : « divinités mineures sans pouvoir “institutionnel”, mais irradiant d’une véritable puissance à fasciner, à bouleverser l´âme et avec elle, tout possible savoir sur l’âme34 ».
La Renaissance, à travers sa peinture, a pris les nymphes comme un « accessoire » de ses motifs principaux (La naissance de Vénus de Botticelli, par exemple). La nymphe qui attrape Warburg est, selon les mots de Didi-Huberman :
Toujours fuyante, toujours là cependant. Inaccessible, volatile mais revenante jusqu’à hanter (comme le duende ?), jusqu’à s’enter, se fondre en toute chose : essentiellement fluide, donc. Telle est Ninfa, cette étrange créature dont on serait bien en peine d’établir une identité, de retracer une iconographie ou de reclore une histoire. Ni personnage tout à fait, Ninfa n’offre qu’un erratique mais ô combien insistant leitmotiv dans la longue durée des images occidentales35.
Ce qui attire l’attention de Warburg, et que Didi-Huberman reprend pour l’importer ailleurs, c’est, entre autres, la volatilité, la légèreté, la transparence des voiles qui couvrent les figures des nymphes dans les tableaux de la Renaissance italienne, notamment, dans ceux de Botticelli, Ghirlandaio, Bernini et beaucoup d’autres, mais qui impliquent par eux-mêmes (selon la composition) quelque chose d’autre : « De plus, la Nymphe de Warburg transporte avec elle, outre sa grâce fondamentale comparable à celle de la Gradiva chez Freud, une fonction critique capable de “renverser toutes les valeurs”… ». Il précise plus avant :
Un suaire blanc posé immobile sur un corps, mais qui tout à coup s’agite, se soulève, devient robe de mariée ou drapeau hissé en haut d’un arbre avant de se déchirer joyeusement, voilà bien qui manifeste dans les surfaces ou dans ce qu’Aby Warburg nommait les « accessoires en mouvement », en référence à ce qui aura traversé l’histoire des arts comme l’un des plus antiques « formants esthétiques », je veux dire la draperie la force des soulèvements36.
Cette transmutation soutenue par « la force des soulèvements », de toutes les valeurs et dans tous les ordres, fait partie de ce que le soulèvement de Salomé a produit (sauf chez Ioakanaan) tant par sa danse que par l’exigence de sa récompense, parce que, entre autres traits, la force de la nymphe est irrésistible. Si les nymphes des maîtres de la Renaissance étaient représentées dans leurs grands tableaux, ceux-ci, dans la conception de Warburg, ne restèrent pas statiques : comme les nymphes elles-mêmes, ils transmutèrent. Des années après sa « découverte » en tant que nymphes charmantes (comme la Ninfa fiorentina), un Warburg en sursaut se sent poursuivi (possédé ?) par une variante de la figure : la Ninfa crudele, ou selon ses propres termes, la « chasseuse de têtes ». Évidemment, une référence à la très vaste iconographie de la Renaissance de Judith et, bien sûr, Salomé.
Les Grecs reconnaissaient le pouvoir des nymphes pour « d’abord rendre fou » quelqu’un : Quem deus vult perdere, dementat prius, comme le rappelle Ruth Padel37. Déjà dans le Phèdre, Socrate reconnaît qu’il serait possédé par les nymphes (ce qui, entre autres significations, signifie « source »), à partir du moment où il ferait la louange du bien-aimé et non de l’amant. Celui qui est possédé par les nymphes est possédé par la divinité et touché par quelque chose qui le transporte au-delà de lui-même, « hors du moi », comme le rappelle Didi-Huberman. L’émotion que produit cet hors-soi est de l’ordre de l’événement : en d’autres termes, il ne peut être évité.
Roberto Calasso apporte un élément fondamental pour analyser par ailleurs la cause du frappadingue et l’effet produit par les nymphes (et, par extension, par Salomé et sa danse) ; il dit :
Le Phèdre traite des simulacres qui guérissent. Socrate veut avant tout nous montrer comment, de cette maladie qui est la manie et, dans son cas, au moment même où il parle, du délire du nympholeptos, le seul remède et libération vient du délire même […]. Et le Phèdre lui-même peut être compris comme le récit du remède offert aux Nymphes et par les Nymphes…38
En d’autres termes, la folie que portent les nymphes trouve son origine et, en même temps, son but et, si l’on peut dire, sa « résolution », en elles-mêmes. C’est le cas rare où l’agent et l’objet correspondent.
Hérode offre à Salomé de lui donner ce qu’elle voudrait, « tout, fût-ce la moitié de mon royaume », sauf que ce qu’elle veut, c’est uniquement posséder Iokanaan. Une fois que Salomé a épuisé la tentative de l’obtenir par les mots, et face à la répudiation persistante de celui-ci, l’occasion lui est offerte d’y accéder par un autre moyen. La danse, qui en principe se présente comme la réponse à la demande d’Hérode pour satisfaire sa lascivité, devient alors pour Salomé la dernière opportunité pour, au moins, attirer l’attention du Prophète, même au fond de la citerne où il se trouve. Elle échoue. Mais seulement selon les apparences, parce que la danse des sept voiles est, dans son fond, la mise en acte, sans mots, du soulèvement de Salomé. Cette danse s’inscrit dans le réel et l’imaginaire, le symbolique est manifestement exclu. Salomé se confronterait, à la fin de sa danse, avec une vérité insupportable : elle ne peut pas accéder à Iokanaan, parce qu’elle trouvera toujours seulement les trois in-existences manifestées dans l’incarpation de son bel homme. Ces in-existences sont celle de l’Autre, celle du rapport sexuel et celle de la jouissance de l’Autre. Le point crucial de ces affirmations tranchées concerne la conception de l’Autre qui n’existe pas. Ici il signifie un lieu où quelque chose n’aura pas eu lieu. Autrement dit, cette chose qui n’a pas abouti (le rapport sexuel entre Salomé et Iokanaan) devient, dans cette pièce, la seule chose qui reste : un lieu où l’objet (Iokanaan) va s’évanouir. Ce lieu vide sera ce à quoi Salomé va se rapporter39 .
La danse, donc, ne va pas non plus lui donner ce qu’elle désire. Danser comme elle le fait implique de rejeter toutes les « autres » offres d’Hérode. Et si les analyses les plus savantes et la critique généralisée ont voulu voir la danse comme un acte strict de provocation et de séduction adressé à Iokanaan, à Hérode ou à sa mère et même à tous les trois, je postule, au contraire, que c’est un acte qu’elle s’adresse à elle-même. C’est un acte de la nymphe dansante vers la nymphe amante. Si la danse (au moins dans l’imagination de Wilde) impliquait de se dépouiller peu à peu des voiles, les soulever et « posséder » Iokanaan, son acte fait appel à elle-même et à son soulèvement : elle sait que la récompense ne sera pas ce qu’elle désire, elle sait aussi que, comme disait García Lorca, la mort, comme chez le duende, est ce qui sera sa fin. Dans les termes de Anne Onime : « Une mort sexuée en somme » … pour « faire du mourir un acte40 ».
Je termine par une petite réflexion de Lucien : « la danse […] rend intelligible l’obscur41 ».