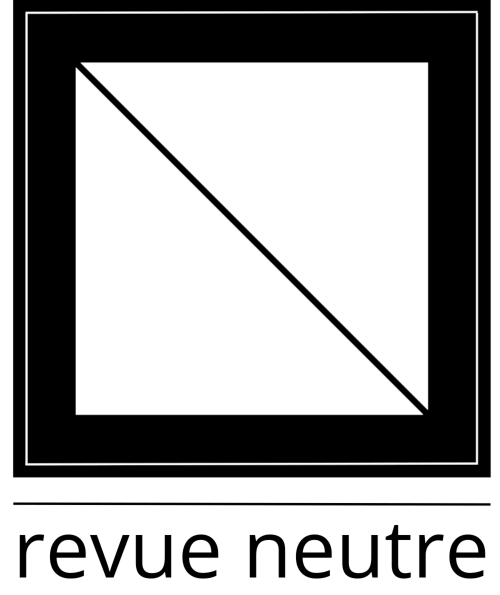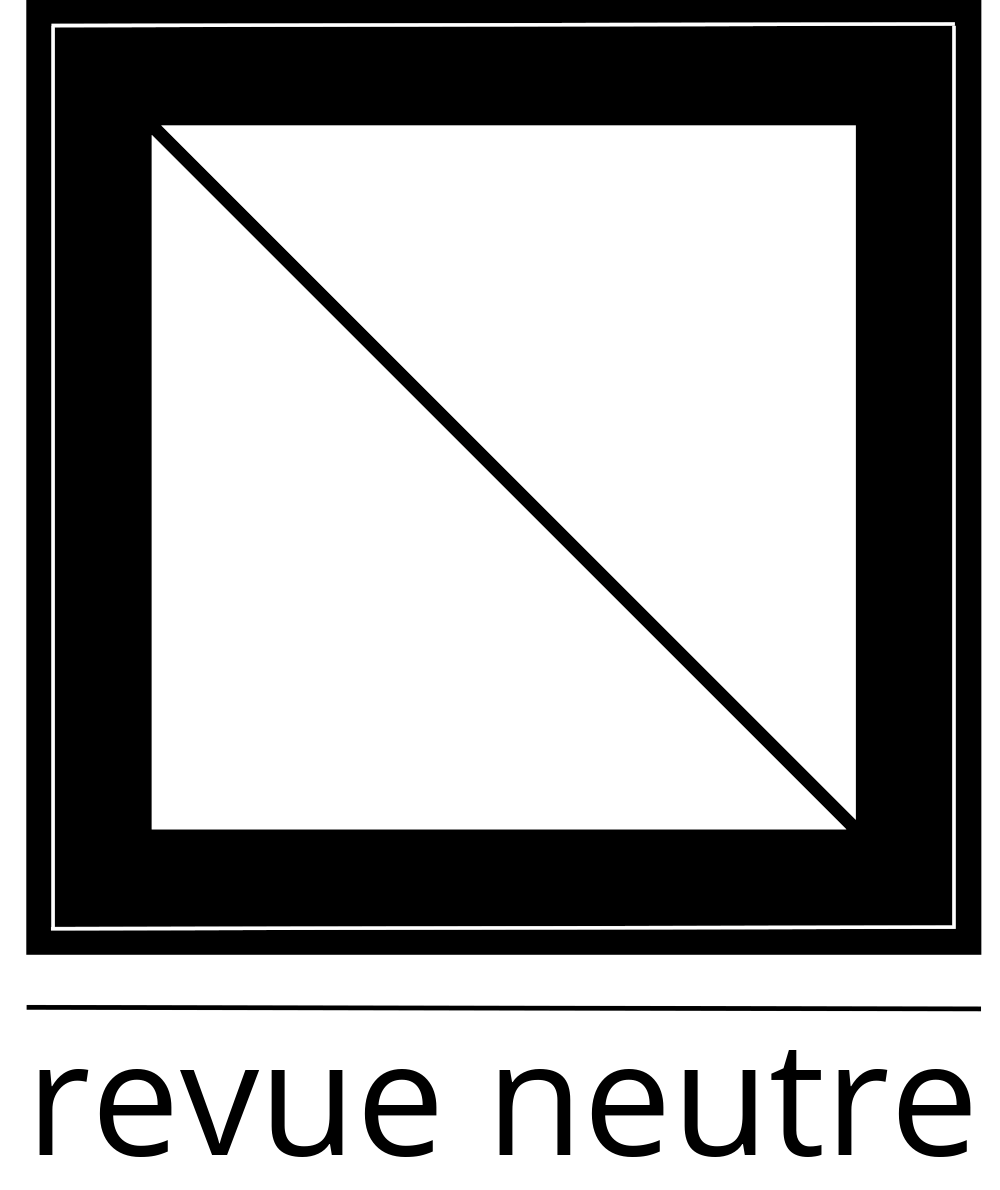TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE
« Chérissons la brouillardise » *1
Simone Wiener
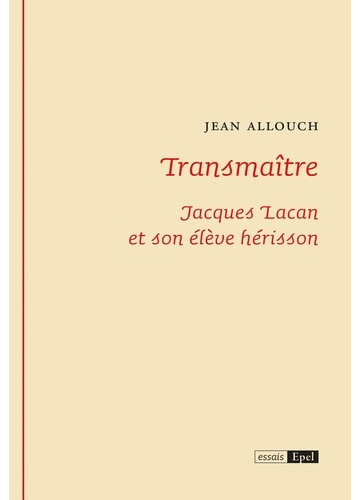
À propos du livre de Jean Allouch,
Transmaître. Jacques Lacan et son élève hérisson2.
Le livre me semble important dans le frayage de l’œuvre de Jean Allouch. Il soulève et réfléchit à des questions cruciales notamment concernant la fonction du maître. Cette question intéresse particulièrement l’association Encore non structurée autour d’un maître incarné, préférant laisser un vide à cette place.
Je vais évoquer quelques points qui ont traversé ma lecture. Ce sera une façon de mettre en perspective certains aspects et thèmes du travail de Jean Allouch qui m’ont profondément inspirée et marquée. Il y a son enseignement mais aussi son style, qui passe dans cet écrit, que je vais essayer de déplier.
Cet ouvrage commence par interroger ce qui définit la qualité de maître et celle d’élève en relevant différentes possibilités. Lacan avait ses élèves et il a fondé son école en prenant modèle sur les écoles philosophiques de l’antiquité. Ces dernières se définissaient comme des lieux d’enseignements mais aussi comme des lieux thérapeutiques et de vie.
L’auteur fait une remarque sur la manière dont Lacan se positionne dans son adresse au public. Il rappelle une de ses formules à la fin de son texte d’ouverture des Écrits qui suggère à ses lecteurs d’« y mettre du sien3 ». Il interroge si cela s’adresse uniquement à ses élèves, ou si c’est destiné à un public plus large4. Cette invitation consiste-t-elle à privilégier l’élaboration d’un cheminement ou se limite-t-elle à suggérer une position de disciple zélé ? En d’autres termes, est-ce que le lecteur de Lacan est forcément mis en position d’élève5 ? C’est à cet endroit que Jean Allouch a cette trouvaille, ce bon mot de « brouillardise », – lequel fait résonner brouillon et brouillard, qu’il ne cherche pas à dissiper, au contraire, car cela lui permet d’ouvrir un certain nombre de questions que voici :
– En quoi le style de Lacan a-t-il pu le situer dans une position de maître ? Et de quelle sorte de savoir s’agit-il ?
– Quel type de lien érotique au sens du transfert, Lacan a-t-il cherché à instaurer avec lui, son analysant, avec l’élève « hérisson » comme il se désigne lui-même6.
Ce bon mot de « brouillardise » suggère l’idée d’un savoir troué, non exhaustif. Il s’agit d’autre chose, et c’est ce qui le rend précieux. C’est aussi présent, me semble-t-il, dans le jeu de mot du titre de cet ouvrage Transmaître qui met l’accent sur Trans et laisse échapper le « mettre » en l’écrivant maître.
Pour définir le style de Lacan, l’auteur propose un certain nombre de formulations. Je les ai trouvées tellement fortes et bien dites que je les cite :
La parole de Lacan s’apparie au silence. Elle charrie un noyau d’opacité et d’ambiguïté irréductible à toute tentative d’analyse discursive. Le verbe obéit au souffle d’un rythme qui lui confère une puissance d’évocation souveraine. Même lorsqu’on ne saisit pas complètement sa pensée, on appréhende tout de même quelque chose, un riche réseau d’implication occultes qui éveillent des résonances multiples7.
Nous pourrions croire, en effet, qu’il s’agit d’un énoncé qui caractérise la parole de Lacan. Mais ce n’est qu’une impression car, un peu plus loin, l’auteur révèle que c’était un trick, il nous a fait une blague, car il ne s’agit pas du tout d’un commentateur de Lacan mais d’un certain Jean Levi qui écrit cela à propos de Confucius dans son article : « Confucius ou l’impossible filiation ». Cette proximité de style tend d’ailleurs à démontrer que Lacan était un maître, au sens où Confucius l’était8.
Ce qui m’a intéressée dans cette référence, outre qu’elle est pertinente, c’est le côté espiègle dont Jean Allouch fait preuve, en les rapprochant. À travers cette façon de faire, je relève un élément caractéristique de son style, son lien particulier au public. Il s’adresse à lui, le sollicite, joue avec et le fait marcher. Il est rare qu’un auteur joue ainsi, à l’écrit, avec ses lecteurs. Il y a quelque chose de très vivant qui passe dans cette manière d’interpeller ses lecteurs, de susciter et jouer de la surprise et de mettre ainsi en question certaines idées installées comme des vérités. Cette adresse au public, il l’utilisait aussi à l’oral dans ses séminaires lorsqu’il le mettait à l’épreuve concrète de répondre à certaines difficultés.
Cette façon d’inclure le public dans son dire se retrouve dans l’intitulé de son article : « Vous êtes au courant, il y a un transfert psychotique9 ». La prise en compte du public apporte une sorte de déprise, ou un mode de savoir plus libre que celui d’un enseignement magistral. Sa parole a quelque chose qui lui échappe, qui reste non bouclé.
C’est aussi ce qu’il manifeste lorsqu’il dit que notre écoute d’analyste se rapporte à une parole subjective et non à une mise en catégorie y compris structurale, dont il montre les impasses dans « Perturbations dans pernepsy » en 1988. Cette position prolonge celle de l’article de 1986, cité plus haut, où il invite les analystes à un transfert au psychotique, c’est-à-dire à écouter le sujet psychotique en acceptant de se départir d’une croyance à un savoir constitué et d’une sorte de surplomb dont relève la position de sachant. Il affirme que le savoir est situé du côté du sujet psychotique.
La pluie d’été
Dans un chapitre suivant de Transmaître il va poursuivre son cheminement avec la question : « Qu’est-ce qu’un élève ? ». La rencontre avec le livre de Marguerite Duras, La pluie d’été10 lui permet de continuer son exploration de ce qui se transmet ou de comment se transmet le savoir. Dans ce roman, il est question de l’enfant Ernesto issu d’une famille nombreuse ; il a plusieurs brothers and sisters, dont il est l’aîné. Ernesto ne sait pas lire, ne sait pas son âge, il sait seulement son nom. Il va à l’école pour la première fois et ne veut pas y retourner. Position subversive qui interroge de manière comique presque absurde la valeur du savoir scolaire. Les parents décident d’aller parler à l’instituteur et au directeur.
L’élève Ernesto va refuser de retourner à l’école en arguant du fait : « qu’il ne veut pas apprendre des choses qu’il ne sait pas. » Cette phrase qui se répète peut être entendue comme un refus de s’y prêter. Dans ce cas, nous pouvons la saisir comme une modalité qui s’oppose à la phrase de Lacan reprise dans ce livre, devoir « y mettre du sien ».
Cette position d’Ernesto, celle d’un rejet, pousse à l’extrême une forme d’opposition à la logique scolaire. Elle peut faire penser à l’autisme comme incarnant le refus d’un savoir que l’autre veut nous transmettre. Elle m’a aussi évoqué l’effronterie de la phrase de Bartleby11 qui pose de manière ostentatoire et définitive, son « I would prefer not to » qui lui aussi, se refuse à la demande des autres.
Marguerite Duras situe cette histoire d’analphabétisme contemporain, dans un contexte social de chômeurs immigrés qui ne se préoccupent pas de scolariser leurs enfants et connaissent mal leurs propres origines. Et son écriture se prête au registre de l’infantile et de l’inculture. Mais Ernesto accède seul à la lecture du Livre brûlé12. La Bible et l’Ancien Testament sont ainsi présents dans ce récit à travers le Livre de Qohelet (L’Écclésiaste) qui raconte à sa manière la révélation de la vanité du monde.
Bien qu’il ne sache pas lire, Ernesto lit ce livre brûlé. Il lit l’histoire d’un roi ayant régné dans un pays étranger à une certaine époque. Ernesto finalement sait lire, et ce savoir-lire le place au même niveau que les prophètes bibliques. Ces derniers brusquement et malgré eux, sont appelés à proférer une parole qui leur est transmise par l’esprit.
Il y a une sorte d’ironie qui fait penser que cet enfant n’a pas besoin du savoir de l’école pour accéder à une autre modalité, celle d’un savoir mystique par lequel il saisit quelque chose qui transcende ce savoir. Quel est le statut de ce savoir infantile ? Nous pouvons faire l’hypothèse que ce « savoir insu » appelle justement le « pourquoi » du monde ce qui rejoint la question d’un au-delà du maître pouvant transmettre un savoir déjà révélé.
Jean Allouch poursuit en réfléchissant sur la place d’Ernesto. Il en fait la base d’une méditation sur la position d’élève et son effet sur son autre, le maître en l’occurrence. Le professeur et le directeur sont démis de leur fonction de maître scolaire. Il met en perspective comment, de manière dialectique, ils sont déplacés par rapport à la position d’Ernesto. Accédant, à la suite de cette « lecture » — et en accéléré —, à tous les savoirs qui le mènent jusqu’aux universités, Ernesto ne pourra que rencontrer ce trou du monde qui est l’impossible savoir de sa causalité. La modalité du savoir qui est donnée ici est originale car elle n’est pas issue d’un maître, mais d’une écriture qui a le statut d’une lettre.
La fable du Hérisson
Je reviens à Transmaître, où Jean Allouch, dans un chapitre suivant, propose une allégorie, sa fable de l’élève hérisson13. Dans son discours de Rome14, Lacan dit qu’il adore les hérissons et dès qu’il en voit, il les met dans sa poche dans son mouchoir. Il les ramène dans sa maison de campagne et aime les regarder froncer les peauciers du front et se mettre en boule. Le hérisson se rebiffe, pisse, se met en boule et pique15. Mais déjà chez Freud se trouve une allusion au dilemme du hérisson dont parle Schopenhauer pour décrire le besoin humain à la fois de se rapprocher des autres et en même temps de rester en dehors de la société16.
Avec cette fable du hérisson Jean Allouch suggère un modèle de lien du maître à l’élève qu’il conjugue avec les trois temps logiques17. Finalement le hérisson est posé dans la maison de campagne de Lacan où il est chéri ! Et là, surgit un autre bon mot de Jean Allouch : chérir le hérisson ce qui donne : Chérissons ! Voilà une façon pleine d’esprit de raconter comment le maître s’y est pris avec lui ! Ces bons mots18 issus de la pratique de Lacan que Jean Allouch a consignés et dont il disait que c’était ce qu’il y avait de plus lacanien, finalement, c’est lui, qui les a entendus et on peut dire qu’il s’agit surtout de son écoute à lui, en écho au mot d’esprit freudien. Cette sorte d’esprit c’est, me semble-t-il, quelque chose qui lui revient.
Ce qu’il avance avec ce bon mot c’est qu’il aurait pu être un élève hérisson, chérissons pour Lacan. Mais il ajoute que ce qui lui a permis d’y échapper… et donc de ne pas être un pur lacanien tient au fait d’avoir un point d’extériorité pour le lire. Il faut, dit-il, un point d’extériorité à un élève pour pouvoir se situer de manière libre par rapport à un maître. Un point d’extériorité qui permet de se repérer à partir d’un trait subjectif, cela peut être un signifiant marquant ou une invention propre. Il permet de lire et de se situer de manière libre face au maître, et non dans une sorte de recouvrement mimétique. Dans ce dernier cas, s’interfère une sorte d’empêchement à penser. S’adresser à la liberté d’autrui participe de cette quête d’un point d’extériorité.
Jean Allouch a décrit le modèle d’un savoir hérisson comme quelque chose qui se transmet de manière « hérissée » ce qui a été déjà le cas, pour Lacan par rapport à Freud. Il avait son point d’extériorité pour se situer et c’était son RSI. Ainsi, Lacan n’était pas un élève zélé vis-à-vis de Freud. Dans ses derniers séminaires il ne manque pas de se mettre en boule et de le piquer, je cite :
« Un bourgeois bourré de préjugés19 » qui n’avait que « peu d’idées de ce qu’était l’inconscient » ; Un personnage qui « n’avait rien de transcendant » qui était un « petit médecin qui faisait […] ce qu’il pouvait pour ce qu’on appelle guérir ce qui ne va pas loin20 ».
Tout piquant et critique qu’il soit vis-à-vis de Freud, cela ne l’empêche pas de se dire freudien. Le mot d’esprit, la parole qui s’adresse à la troisième personne sont évoqués comme recours à un « lui » qui justement constitue une sorte de barrage au surmoi des lacaniens.
Ce point tiers d’extériorité qui s’exerce par la liberté de ne pas reproduire de manière surmoïque le savoir du maître, est salutaire. Jean Allouch a su l’exercer et le nommer. Bien sûr, nous cherchons où se situe chez lui ce point d’extériorité. Il le mentionne en disant que c’est dans Lettre pour Lettre, dans ce qu’il soutient avec sa translittération.
Mais lorsque dans L’amour Lacan, il écrit « qu’aimer c’est laisser l’autre être seul » je l’entends aussi comme une forme d’accès et de tact par rapport à cette liberté de l’autre. Au-delà de cet exemple, cette liberté de penser, il l’exerçait malgré tout, la plupart du temps et on espère y arriver… En tout cas, il en inspire le souhait.
Et c’est dans cet esprit d’exercer sa liberté qu’il a pensé la cure comme une érotique à deux et non comme une direction où il s’agit de rectitude c’est-à-dire de garder une ligne droite. Il avait horreur de ce mot de rectitude ! Dans un de ses derniers textes, il s’est penché sur la question du Neutre, ce qu’il nomme la vitalité du neutre, rejoignant Roland Barthes dans son abord de cette notion. Sont mis en avant deux traits issus du cours sur le Neutre21, mais qui constituent de « discrets conseils au psychanalyste ». Il s’agit de la délicatesse et du kairos. Pour moi, ce sont deux traits qui ouvrent des modalités tout à fait particulières de travail avec le transfert. Déjà on peut dire que le tact est indispensable avec le hérisson, sous peine de s’y piquer !
À la fin de ce texte, Jean Allouch écrit : « Fragile, l’interprétation est aussi délicate » et il ajoute : « Il n’y a de vitalité qu’à la condition de ne pas vouloir à tout prix en être le maître22 ». C’est ce trait de vitalité et de déprise qu’il nous transmet de manière inoubliable à travers son œuvre.
.