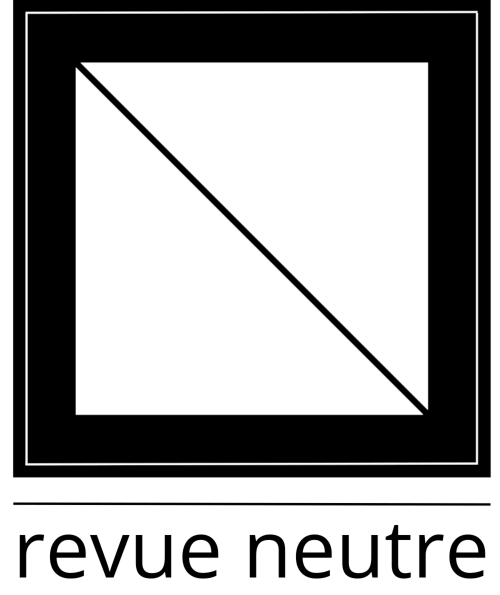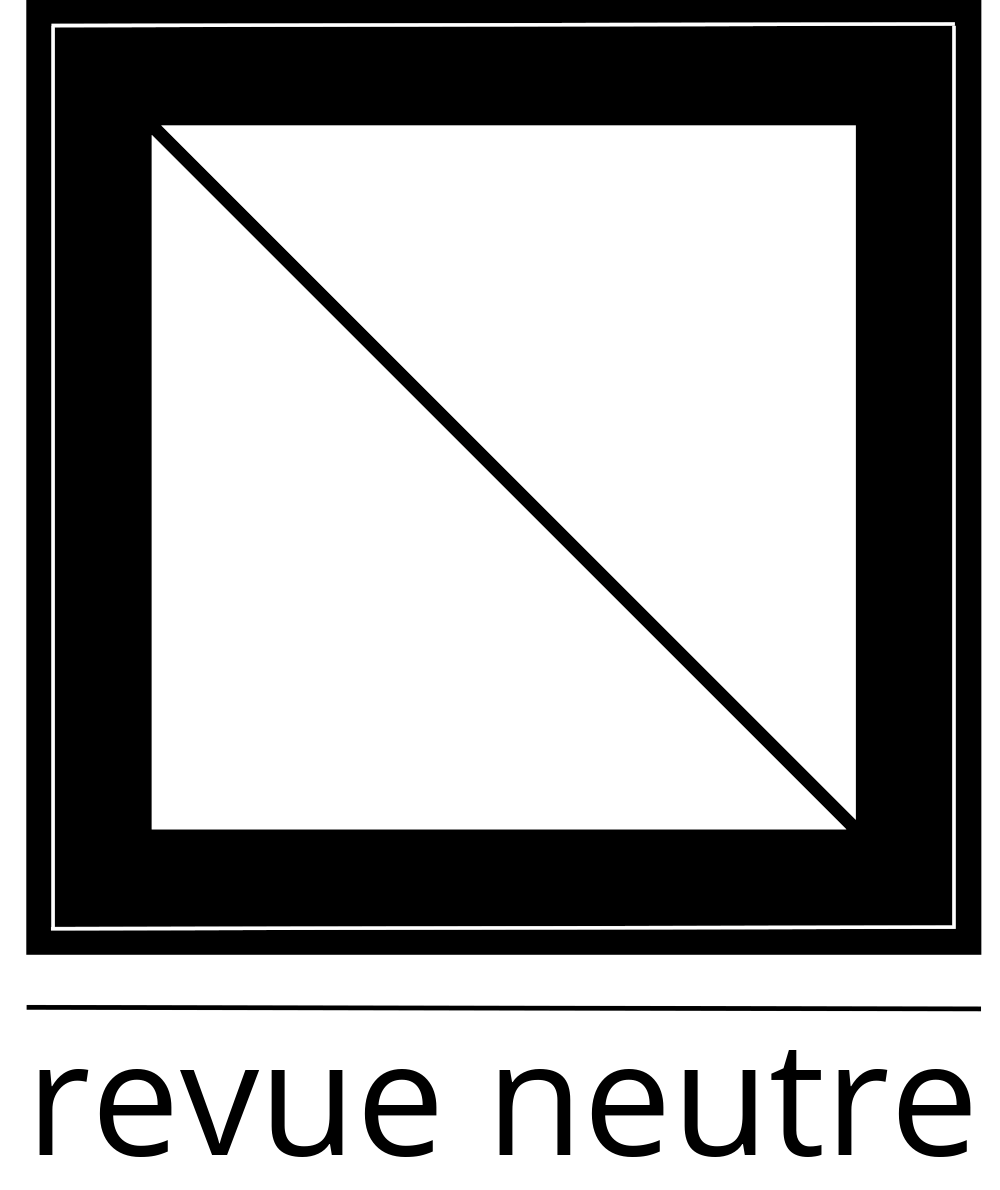TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE

Le geste artistique improvisé
Jean-Sébastien Mariage
Ce n’est pas quelque chose que nous créons véritablement,
d’une certaine façon, cela nous crée nous-même.
Jerry Garcia, guitariste (1942/1995)1
On a l’impression que ce qu’on devrait être, on l’est vraiment.
Ronnie Scott, saxophoniste (1927/1996)2
Lors de mes interventions portant sur l’improvisation pour deux événements organisés par l’École Lacanienne de Psychanalyse les 10 novembre 2022 (Geste3) et 16 avril 2023 (Geste de…4), Danielle Arnoux a entendu du neutre. Elle m’a ensuite demandé d’en parler durant le colloque de l’ELP intitulé « Ce neutre qui “ne peut se dire franchement”5 » qui s’est tenu les 24 et 25 juin 2023 à Paris. Je n’ai pas parlé du neutre de façon explicite, j’ai parlé de l’improvisation en espérant qu’au travers de ce que j’allais dire, du neutre apparaîtrait. Pour élaborer ce travail je me suis inspiré du Cours sur le Neutre6 de Roland Barthes et de sa méthode :
Ordre paradoxal des discours sans résultats : ou mieux, qui ne censure pas l’effet mais qui ne s’occupe pas du résultat. Ceci discrédité par la loi du discours occidental. Bacon : « Aristote, avec assez d’esprit, sans doute, mais non sans quelques dangers, tournant en ridicule les sophistes de son temps, dit qu’ils ressemblaient à un cordonnier qui, se donnant pour tel, n’enseignerait pas la manière de faire un soulier, et qui se contenterait d’étaler des chaussures de toute forme et de toute grandeur. » Je ne fabrique pas le concept de Neutre, j’étale des Neutres7.
Vous trouverez ici la rédaction de mon intervention qui était largement… improvisée.
En guise d’introduction, voici une première vidéo courte montrant le vocaliste improvisateur Phil Minton et son petit-fils :
Codes communs
L’improvisation se trouve aux fondements de toute pratique artistique. Elle accompagne également chaque geste, chaque parole que nous produisons dans notre quotidien. Les musiques improvisées dont il sera question ici sont très difficiles à définir, et c’est tant mieux car cela évite leur enfermement dans une identification toujours trop précise et inappropriée.
La musique, la danse, la peinture, la sculpture et tant d’autres pratiques se trouvent dans un lieu sans mot, où ce qui est donné n’a pas de mot, n’est pas verbalisé. Je fais de la musique car j’ai besoin de vivre une part de moi qui est sans mot.
L’expérience que l’on peut par exemple vivre en assistant pour la première fois à un opéra semble à tout un chacun très étrange. De prime abord, il est très difficile d’entendre ce type de musique complexe et chargée de codes historiques. Une chose insaisissable se présente à soi, nous n’avons pas les repères qui nous permettraient de voir autre chose qu’une agitation souvent excessive. Il faudra s’y intéresser sérieusement pour savoir apprécier ce type de spectacle, y revenir, comparer… Il en est de même pour un amateur d’opéra qui se trouverait pour la première fois à un concert de rock. À la condition d’une curiosité sincère qui lui permettra d’aller à l’encontre de ses habitudes, les repères stylistiques pourront se dévoiler et s’organiser, permettant à l’auditeur de se situer, de différencier ses expériences, d’éduquer son écoute afin de trouver sa place au sein de ce nouveau lieu.
Rock, jazz, opéra, chanson, rap… comportent les codes communs que sont le rythme, la mélodie, l’harmonie, en un terme : la théorie de la musique. Je vais aborder ici une pratique artistique qui tente de se débarrasser de ces codes communs. Notons que la rareté et l’absence de repères inhérentes à l’improvisation radicale rendent nécessaire une initiation supplémentaire car il sera question ici d’apprécier une pratique artistique à chaque fois nouvelle et toujours unique. C’est une initiation à l’inconnu, à une découverte permanente où la reconnaissance n’a pas lieu.
Deux types d’improvisation
Je distingue deux types d’improvisation. La première est l’improvisation que j’appelle classique. Elle se déroule, elle se fait dans un cadre. L’exemple le plus courant est le jazz qui utilise une mélodie, un thème, avec une harmonie, des suites d’accords appelés « grille » et un motif rythmique qui se répète. Après avoir exposé le thème, les solistes improvisent sur son schéma en suivant la grille. L’improvisateur invente librement une mélodie à l’intérieur d’un cadre. Je cite le saxophoniste Ornette Coleman : « On a droit à un certain espace et on met ce qu’on veut dedans8. » On a droit à un espace, c’est-à-dire qu’un espace nous est donné. Cet espace est proposé, mais aussi imposé par un compositeur qui assemble des éléments musicaux qui servent ensuite de support à l’improvisation.
Le deuxième type d’improvisation appelé « libre » ou « radicale » est celui qui sera développé ici. Cette improvisation libre n’évolue plus dans un cadre, il n’y a plus de cadre. Pour abolir le cadre, il est nécessaire de se placer en dehors des codes musicaux, de s’affranchir de toute théorie. Bien sûr, il y a toujours un dispositif qui est la salle ou le lieu du concert, les musiciens, les instruments de musique et le public.
En voici un exemple avec une vidéo d’un solo du saxophoniste Steve Lacy (Paris, 1982) :
Souvent, l’écoute de la musique suscite l’attente de la reconnaissance d’éléments esthétiques connus, faisant office de références. Ce n’est pas le cas ici. Bien qu’il y ait une mélodie, aucun motif ne sera répété, la musique coule comme l’eau d’une rivière qui ne revient jamais là où elle est déjà passée. Tous les éléments proposés sont joués pour la première fois et ne seront pas rejoués. Nous reconnaissons un saxophoniste qui fait un solo de saxophone, rien de plus ni de moins. Il y a des mélodies, il y a des rythmes sans tempo au sens strict, mais aucune composition préalable qui pourrait être rejouée. C’est un exemple d’une façon d’improviser qui est à peine sortie du cadre. Allusion au film documentaire Step accross the border9 sur la pratique musicale du musicien Fred Frith, je dirais que cette improvisation se trouve un pas en dehors du cadre. Déjà ici, l’auditeur ne peut pas se remémorer les éléments musicaux. Si on ne connaît pas ce musicien, c’est la première fois qu’on entend cette musique. Nous allons continuer à nous éloigner du cadre.
Déconstruction
Voici une image d’un tableau de Georges Braque dont le titre est Man with a guitar (version de 1912) :

Sans avoir connaissance du titre, il est difficile de reconnaître un homme ou une guitare. C’est pourtant ce qui est représenté. Le modèle est déconstruit, la hiérarchie de ses différents éléments n’est pas respectée. Nous voyons des échantillons de textures à peine déchiffrables. Le MOMA où il est exposé dit sur son site : « La figure a été éclatée en facettes individuelles, jusqu’à sa dispersion dans l’espace10. » C’est d’une déconstruction qui permet de saisir la réalité d’un autre point de vue, d’être plus près du réel.
Dans les années 1960, ce tableau de Georges Braque a influencé Keith Rowe, alors musicien de jazz. Il s’en est inspiré pour déconstruire sa musique, en ôter les archétypes convenus provenant d’ailleurs, supprimer les réflexes esthétiques qui empêchent l’improvisation d’être entièrement vécue dans le moment présent. Je reparlerai plus loin de ce musicien.
Derek Bailey également guitariste de la même génération que Keith Rowe, a lui aussi déconstruit son jeu de guitare. Je cite un livre qu’il a écrit et dont je me suis inspiré : L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique11.
Sur cet exemple en vidéo, la musique et la guitare sont déconstruites :
Je vous ai présenté deux exemples de musiciens qui jouent seuls. Comment jouer avec un musicien qui fait une telle proposition ? C’est très étrange. On ne peut pas l’imiter, on ne peut pas le suivre, on ne peut faire qu’une proposition autonome, sans chercher à « accrocher » l’autre, sans pouvoir « coïncider » comme pourrait dire le philosophe François Jullien. En conséquence, Derek Bailey dit qu’il n’existe aucun aspect exclusivement théorique de l’improvisation.
La théorie de l’improvisation, c’est un peu ce que je fais maintenant, mais malheureusement, cela ne vous suffira pas pour, à la suite de cette lecture, vous permettre d’improviser. Il est nécessaire d’être accompagné par des personnes qui improvisent déjà. C’est une initiation empirique.
Les improvisateurs parlent souvent de la musique comme émanant d’eux. N’ayant pas de contraintes extérieures, préalables, l’improvisateur joue ce qui lui vient, il ne peut faire que ça. Il a donc la sensation que cela émane de lui. Vrai ou faux, la sensation n’en est pas moins réelle. Les improvisateurs sont l’incarnation même de la musique. Lorsqu’on est auditeur d’un concert d’improvisation, rien ne vient d’ailleurs, tout ce à quoi l’on assiste ne saurait émaner que du lieu dans lequel on se trouve. Aucun compositeur n’a écrit la musique, elle provient entièrement et exclusivement de l’instant présent.
Le terme de composition en temps réel est souvent utilisé. Ne serait-ce pas là une manière de s’excuser de l’absence du compositeur, du maitre ? Le musicien Jean-Luc Guionnet, saxophoniste, que nous avons pu entendre lors de la journée « Geste de… » préfère le terme « temps de faire », sans plus de précision. C’est un temps durant lequel on fait. Que fait-on ? On ne le sait pas. On peut éventuellement se questionner ensuite, mais quoi qu’il en soit, au moment où ça se passe, on fait sans pouvoir avoir aucun recul. Il n’y a aucune idée de composition.
Hiérarchie
Pour se faire, l’improvisation abolit ce que les musiciens appellent la pyramide des instruments. C’est un principe de hiérarchie universelle que l’on retrouve dans toutes les autres musiques sans exception. Les instruments les plus aigus sont solistes, ils sont en avant de la scène. Derrière, les accompagnateurs sont dans un registre médium, la guitare, le piano, l’accordéon…etc mettent en valeur les solistes. En fond de scène se trouve la section rythmique : la batterie et la basse. Notons au passage que, particulièrement aux États-Unis au cours du xxe siècle, les salaires des musiciens variaient en fonction de leur place dans cette hiérarchie. La pratique des musiques improvisées a aboli cette hiérarchie.
Voici un exemple d’une pyramide des instruments :

https://www.shadesofblue.fr/animation-anniversaire.html
Nous voyons bien ici les solistes devant (la chanteuse et le saxophoniste), l’accompagnateur au deuxième plan avec la guitare, et tout au fond, la batterie et la contrebasse. Dans cette situation, le batteur et le contrebassiste, et dans une moindre mesure le guitariste, entendent peu le saxophoniste et la chanteuse qui projettent leur son vers l’avant. Ils les entendent de loin, indirectement. Ils sont tous les trois au service des solistes, sans pourtant les percevoir correctement. En exagérant quelque peu je dirais qu’ils font leurs affaires dans leur coin.
Une anecdote : À l’époque des Big Band (orchestres de jazz) aux États-Unis durant la première moitié du xxe siècle, un batteur nouvellement embauché se voit demander par un ami si l’orchestre sonne bien. Il répondit : « Je ne sais pas. »
Les musiques improvisées ont fait s’effondrer cette pyramide pour remettre tout à plat.
Voici une image du groupe Hubbub12, un projet auquel je participe, et qui existe depuis 1999 :

Hubbub à la Maison de la Radio en 2008
Nous le voyons ici de dos. Il y a un piano, un saxophone alto, une guitare, un saxophone ténor et une batterie. Nous sommes placés en ligne, le batteur n’est pas tout au fond, enfin ! Il est sur le même plan que les autres instrumentistes. L’amplificateur de guitare que l’on voit au premier plan de l’image est en fond de scène car le haut-parleur a une diffusion spécifique qui procure plus de présence. Pour que sa perception au niveau du public soit équitable, pour que chaque instrument soit sur le même plan, on recule l’amplificateur. C’est l’amplificateur qui se trouve au fond.
Nous voici de face. La disposition en ligne est plus flagrante. Nous pouvons reconnaître Jean-Luc Guionnet au saxophone alto :

L’Idiome
Les musiques improvisées sont dites non-idiomatiques. Un idiome dans ce contexte est un objet sonore particulier, référencé à une esthétique et donc à une période historique et à une géographie. Un musicien qui jouerait exclusivement la musique de Mozart (ce que je ne critique aucunement), placé dans un orchestre de jazz, ne saurait rien y faire. La réciproque est tout aussi vraie.
L’absence d’idiome abolit les barrières esthétiques. Nous pouvons voir ici se dessiner une éthique consistant à proposer et non imposer aux autres musiciens sa propre origine culturelle, évitant ainsi une accumulation de paradigmes qui ne sauraient dialoguer entre eux.
Une musique dénuée d’idiome permet d’associer des musiciens qui viennent de tout horizon, de toute formation, y compris celles autodidactes. Au sein des projets dans lesquels je joue se trouvent des musiciens qui ont aussi bien une formation de musique classique, que de jazz, de musique électro-acoustique, ou de rock…etc. À la condition d’une déconstruction préalable de son mode de jeu instrumental originaire, à la condition qu’il ne s’appuie plus sur des idiomes, tout musicien, quelle que soit sa formation, ses origines artistiques, peut jouer de la musique avec n’importe quel autre qui aurait suivi cette même initiation, chacun à sa manière. Lorsque ce n’est pas le cas, ce type de rencontre ne fonctionne pas. J’en donnerai un exemple plus loin.
Durant les années soixante à Londres, un groupe de musiciens de jazz a éprouvé le besoin de déconstruire sa pratique musicale. L’un d’entre eux, Keith Rowe, toujours en exercice, nous explique d’où ce besoin est venu en quelques mots : « Nous n’allions pas nous approprier leur musique (celle des musiciens afro-américains). C’est leur musique13. » Cela paraît tellement évident dit comme ça.
Un musicien français et blanc par exemple, qui se met à jouer du blues, est-il légitime ? Chacun fait ce qu’il veut, mais ça ne sonne pas pareil, ça ne sonne pas vrai, ça sonne faux. Un des seuls musiciens blancs, à ma connaissance, qui réussisse à jouer le blues comme un afro-américain issu de la ségrégation qui a sévi et qui sévit encore aux États-Unis est Keith Richards, guitariste de The Rolling Stones. Alors que par sa participation à ce groupe il était déjà nommément très célèbre, il a réussi à être embauché dans l’orchestre de Chuck Berry en tant que guitariste rythmique, c’est-à-dire dans une position en retrait et non soliste. Il était en quelque sorte un disciple14. Il a reçu une initiation au cœur de cette culture particulière.
Toute musique, pour être opérante, se joue avec le corps tout entier, avec la culture personnelle du musicien, avec ses tripes à lui. Lorsque ce n’est pas le cas, le musicien emprunte le corps d’un autre, ce que l’on peut appeler « être à côté de soi », et donc de la musique.
Je cite Derek Bailey :
Il existe une anecdote apparemment improbable, mais sans doute vraie à propos de Lester Young, qui était un saxophoniste de jazz (1909/1959). Un de ses admirateurs, un joueur de ténor (saxophone), dont le style était uniquement basé sur celui de Lester Young, fit un pèlerinage pour écouter son idole. Lester Young, musicien superbe et imprévisible, chose rare dans le jazz, ne joua pas comme d’habitude. Furieux, le disciple s’écria, « Vous n’êtes pas vous, c’est moi qui suis vous »15.
Se déplacer dans le corps d’un autre serait une opération de dépersonnalisation, une sorte de disparition. Le spectateur ne voit plus qu’un corps fantomatique.
L’idiome est un paradigme. Même entre musiciens improvisateurs, si on s’imite, si on emprunte un paradigme extérieur à soi, ça ne fonctionne pas.
La citation musicale fonctionne autrement, c’est une référence non-envahissante. Elle peut être surprenante, déstabilisante, elle passe très vite, elle n’accroche pas, elle ne s’impose pas aux autres musiciens, elle s’évapore rapidement, non sans avoir modifié la donne.
Que se passe-t-il lorsqu’un musicien n’utilise pas d’idiome, quand il n’a rien prévu, quand il improvise de façon radicale ? Que va-t-il jouer et que traverse-t-il ?
Il y a devant lui un grand vide, la sensation de tomber en permanence, comme en déséquilibre au bord d’un précipice. Il est tenu d’accepter cette peur, cet inconfort. Elizabeth Saint-Jalmes, performeuse qui nous a elle aussi offert une intervention lors de la journée « Geste de… » nous disait : « Si on fait ça pour se rassurer, il ne se passera rien, on est foutu. »
Il est question d’accueillir cette peur, ce danger car ils sont tous deux la condition de la création. On est tenu par ce vide, il nous attrape et il ne nous lâche plus jusqu’à la fin de la prestation. La durée d’un concert improvisé est variable. Elle n’est pas totalement ouverte car les artistes sont tout de même tenus de respecter un contrat, ne serait-ce que moral vis-vis du public et des organisateurs. Les durées sont comprises en général entre 40 et 60 minutes. C’est une question d’honneur, c’est une question de honte qu’on ne veut pas vivre. On est obligé de continuer, on n’a pas la possibilité d’arrêter, ce serait impossible, même si plus rien ne semble vouloir venir. On ne sait pas ce qu’on va jouer dans l’instant suivant, dans les quelques secondes qui suivent, on se sent comme aspiré par l’inconnu. De ce fait il est impossible d’apprécier la valeur de ce que l’on est en train de faire. Cela imposerait de prendre une distance et donc de ne plus être dans l’improvisation. On est obligé d’accepter, non seulement ce qu’on joue soi, mais aussi ce que les autres jouent sans aucun jugement. Ce qui importe c’est l’accueil. Cet accueil est un soulagement car il nous fait avancer face au vide, sans tomber.
Lorsqu’à la suite d’un concert qu’il vient de donner on demande au musicien Jean-Luc Cappozzo, trompettiste qui vit en Touraine, ce qu’il pense de l’improvisation qui vient d’être jouée, il donne sempiternellement la même réponse « On a improvisé ! ». Le processus s’est déroulé, l’improvisation a eu lieu. Il n’est question que de ça : improviser.

Barre Phillips
Voici quelques propos sur le contrebassiste Barre Phillips, connu pour avoir un jeu très léger sur un instrument qui demande pourtant beaucoup de force. Je vais m’aider d’une vidéo d’un duo avec le danseur Julyen Hamilton. Sans aucune connaissance de l’improvisation, on pourrait ne voir qu’un guignol qui fait l’imbécile avec une contrebasse. On ne voit pas en quoi il joue de la musique, en quoi il a une technique instrumentale, on ne pourrait pas discerner d’intention. Alors je vous donne quelques références. Barre Phillips est né à San Francisco en 1934, a émigré en Europe en 1967, il vit depuis plusieurs décennies dans le sud-est de la France. Il est compositeur d’une douzaine de musiques films, notamment de Robert Kramer, Jacques Rivette, William Friedkin, Marcel Camus, Richard Coppant. Il a écrit des ballets pour la danse. Au début de sa carrière au milieu du xxe siècle, il a notamment joué avec Jimmy Giuffre, Archie Chepp, Lee Konitz, Ornette Coleman. Quand il fait ce qu’il fait, il le fait vraiment, entièrement, c’est vraiment ça qu’il veut faire et qu’il fait.
Avant d’en venir à cette vidéo je passe par une parenthèse en vous proposant un extrait d’une chronique d’un concert de Barre Phillips. Cette chronique intitulée « The divine sound of emptiness… » est issue du recueil « Entre le Majeur et l’annulaire » de Claude Parle, lui-même musicien improvisateur, accordéoniste. Cette chronique a été écrite durant un solo de Barre Phillips :
Barre ne joue pas de contrebasse.
Il n’existe plus aucun instrument dans ses mains vides offertes aux vents…
Seul émane un souffle des troncs enfouis, des forêts hantées et disparues, dévastées, brûlées & pétrifiées…
C’est comme ce maître de Kyudo (art japonais du tir à l’arc) qui, quelques années après sa réalisation vit un jour sur une table un objet dont il ne pouvait se rappeler le nom : c’était un arc !!
L’archet tendu, il est comme Zingaro avec ses chevaux, il montre, l’instrument joue !
L’ombre du fouet suffit au cheval magnifique, le vent de l’archet cabre la basse.
Ensuite, c’est comme percevoir dans les nues un chant, les soirs d’orage.
On n’entend plus que les harmoniques et nos corps engendrent les notes qu’ils sécrètent tout en s’en nourrissant.
Cela devient, par la grâce des résonances, un orchestre de contrebasses, lui, elle & nous enliés aux mêmes chants, aux mêmes rythmes, aux mêmes scansions.
[…]
C’est une musique de l’envie & une musique de l’oubli…
Impensable hapax…
[…]
C’est un immense et intense appel à la vie, à toute vie qui possiblement, en nous sommeille et que l’art chei16 !!…17
Comme vous le constatez, cette chronique ne parle pas de musique. C’est une sorte de poème onirique. Il me semble que c’est la manière la plus appropriée de parler de ce qui se passe quand on assiste à un concert d’improvisation. On ne parle pas de la musique, on ne parle pas de la technique, on ne donne pas de référence mais on parle de sensations, d’émotions, de ce que ça nous dit, de ce que l’on reçoit. On peut souligner que de nos jours, il n’y a quasiment plus de chroniqueurs professionnels pour les musiques improvisées. Ça n’existe plus. Ils sont tous retournés dans des secteurs où ils ont des repères, où ils peuvent comparer, reconnaître, etc…
Un mot du danseur Julyen Hamilton :
Au milieu des années 70, à Londres, nous travaillions beaucoup, avec Rosemary Butcher, sur comment contre-balancer, comment deux corps peuvent s’écouter l’un l’autre via le poids et créer un matériau qui ne soit pas basé spécifiquement sur l’esthétique visuelle18.
Il travaille sur le poids, donc encore sur un déplacement, la danse n’est plus visuelle. Ce qui importe, ce n’est pas ce qu’il donne à voir, mais ce jeu de poids, de corps.
Voici cette vidéo :
Je faisais référence précédemment à la pyramide des instruments. Dans la danse en général, comme au théâtre, le musicien est toujours accompagnateur. Il est toujours au fond ou sur un côté du plateau, il est parfois caché. Il est là pour mettre en valeur la danse. L’improvisation quant à elle propose un échange équitable, sans hiérarchie. On peut se dire que Barre Phillips, à certains moments, danse aussi. Je l’ai écouté plusieurs fois en concert mais jamais avec de la danse. Je l’ai toujours vu immobile, statique. Ici il est avec un danseur, il se met à danser, il se laisse contaminer par l’autre, par le corps de l’autre sans pour autant l’imiter. Ni soliste ni accompagnateur, pas non plus de correspondance ou d’équivalence de vitesse ou d’énergie, il n’y a pas d’obligation de faire comme l’autre, d’accélérer quand l’autre accélère, de ralentir… L’autonomie est totale, aucun des deux n’est au service de l’autre.
La fin est un moment particulier parce que l’on y perçoit une connexion spéciale. Je sais par expérience que c’est notre cerveau qui la fabrique. La fin va boucler l’événement, le figer et donc lui donner sa teneur. Notre cerveau a besoin de comprendre et de rationaliser ce qu’il perçoit. La fin procure ici cette sensation de connexion, au contraire de la plupart des autres pratiques artistiques qui s’efforcent d’être compréhensibles dès le début.
Les outils
Avec cette façon d’improviser, les différents outils qui sont à notre disposition sont souvent utilisés pour faire des ruptures, des coupures. Jean-Luc Guionnet dit qu’une coupure vient au moment où on a envie que ça continue, sinon, ce n’est pas une coupure. La coupure arrête quelque chose qui est fait pour continuer. On peut changer de stratégie d’un coup, changer de vitesse brutalement… cela va déstabiliser l’autre ou les autres. Cela donne de la liberté aux autres en les empêchant d’être suiveurs car l’intention actuelle peut disparaître à tout moment. Les intentions sont données de toutes part en même temps, indépendamment les unes des autres, en tentant de réduire l’hésitation à son minimum. On peut voir vers la fin de la vidéo précédente le danseur hésiter un peu : Est-ce que je prends cette fin ou pas ? Il évacue immédiatement cette hésitation.
Lors de la journée « Geste de… » nous avons écouté/regardé le duo nommé « Ce qui dure dans ce qui dure » avec la danseuse Lotus Eddé Khouri et le saxophoniste Jean-Luc Guionnet.
Voici une vidéo de ce projet capté en 2019 en Californie :
Ils nous ont dit qu’ils se fixent une durée précise, paramètre inhabituel en improvisation. Ce jour-là c’était 30 minutes. Plutôt que de leur imposer une contrainte, ça leur apporte une liberté car s’ils regardent la montre et qu’ils voient que cela fait 15 minutes qu’ils ont commencé, et qu’il leur reste donc encore 15 minutes à jouer, ça étire le temps, et donc ça leur permet, ça les incite à être encore plus libres. Ils ne sont pas à la fin, ils sont encore loin de la fin. Un vide s’ouvre devant eux qui laisse la place à l’improvisation.
Le temps, la coupure, sont des outils formels. Des objets sont également souvent utilisés comme des baguettes, archets, tube de métal, brosses, objets du quotidien… Ce sont des outils de timbre. Ils permettent ce que nous appelons des techniques étendues. Le plus souvent, seul un petit nombre d’objets est utilisé. Lorsqu’un musicien utilise beaucoup d’outils c’est à mon goût moins réussi. Pourquoi ? Quand il y a beaucoup d’outils, n’ayant pas prévu ce que l’on va faire, on se pose la question de l’outil que l’on va utiliser. Il n’y a pas de réponse meilleure ou moins bonne qu’une autre, cette question parasite le geste. Ce qui importe, c’est de prendre un outil ou non. Avec peu d’outils on est obligé de se renouveler, d’inventer. On n’hésite pas, on verra ce que l’on peut faire avec.

Pascal Battus lors de son intervention pour la soirée « Geste »
Cela nous mène à l’idée de l’accident. Lorsque l’on est dans ce fonctionnement-là, on est en dehors de la maîtrise, il n’y a pas de maîtrise. Ces objets supplémentaires n’étant pas conçus pour faire de la musique, nous ne pouvons pas avoir l’assurance qu’ils donneront le son que nous avons pensé dans l’instant. Des accidents sonores se produisent fréquemment, exactement comme dans la vie quotidienne lorsque nous réalisons une action dont nous n’avons pas l’habitude. Par exemple, lorsque je joue de la guitare électrique, je règle l’amplificateur assez fort pour pouvoir non seulement faire entendre des sons qui ne s’entendent pas habituellement sur l’instrument, mais aussi pour mettre une tension dans le son. Et si je fais un faux mouvement, si par exemple, alors que je ne le veux pas, je fais claquer une corde, cela va sonner très fort. Ce n’est pas du tout ce que je voulais à ce moment-là mais cela va me mener ailleurs, déplacer ou annuler une intention à laquelle j’aurais pu m’accrocher. L’accident est toujours fécond, à condition d’accepter de le prendre comme tel. Il va obliger ou permettre de s’exclure de toute stratégie. L’accident, le geste ni décidé ni intentionnel, va nous obliger à modifier notre mode de jeu, notre placement dans le son. Cela va alimenter l’improvisation.
Le musicien Keith Rowe, dont j’ai déjà parlé, nous dit : « La vérité des choses se lit mieux dans les rebuts19. » Le rebut, c’est ce qui n’est pas correctement fait, ce qui est raté. C’est ce qui permet de distinguer, de s’approprier l’objet. Lorsque nous voyons l’objet comme étant parfait, nous le voyons dans une globalité, on ne voit pas ses détails, on ne voit pas ce qui pourrait nous éveiller à sa singularité. À l’opposé, le péril provoque une instabilité qui s’avère être fertile, comme une faille au travers de laquelle on pourrait se glisser. Seule la fin apportera une stabilisation.
L’improvisation au défi de la maitrise
L’improvisation musicale a disparu avec l’arrivée de l’époque dite classique (dont on date le début en 1750, année de la mort de Jean-Sébastien Bach), alors qu’elle était très présente auparavant, à l’époque baroque. Les cadences finales y étaient par exemple laissées à l’appréciation des musiciens. Certaines partitions étaient des sortes de pense-bêtes pour se rappeler de la mélodie globale. Les musiciens devaient eux-mêmes proposer leurs solutions pour mettre la mélodie en valeur. L’improvisation dans la musique classique a disparu avec l’arrivée des chefs d’orchestre. C’est le chef d’orchestre qui décide de ce que la musique doit être, de ce que les musiciens doivent jouer. Finie l’improvisation, place au maître, qui dicte, en le déterminant seul et par avance, ce qui doit être joué, supprimant toute liberté aux instrumentistes qui sont de ce fait relégués au statut d’exécutants. Plus de deux siècles sans improvisation jusqu’à l’arrivée du jazz à la toute fin du xixe siècle. Les musiciens afro-américains de cette époque ne sachant pas lire la musique, ils la transmettaient par oralité, ce qui les a forcés à réinventer la musique.
L’improvisation a par contre continué durant tout ce temps à l’orgue d’église pour accompagner les offices religieux. Leur déroulement n’étant pas minuté, impossible d’en connaitre à l’avance la durée. On ne peut pas savoir exactement combien de temps va prendre le sacristain pour allumer les cierges. L’improvisation est ici nécessaire. Dans son livre The Art of Improvisation20, édité en 1934, Carl Whitmer nous propose quelques conseils pour improviser. Cet organiste n’était pas du tout un musicien de jazz, il jouait pour les églises, il accompagnait notamment la messe :
• Ne cherchez pas à obtenir une entité finie et complète. L’idée doit toujours rester en état de flux.
• Une erreur peut toujours, involontairement, se révéler positive.
• Ne soyez pas trop exigeant sur la façon dont chaque partie de l’ensemble sonne. Persévérez. Tous les essais sont, au début, maladroits et « bizarres ».
• Le raffinement n’est pas du tout ce qui est important. Préférer plutôt l’énergie et l’élan.
• Ne craignez pas de vous tromper, craignez seulement d’être inintéressant.
Le qu’importe quoi
Une autre vidéo d’un duo avec Nina Garcia à la guitare électrique et Camille Émaille aux percussions. Je n’ai pas trouvé d’information de date mais elle nous montre un extrait d’un concert qui a eu lieu dernières années en Belgique aux Ateliers Clauss21 :
Nous pouvons voir ici bon nombre d’accidents, de silences qui transforment et déplacent, qui relancent la musique. Dans les commentaires de cette vidéo quelqu’un a écrit en utilisant un pseudonyme : « La démarche est intéressante, mais une technique instrumentale plus poussée permettrait de mieux exprimer les intentions musicales ». Je précise que Camille Émaille a un premier prix de conservatoire et que Nina Garcia par contre, utilise une technique empirique. Ce qu’elle fait elle est la seule à savoir le faire. Je parlerai de technique invisible. La technique quelle qu’elle soit n’est pas l’enjeu, elle est un outil.
La notion d’improvisation est souvent utilisée pour exprimer une critique négative, péjorative. « C’est de l’improvisation, il improvise, c’est n’importe quoi. » Je défends l’improvisation jusqu’au n’importe quoi, que je préciserai en disant le qu’importe quoi. Quel que soit le son ou l’idée proposé, sa valeur se trouvera dans son affirmation plutôt que dans sa nature. On le voit bien dans cette vidéo, elles ne savent pas ce qu’elles jouent, mais à la condition qu’elles soient présentes, peu importe ce qu’elles font, ça avance et des événements inattendus se produisent.
Patrice Cazelles, poète, qui était aussi avec nous pour la journée « Geste de… » et qui a improvisé sa poésie, nous dit : « On n’est pas sujet de ce qu’on raconte, on est objet ». Lorsque l’on improvise, on se voit comme objet. L’improvisateur est comme coupé en deux entre un objet qui agit et son observateur, qui ne saurait être son propre censeur. Il m’arrive durant des concerts de regarder mes mains faire des gestes sur l’instrument, comme si elles étaient extérieures à moi. Cela crée un ensemble observateur/objet.
Au cours de l’improvisation, la forme n’importe pas, ni pour le musicien ni pour l’auditeur. On accepte quoi qu’il en soit. Tout ce qui arrive est accueilli à part égale. Il n’y a pas une chose que l’on va privilégier à une autre. Comment pourrait-on préférer un son à un autre alors qu’il est encore impossible d’en connaître sa portée, ou ce qu’il va apporter à l’ensemble ? On n’est pas obligé de tout prendre, de tout garder, mais on accueille tout ce qui vient.
Voici maintenant une vidéo captée aux Instants Chavirés, salle emblématique des musiques improvisées en région parisienne, d’un trio constitué par Sophie Agnel au piano, Joke Lanz aux platines, et Michael Vatcher à la batterie. C’est la fin qui m’intéresse particulièrement ici. Cette fin, elle arrive d’elle-même. Elle peut arriver n’importe quand. Le batteur était dans un mouvement, il est surpris que la musique s’arrête et il l’accepte sans hésiter. Il ne choisit pas, il accueille ce qui arrive :
Observateur/objet
Lorsque l’on regarde la photographie d’un mobile d’Alexander Calder, on ne voit pas l’œuvre puisque c’est un mobile immobile :

Voici une vidéo des mobiles d’Alexander Calder :
https://www.facebook.com/watch/?v=356424608278665
La structure de la sculpture est fixe, mais la sculpture étant en mouvement, sa forme n’est jamais la même. Sur une photographie, on voit une forme possible de la structure à un moment donné. Quand on la voit en mouvement, ce pour quoi elle est conçue, elle se modifie en permanence, laissant voir des formes que même son concepteur n’avait pas imaginées. Ce n’est pas l’objet, mais ce que l’objet procure, qui importe. Ça se fait. Ici aussi, d’une autre manière, nous retrouvons le couple observateur/objet.
Cornelius Cardew, compositeur du milieu du xxe siècle, a fait des partitions graphiques qui ont beaucoup intéressé les premiers improvisateurs anglais comme entre autres Keith Rowe que j’ai déjà évoqué, John Tilbury, pianiste et Eddie Prevost, percussionniste. Ils formaient avec d’autres le groupe AMM22 qui signifie « Another Musical Mystery ». Ils commencent à jouer les partitions de Cardew en 1966.
Un exemple de partition graphique, extrait de Treatrise de Cornelius Cardew :
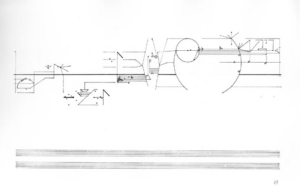
Ces musiciens cherchaient des moyens pour aller plus loin, pour s’éloigner encore plus du cadre. Ces partitions graphiques n’indiquent pas de temporalité précise. Cette pièce peut durer 10 minutes ou 3 heures, peu importe. Il n’y a pas d’instrumentarium défini non plus, la partition n’a pas été pensée en termes d’instrumentation. Il n’y a pas non plus de consigne indiquant quel musicien doit jouer quel motif. C’est totalement ouvert. Jouer une telle partition oblige les musiciens à sortir du cadre, puisque ces partitions peuvent être interprétées d’autant de manières différentes qu’il y aurait de musiciens pour les jouer. On est obligé d’interpréter la partition tout à fait librement. Il n’y a pas deux interprétations d’une de ces pièces qui soient similaires. Chez Cornelius Cardew, « La partition n’a pas de profondeur, elle est aussi plate qu’un tableau de Jackson Pollock23 ». Il n’y a pas de profondeur mais une surface ouverte. Rien n’est caché, aucune stratégie ne pourrait préparer une surprise. Seul l’instant est surprenant.
Voici une vidéo24 d’une interprétation de Treatise, qui signifie « traité » en français. La partition défile comme un prompteur :
Aucune indication claire. Chaque musicien interprète la partition comme il le veut, comme il le peut. On voit par exemple un trait courbe. Qui va jouer ce trait courbe ? On ne le sait pas. Il peut arriver que personne ne le joue. L’improvisation est bien plus qu’un refus des modèles musicaux classiques. C’est un refus d’entrer dans le système capitaliste et de produire une quelconque marchandise musicale. Pas de hiérarchie, pas de domination, pas d’aliénation, pas de réification. Derek Bailey nous dit encore : « L’identité des musiques improvisées n’est déterminée que par l’identité musicale des personnes qui la pratiquent. Les capacités et l’intellect requis sont celles des personnes qui la pratiquent25. »
L’interdit préalable comme ouverture
Voici un contre-exemple en vidéo26, ou alors un parfait exemple de ce qui ne fonctionne pas. Les musiciens sont des étudiants d’un conservatoire. Je ne blâme pas ces étudiants mais plutôt leur professeur qui n’a rien compris au principe de l’improvisation et qui n’a pas initié ses élèves à la musique non idiomatique :
C’est la même pièce, la même partition, mais il ne semble plus y avoir de musique, seulement un brouhaha constitué d’un enchevêtrement de clichés. Cela sonne comme une fanfare qui est en train de se préparer dans les vestiaires d’un stade.
Une question se propose alors : Comment initier un musicien à l’improvisation non-idiomatique ? Nous voyons surgir la notion d’interdit. Effectivement, au début de l’initiation d’un musicien, on est malheureusement obligé d’en passer par l’interdiction : ne pas jouer de mélodie reconnaissable qui imposerait une esthétique à l’ensemble, ne pas jouer de rythme qui obligerait les autres musiciens à le suivre, ne pas jouer d’harmonie qui ferait référence à un style, à une géographie et à une époque. Très vite, l’apprenti improvisateur va découvrir que lorsqu’il se prive des idiomes, sa liberté va s’ouvrir. C’est là que la peur du vide s’installe, mais aussi et surtout que sa musique se déploie. C’est ce qui n’a malheureusement pas été expliqué aux musiciens de cette dernière vidéo. Se tenir en retrait, c’est bien ça dont il est question, oui, mais avec ferveur. Pas de décision, pas de volonté, pas d’opposition, une ouverture la plus large possible, une distance à soi. On ne sait pas ce qu’on fait, on ne sait pas si ce qu’on fait va quelque part ou non, surtout ne pas se poser ces questions-là, être en jeu avec la plus grande des vitalités possibles.
Une participante des ateliers que j’anime m’a dit récemment douter de la valeur de ses improvisations. Je lui ai répondu, avec la plus grande délicatesse possible, que ça n’est pas son problème. C’est éventuellement une question d’auditeur. L’enjeu ne se trouve pas là pour le musicien. C’est en s’investissant dans un travail, sans jugement, que son improvisation pourra faire écho.
Vulnérabilité
Je développe maintenant quelques propos sur le musicien Keith Rowe, britannique né en 1940. Pour déconstruire son jeu de guitare, il a imité un artiste, mais pas un autre musicien, un peintre : Jackson Pollock (encore lui !), qui, à un moment de rupture dans son parcours artistique, a posé les cadres de ses toiles sur le sol, à l’horizontale, sur lesquelles il jetait de la peinture. Cette technique lui a permis de s’émanciper du The renaissancegeste traditionnel du peintre pour ensuite inventer le sien. Keith Rowe a fait de même avec la guitare qu’il a posée sur une table, à l’horizontale, ce qui a neutralisé son mode de jeu. Plus question alors, car cela devenait physiquement impossible, d’imiter les modes de jeu des guitares-héros, très nombreux dans les années 60/70 et leurs gestuelles séductrices (ces modes de jeu ont par ailleurs donné des choses extraordinaires27, ce n’est pas la question ici).
Voici le setup de Keith Rowe, c’est-à-dire son matériel :

C’est une photographie prise de haut. On voit la guitare posée sur la table. On voit tout un ensemble de petits appareils qui pour la plupart ne sont pas conçus pour faire de la musique. Couverts de cuisine, clés de mécanique, téléphone, radio… Lors de ses interprétations des partitions graphiques de Cornelius Cardew, Keith Rowe a vu un rond qui lui a fait penser à un bouton de radio tel qu’on les trouvait sur ces appareils aujourd’hui anciens. Il s’est alors équipé d’une vieille radio comportant un gros bouton rond comme d’un instrument de musique venu compléter son set. Il s’agit d’un chemin plus que d’une raison, une logique qui n’appartient qu’à lui. La particularité qu’apporte l’utilisation d’une radio est que l’on ne peut pas savoir ce qu’elle va émettre. Cela peut être n’importe quelle esthétique musicale, n’importe quel discours, capté en direct, dans l’air. Impossible de choisir ou d’affirmer une quelconque volonté. C’est un accueil inconditionnel. Comme vous le verrez dans la vidéo suivante, ce musicien manipule ses objets avec une grande précision. Afin de pouvoir faire entendre chaque détail, le volume sonore de l’instrument est réglé assez haut. Le moindre accident, la moindre erreur de geste provoquerait un son gigantesque. La précision et la minutie gestuelle sont donc de mise.
Voici la vidéo d’un concert qui a eu lieu en 2012 dans une université des États-Unis28 :
Depuis, Keith Rowe a, malheureusement, été atteint de la maladie de Parkinson. Sa main droite tremble énormément et il ne peut rien y faire. Voici ce qu’il en dit : « La performance devient une performance de ce que je ne peux pas faire, une reconnaissance de ma propre vulnérabilité29. » Une deuxième phrase de Keith Rowe, pour laquelle je donne deux détails : Le manche de la guitare n’est pas droit, Il est un peu incurvé pour pouvoir accueillir le mouvement de la corde. Deuxièmement, si l’on branche une guitare électrique en extérieur et que le vent souffle sur les cordes, il la fera sonner. Keith Rowe dit : « Un poème commence, je pose mon cœur sur la table incurvée, remplie uniquement des émotions que je suis capable de jouer. Une brise vient balayer les cordes30. » Voici un bel exemple du « se tenir en retrait »
Je termine en citant le titre de l’intervention d’Elizabeth Saint-Jalmes lors de la journée « Geste de… » : « À la merci d’une nuance. » Être à la merci, c’est être en position de danger, de fragilité, de vulnérabilité, d’une possible soumission, ce qui est une, voire la condition d’un accueil. La nuance signifie un petit changement discret, comme un scintillement quelque part qui, s’il est repéré et accueilli, peut ouvrir un ailleurs.
J’ouvre mon propos par un possible accueil du neutre qui serait :
Se tenir à la merci d’une nuance31
.