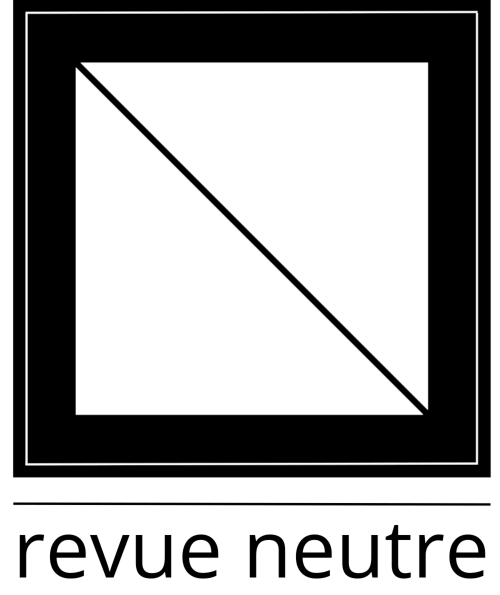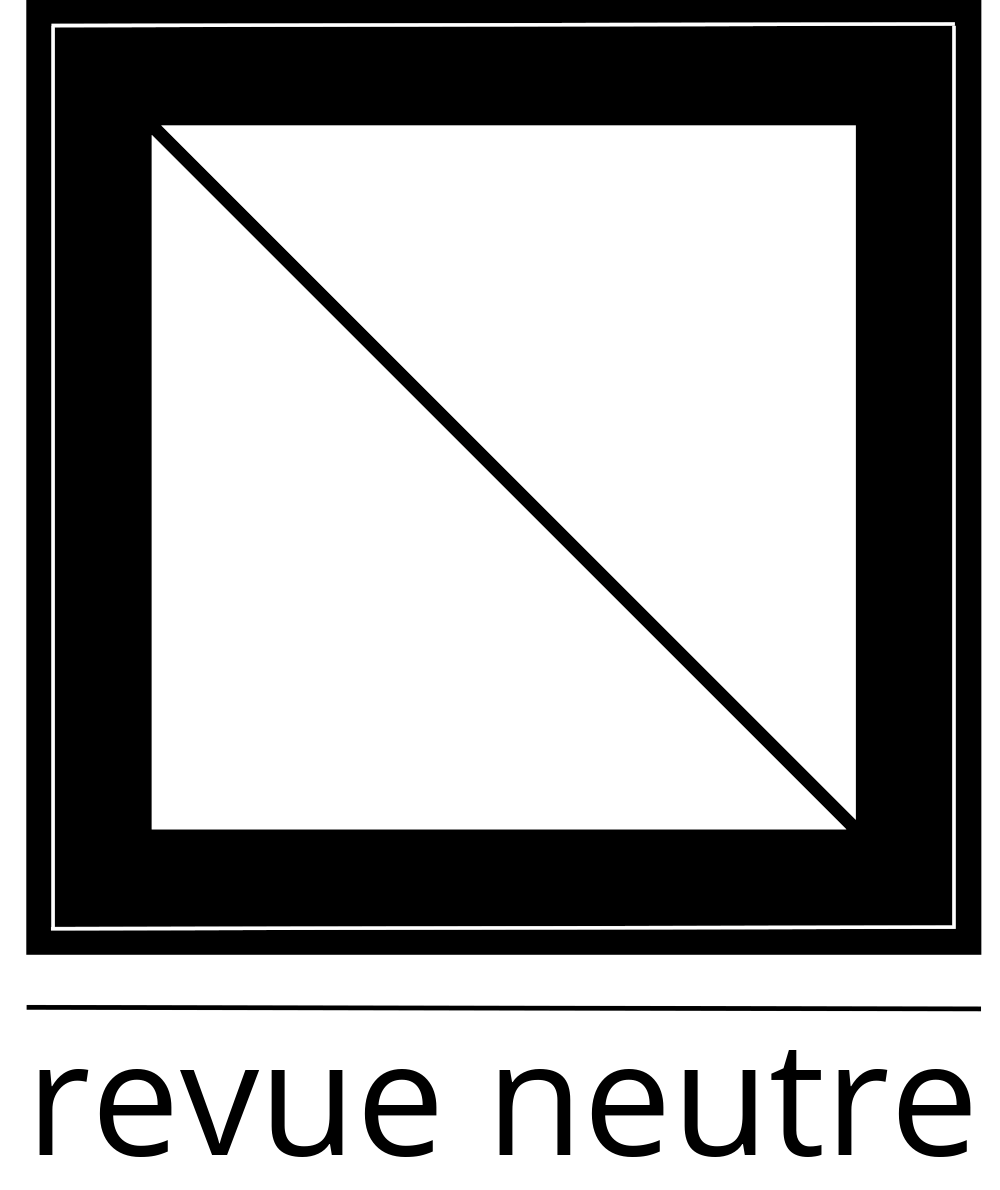TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE
Que voit-on dans Les Ménines1 ?
Laurent Zimmermann
 Il y a des tableaux à la fortune extraordinaire. Les Ménines de Vélasquez en fait indéniablement partie. Œuvre exceptionnelle en elle-même bien sûr, mais aussi pour les échos qu’elle a eus, échos dans la peinture, mais également dans la philosophie et la théorie. C’est à ces échos qu’est consacré L’effet Ménines de George-Henri Melenotte, dont le caractère réjouissant est de faire surgir précisément à notre mémoire ces lectures, ou réinterprétations, que nous connaissons, mais qui ne nous restent bien souvent en tête que de manière trop diffuse. Il ne le fait pas dans un simple exposé de thèses sur le tableau, mais, et c’est la première qualité de ce livre, en retrouvant les questions que se sont posées ceux qui ont écrit à propos de ce tableau (ou ceux qui l’ont réinterprété dans leur œuvre). C’est donc à une sorte d’atelier, l’atelier de qui regarde les Ménines, que nous sommes conviés. Comme si nous étions devant le tableau, mais devant le tableau avec Foucault, Lacan, Picasso, Leroy, Allouch.
Il y a des tableaux à la fortune extraordinaire. Les Ménines de Vélasquez en fait indéniablement partie. Œuvre exceptionnelle en elle-même bien sûr, mais aussi pour les échos qu’elle a eus, échos dans la peinture, mais également dans la philosophie et la théorie. C’est à ces échos qu’est consacré L’effet Ménines de George-Henri Melenotte, dont le caractère réjouissant est de faire surgir précisément à notre mémoire ces lectures, ou réinterprétations, que nous connaissons, mais qui ne nous restent bien souvent en tête que de manière trop diffuse. Il ne le fait pas dans un simple exposé de thèses sur le tableau, mais, et c’est la première qualité de ce livre, en retrouvant les questions que se sont posées ceux qui ont écrit à propos de ce tableau (ou ceux qui l’ont réinterprété dans leur œuvre). C’est donc à une sorte d’atelier, l’atelier de qui regarde les Ménines, que nous sommes conviés. Comme si nous étions devant le tableau, mais devant le tableau avec Foucault, Lacan, Picasso, Leroy, Allouch.
Pour ouvrir au questionnement, c’est le problème de l’image que reprend tout d’abord l’auteur dans un chapitre initial, en revenant à L’Imaginaire de Sartre qui, on le sait, développe le travail d’Husserl.
Tout l’intérêt de la démarche phénoménologique est de séparer différentes réalités usuellement confondues avec le terme d’image. Soit l’image en peinture de quelqu’un jouant aux cartes, de quoi s’agit-il ? De ce qui est peint (le modèle), de l’image qu’on s’en fait (représentation mentale aussi bien) et de l’image qu’est le tableau, dans sa réalité matérielle de traits, pâte, reflets, volumes, espaces, bords. S’agissant des Ménines, la question est immédiatement décisive, puisque le spectateur se trouve placé, dans le tableau comme espace, à la place qui est celle du roi et de la reine, à la fois regardant et modèle.
Michel Foucault, la dispersion
Dans un premier chapitre, on trouve suivie pas à pas la lecture très fine du tableau que propose Foucault, en ouverture de Les Mots et les choses. Plusieurs reproductions, du tableau dans son entier, puis du tableau avec numérotation des personnages, puis avec les parcours proposés par Foucault, ponctuent le chapitre ajoutant au plaisir de revoir, de relire, le tableau, avec Foucault.
Où il apparaît que Foucault commence par voir un triangle, allant de la toile représentée, mais non visible dans sa face peinte, au regard du peintre, puis au modèle, hors cadre, situé où le spectateur prend place. Puis c’est un X qui se dessine, toujours dans le regard de Foucault. Pour qu’apparaisse finalement, avec le reflet du couple royal faiblement visible dans le miroir, une logique de la représentation que Foucault met en avant, logique d’où le sujet s’efface et où se substitue, George-Henri Melenotte y insiste, à une logique du temps une logique de l’espace. Double intérêt du chapitre donc, cette sorte d’atelier non pas du peintre mais du philosophe, dans lequel il nous fait entrer, et ce point de théorie de la représentation auquel Foucault aboutit et qui se trouve ici déplié et mis en rapport avec d’autres textes du même auteur.
Sur ce second versant, c’est un Foucault théorisant le passage, en art, du temps à l’espace que nous voyons se déployer, un théoricien montrant combien la représentation quitte la stable dimension temporelle et donc causale pour rejoindre celle du pur espace, des agencements dispersés que le spectateur réunit à son gré, et provisoirement, suivant une suite de rapports qui aussi bien existent mais s’effacent, ne constituant donc pas un rapport fort au sens de ce qui mènerait à un parcours obligé. La dispersion, qui n’est pas un quelconque n’importe quoi mais un mouvement maintenu, relancé, continué, un type de lien permettant les réagencements, contre l’ordre d’une stabilité posée avec laquelle s’impose un lien figé.
Jacques Lacan, le sujet dans le tableau
Quatre semaines seulement après la publication du livre de Foucault, souligne George-Henri Melenotte, Lacan va à son tour parler du tableau de Vélasquez, dans cinq séances consécutives de son séminaire L’objet de la psychanalyse. La question de la représentation ne sera plus l’horizon du propos, puisque Lacan va, nous dit l’auteur, faire du tableau une image du fantasme.
La manière de procéder de Lacan est moins limpide que celle de Foucault. Néanmoins, un premier ensemble de questions s’y entend, touchant au regard porté sur le tableau. Et plusieurs différences importantes se lisent par rapport à la démarche de Foucault.
La première tient à la question de ce que le peintre représenté dans le tableau peint exactement. Pour Foucault, aucun doute : le roi et le reine, visibles dans un miroir placé au fond de la pièce derrière lui. Lacan n’accepte pas cette idée, avec une série d’arguments audibles, notamment que du point de vue des lois optiques (taille de l’image, absence d’autres éléments qui devraient être reflétés) le miroir peut difficilement présenter une image de ce qui est devant le peintre. Ainsi donc, suppose Lacan, ce qui est représenté sur le tableau que nous voyons de dos n’est autre que, tout simplement, la scène que nous voyons. De ce point de vue Lacan rapproche la toile d’une autre, de Magritte, La condition humaine, où une toile placée devant une fenêtre devient invisible parce qu’elle représente exactement ce qu’on voit au travers de la fenêtre.
Ce que Lacan va chercher à mettre alors en évidence dans les Ménines est, on le sait, un représentant de la représentation. Autrement dit, il ne s’intéressera pas à la seule représentation mais à ce qui la donne à voir. Et ce ne sera pas le cadre du tableau représenté qui sera situé à cette place, comme on pourrait l’imaginer selon la solution la plus simple, mais bien le tableau peint dans le tableau, que nous ne voyons pas.
Ici intervient le point auquel Lacan réfléchit dans le séminaire dans son ensemble, le fantasme. Celui-ci apparaît, dit Lacan, au moment où il se confond avec la réalité au point que leurs deux images sont indistinguables. Il est de ce point de vue l’équivalent, dira Lacan, du praticable au théâtre, soit de cet espace sur lequel les acteurs circulent, qui crée un volume, lequel vu de loin semble faire partie de la scène. Il y a pourtant un moyen de le voir pour ce qu’il est : passer derrière lui, comme on peut passer entre le tableau et la fenêtre dans ce que représente la toile de Magritte. Illusion, imaginaire, qui peuvent être vus comme tels, mais qui ne reposent pas sur rien, comme de fait le praticable existe, est un bâti, dira Lacan.
Où Lacan retrouve sa théorie du désir, dans un passage important cité par George-Henri Melenotte :
C’est là très précisément ce dont il s’agit, il faut avoir poussé les choses assez loin – et très précisément dans une analyse – pour arriver au point où nous touchons, dans le fantasme, l’objet a comme le bâti. La fonction du fantasme dans l’économie du sujet n’en est pas moins de supporter le désir de sa fonction illusoire. Il n’est pas illusoire : c’est par sa fonction illusoire qu’il soutient le désir, le désir se captive de cette division du sujet en tant qu’elle est causée par le bâti du fantasme.
À partir de cette première approche, c’est le sujet que Lacan traquera dans le tableau, mais le sujet comme divisé, dont il retrouvera, avec la fenêtre, puis les figures de la fente de manière plus générale – les paupières aussi bien – la part « élidée ». Le sujet divisé, et l’objet a qui est à son principe, et que Lacan verra exposé et dissimulé dans la splendeur du vêtement de l’infante. C’est ainsi le rôle de l’Autre que jouera le tableau, le rôle de celui qui détiendrait les clés et le point de départ de ce qui lie fantasme, désir, objet cause du désir et sujet divisé.
Peindre avec Vélasquez, peindre avec Picasso
C’est ensuite à la peinture que passe le livre, et pour commencer à la série des 58 tableaux que Picasso a peints à partir des Ménines. Profusion peu commune avec ce nombre impressionnant de variations. Qu’est-ce qui se joue là au juste ? Partant, montre George-Henri Melenotte, d’une fascination ancienne pour le tableau de Vélasquez par lequel il s’est trouvé comme happé, Picasso ne peint pas pour copier, mais pour se libérer, pour que les Ménines deviennent du Picasso. Opération particulière, sur laquelle il importe de réfléchir, et qu’il importe d’arriver à qualifier. « Cannibalisme », commode, ne convient pourtant pas. George-Henri Melenotte parle ici avec justesse d’une déclinaison de « la diversité critique des rapports » que Picasso construit avec Vélasquez, manière de dire que chaque variation est aussi un questionnement, en peinture, des enjeux de la peinture tels qu’ils s’imposent avec les Ménines.
Existe également, au plan théorique, un dactylogramme de Foucault, écrit après Les Mots et les Choses, consacré à cette série de Picasso. Elle fait l’objet de la suite de ce chapitre, et plus précisément suivant un angle que choisit d’explorer Foucault, la place du peintre dans la série de Picasso, ce qui lui permet de remarquer que celle-ci est d’abord bien plus grande – quantitativement, qualitativement – que dans la toile de Vélasquez, pour au contraire ensuite diminuer et quasi disparaître, comme s’il était nécessaire qu’elle sorte du tableau pour que l’acte de peindre puisse se déployer. Nécessité alors, d’en passer par la mort comme moment indispensable pour peindre.
C’est ensuite au travail d’Eugène Leroy, qui a peint également une version des Ménines, qu’un chapitre est consacré. Chez Eugène Leroy, George-Henri Melenotte trouve un travail de la peinture qui lutte contre la représentation pour déplacer « le regard vers la puissance de la pâte ». Refus de la représentation qui mène, dira le peintre, à « une absence presque », où il s’agit d’éloigner tout sujet reconnaissable pour faire valoir la peinture comme telle. Démarche matérialiste mais qui aboutit à une démarche in fine, plus profondément spirituelle, note George-Henri Melenotte.
Le dernier chapitre de l’ouvrage produit une opération différente. Il ne s’agit plus de suivre un rapport aux Ménines, mais d’en construire un autre, celui de l’auteur. Pour ce faire, le chapitre part d’une analyse de Louis Marin, et d’une notion qu’il avance, celle de « portraiture », et conduit vers les derniers travaux de Jean Allouch.
Prenant appui sur la gravure Le Chevalier, la Mort et le Diable de Dürer, Louis Marin développe une réflexion importante quant au couple présence/absence lié à l’image. La pensée de l’image implique en effet de mettre en jeu cette opposition entre la représentation et son modèle, re-présentation de ce qui est absent et a été présent comme modèle. Mais quand nous voyons les figures dans la gravure de Dürer, puisqu’elles sont amenées comme allégoriques, nous ne pouvons pas nous dire qu’elles représentent un quelconque modèle ; il n’y a pas ce chevalier, ce diable, cette mort, que le dessinateur aurait pu représenter. D’un autre côté, ces figures sont bien là, et ne peuvent être tenues pour des figures qui ne renverraient à rien, ni pour des notions ou des concepts, puisqu’elles sont là comme le seraient des figures pouvant renvoyer à un modèle. Dans quel espace se tiennent-elles dès lors ? Ni dans celui de la relation transitive entre la figure représentée et un possible et supposé modèle dans la réalité, ni dans celui d’un simple jeu des traits gravés. Ce qui se dévoile est un « ailleurs », celui ouvert par ce que Louis Marin appelle la « portraiture », soit « le figuré de la figure et non ce que la figure représente ». Cet espace est un espace autre, que l’adjectif « neutre » pour Marin qualifie : ni celui du tableau seul ni celui de la réalité où se trouve le modèle, mais pas non plus celui mental où un lien est supposé entre les deux. Un quatrième pôle, si on veut, se dessine donc par rapport aux trois que notait la phénoménologie husserlienne.
Avec Jean Allouch
Cette analyse permet à George-Henri Melenotte d’en revenir aux Ménines, avec Lacan et Allouch. Le premier constat est que les personnages présents sur la toile nous apparaissent comme vivants, ils le sont à leur façon, bien que morts pourtant dans la réalité. Mais qu’est-ce qui se trouve préservé d’eux, qu’est-ce qui survit ainsi ? Il ne s’agit pas d’un prélèvement dans du vivant qui serait transmis comme tel, mais bien d’autre chose, d’une autre dimension qui se trouve mise en lumière. Ce seront, au fond, des fantômes, le tableau tissant du vivant des modèles un linceul qui les fait s’engager dans un autre temps déjà. En ce sens, les figures n’y sont ni des représentations (renvoyant aux personnes réelles) ni une absence de représentation. Elles renvoient à ce neutre de la portraiture.
George-Henri Melenotte en vient alors aux travaux d’Allouch, et à ce qu’il dit de l’image, pour situer autrement la lecture lacanienne : « C’est de petit a derrière l’image, dit Allouch, pensait-on, que celle-ci tient sa prégnance et ses effets – pas de l’image en elle-même. » Or, c’est ce point qu’il s’agit de remettre en cause, puisqu’alors, comme le note George-Henri Melenotte « l’image en elle-même vient d’un lieu qui serait le sien ». Disparaît ainsi l’objet, qui n’a plus l’importance que lui accordait encore l’écriture du fantasme chez Lacan, l’érotique même ne dépendant plus de lui – d’où le nom d’analytique « célibataire » du sexe que lui donne Allouch. George-Henri Melenotte évoque alors, avec justesse, Annie Ernaux, dans un passage où elle évoque des photos, dans lesquelles elle ne voit pas d’êtres vivants mais seulement des fantômes, et vient revoir une chambre d’enfance qu’elle pose comme un pur lieu, sans du tout y ajouter imaginairement des scènes, des souvenirs précis. On adressera ici un reproche amical, et à George-Henri Melenotte et à Jean Allouch : à lire ces analyses, on réalise, une fois de plus hélas, combien Proust est peu lu. Quant au statut de l’objet et à l’analytique célibataire, une lecture d’Albertine disparue aurait été plus que bienvenue, Annie Ernaux, comme d’autres, ne faisant que reprendre par un autre tour, sans doute plus restreint, ce que Proust a déployé de manière incomparable. Mais c’est de manière générale toute la Recherche qui produit cette opération d’une transformation des vivants en ces fantômes agissant dans un lieu neutre, et si Proust a toujours tenu au fait que son livre n’était pas autobiographique, c’est certes concrètement parce qu’il se permettait certaines libertés par rapport à ce qui avait été, mais aussi et surtout parce que son roman était l’invention de ce lieu neutre et non l’illusoire prélèvement d’une part des vivants, de leurs actes, des circonstances avec lesquelles ils ont vécu. Reste que, si George-Henri Melenotte et Jean Allouch n’évoquent pas Proust, le fait que ce qui est développé par L’Effet Ménines fasse songer à Proust, est en soi une preuve de la fécondité de l’hypothèse. Et de fait, cet aboutissement du livre est très convaincant.
C’est ainsi un parcours vers une image devenue lieu spécifique, ni représentation ni seule matérialité, que nous suivons. Ce lieu n’est plus le lieu des objets. C’est le lieu d’un vide, de l’Autre inexistant, comme point ultime vers lequel aller – en analyse aussi bien. Les spectres qui peuplent ce lieu ne se définissent pas comme des moins vivants, mais seulement comme ceux qui peuvent habiter ce lieu, ou plutôt, de leur existence, le fonder pour ce qu’il est, un vide.
.