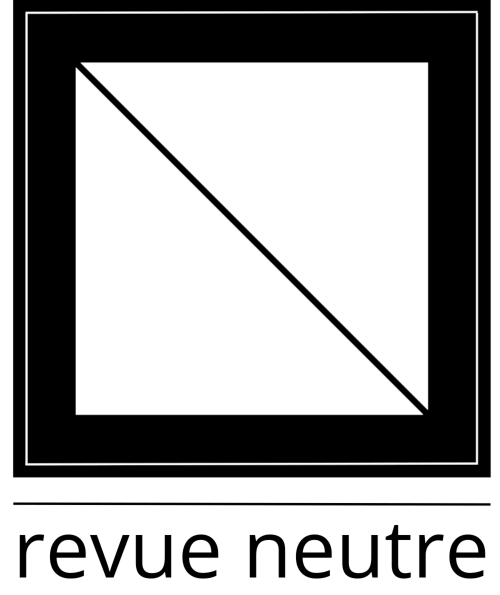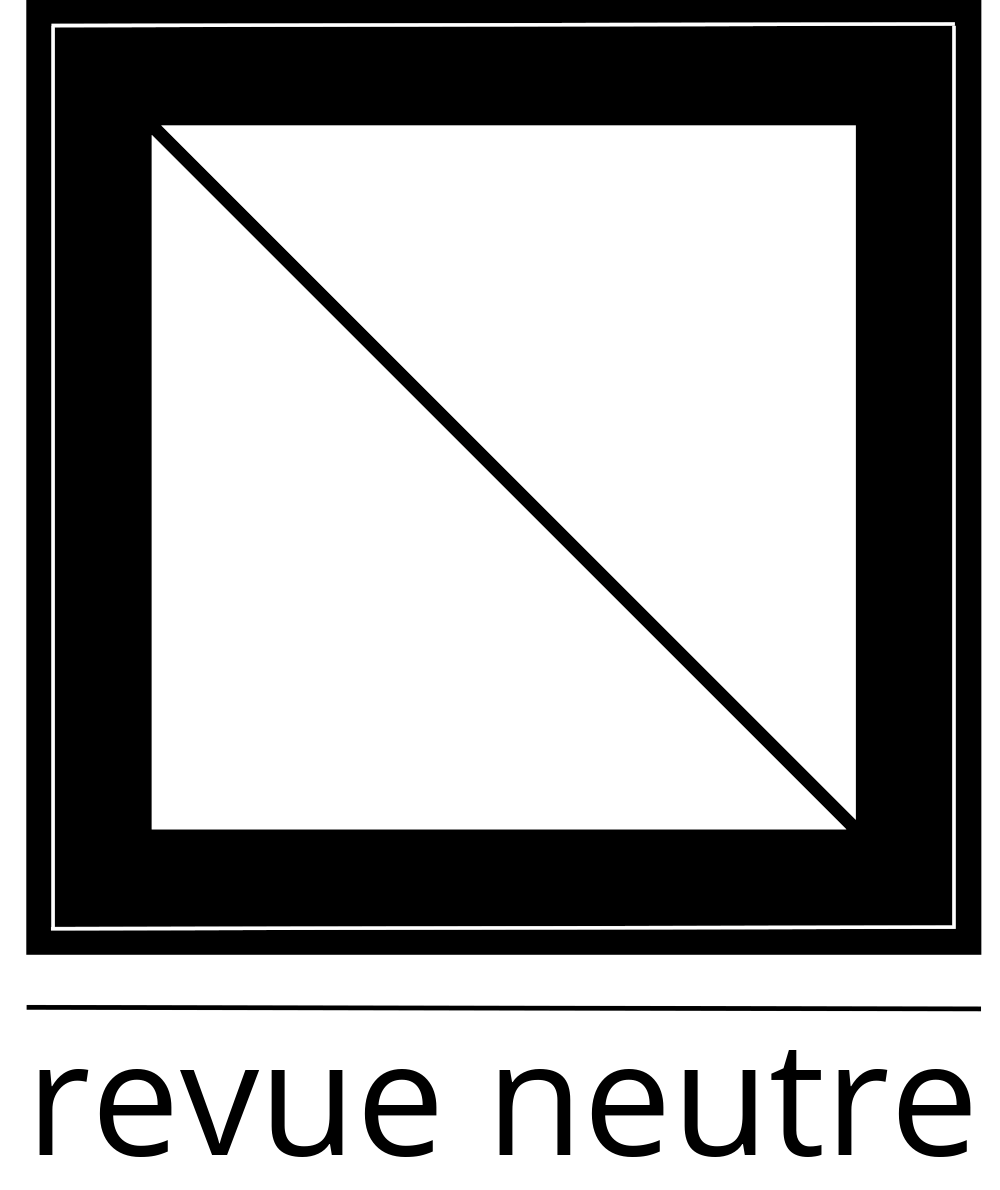TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE

« Votre névrose est grave, très grave »
Raquel Capurro
Marie de la Trinité ? une inconnue ? oui, mais une inconnue qui a voulu rendre publiques, par son écriture et après sa mort, ses expériences mystiques et les difficultés de sa vie spirituelle. De son point de vue elles nous concernent aussi, nous, les autres, les prêtres, les chrétiens, tout le monde, car entre Dieu-le-Père et nous il faut une médiation, un troisième terme : c’est de cela qu’il s’agit, dans les Carnets : des médiations, des médiateurs. Publiés en cinq volumes par les éditions du Cerf, ces écrits concernent donc son incroyable effort de faire connaître son expérience spirituelle, expérience qui résiste à se laisser attraper par l’écriture et qu’elle n’arrête que le jour où son psychiatre lui annonce : « Vous êtes une grave malade mentale ».
Il y a donc les Carnets, mais il y a aussi sa correspondance quasi quotidienne avec Mère Saint-Jean. Ces lettres nous font participer aux enjeux d’une fondation ainsi que des nombreux interlocuteurs avec qui elles sont en contact dans une époque difficile1.
En attente, parmi le non encore publié, il y a des notes prises par Marie de la Trinité du temps de son parcours psychiatrique et de son analyse avec J. Lacan. Mme Christiane Schmitt a fait la description de cet « héritage » tel qu’elle l’a reçu :
Les notes sont prises sur différents supports : cahier d’écoliers, feuilles volantes, dos d’enveloppes. L’ensemble, plutôt hétéroclite, donne l’impression que Marie de la Trinité utilise ce qui lui tombe sous la main et n’a pas l’intention, de prime abord, de constituer une « collection ».
La lecture de ces notes est rendue difficile – signale Mme Schmitt – tout d’abord par le style très elliptique, par l’emploi de nombreuses abréviations et quelquefois de la sténographie et du grec, pour certains mots ; aucun souci de lisibilité, on pourrait même dire que l’écriture est le baromètre du climat de l’analyse. Rien à voir avec la collection des carnets d’oraison si homogène d’un bout à l’autre, autant par le support choisi que par la présentation du texte et de l’écriture2.
Le « Dossier maladie », nom choisi par Mme Schmitt, nous donne accès à un premier effort de mise en ordre de cet ensemble. Le fouillis de la présentation telle que Marie de la Trinité l’a laissée ne peut être lu que comme faisant partie de ce qu’elle veut communiquer de son expérience de « malade » et de son analyse avec Lacan, car, sur 200 pages, plus de cent concernent cette analyse. Ce dossier a été au centre de notre travail.
Enfin il y a un grand et petit texte publié, écrit Pour Jacques Lacan, De l’angoisse à la paix qui nous offre des clefs pour penser la fin de l’analyse de Marie de la Trinité.
Revenons au Dossier, pour souligner qu’il y a là des lettres de ceux qui, en différents moments, furent en fonction de diriger la vie spirituelle de Marie de la Trinité, ou de prendre la responsabilité de « soigner » sa « maladie mentale ». Ces lettres font état des différents registres depuis lesquels son expérience est écoutée. Il y a pluralité de savoirs en jeu : spirituel, psychiatrique, analytique et, souvent, l’interlocuteur auquel elle adresse ses demandes entremêle les registres : par exemple quand le directeur spirituel donne à lire au psychiatre catholique les lettres confidentielles de « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » Marie de la Trinité ou quand, dans une lettre, ce même psychiatre rapproche son expérience mystique de celle des hérétiques espagnols, los alumbrados, ou encore lorsque J. Lacan la renvoie au péché originel.
Je vous propose d’approcher cette question des registres en prêtant attention à « un certain nombre de “tournants” historiques […] en tant que reconnus dans un certain sens ou censurés dans un certain ordre3 ».
Marie de la Trinité, soit dans sa correspondance soit dans les notes de son analyse, reprend ces tournants, en change sa lecture et, surtout les nomme autrement, dans son registre à elle, qui est toujours un registre spirituel : par exemple là où le psychiatre dit « maladie » elle dit « l’épreuve de Job ». De même quand, rencontrant Lacan, elle se présente comme « malade mentale » – label psychiatrique – cette réponse de Lacan : « les maladies mentales ne sont pas des maladies » lui donne la possibilité de parler dans son registre propre : « Je dis ça ». Il donne son assentiment à lalangue qu’elle ose ainsi mettre en pratique et l’approuve : « Oui. Nous l’appellerons ça ».
Est-ce une langue commune ? Plus tard, elle posera des limites et des critiques à certaines interventions trop catholiques de Lacan.
Nous allons essayer de suivre les traces de quelques tournants dans le parcours de Marie de la Trinité.
Au départ
Malaise en famille : une attente déçue.
En 1903, une famille d’industriels, du nom de De Mulatier, famille très catholique de Lyon, attend la naissance d’un enfant, qui, plus tard, se souviendra du récit circonstanciel de sa naissance et du choix qu’on a fait de son nom : Paule.
Avant elle, naît un petit garçon très attendu, Pierre – car après Jean, l’aîné, cinq filles s’étaient succédé – : Pierre meurt de la grippe quelques semaines après sa naissance et sera effacé de certaines chronologies familiales4. Paule n’a pas oublié le récit du deuil maternel :
Ce fut pour maman une peine immense. « Elle devint triste, perdit tout entrain et laissa un peu tout aller : ma grand-mère s’en alarma et vint un jour lui dire : “ ma petite on ne vit pas avec les morts mais avec les vivants ”. Rapidement elle prit le dessus5 ».
Après la mort de Pierre on attend de nouveau un garçon, Paul, mais c’est encore une fille qui naît, qu’on appelle Paule… la septième. Cette arrivée de Paule – son contexte – permet de lire l’expérience qu’elle souligne souvent, de toujours se sentir en famille « comme un cheveu dans la soupe », de faire « tache », de « n’être pas à sa place ». Il faut ajouter que le sentiment de « tomber toujours à côté de ce qu’il fallait » restera actuel pour elle quand elle se retrouvera dans la communauté religieuse et y deviendra – comme le souligne Mme Schmitt – signe de contradiction pour ces autres « sœurs ».
La découverte d’une vie hors famille, mais…
Au début de son adolescence Paule va tenter de vivre une année d’études secondaires en Italie comme une libération et comme une expérience d’exploration d’une vie différente de celle d’une vie de famille : elle veut – dit-elle – « savoir et voir de près comment vivent les religieuses » (1916, 1918). Elle va en conclure – ce qu’elle fera savoir à ses parents dans une lettre adressée à sa mère – qu’elle ne veut pas mener une vie de famille mais qu’elle veut être religieuse, missionnaire, si Dieu le veut bien…
Elle n’est pas la seule, dans sa fratrie, à poser ce choix : l’aînée des filles, sa sœur Marthe, en cette même année, 1918, va partir toute jeune au couvent des Clarisses pour y mener une vie contemplative. Marthe a 22 ans, Paule en a 15.
Marthe… que lui est-il arrivé pour devenir… « folle », à peine rentrée au couvent ? est-ce la vie contemplative qui a déclenché… quoi ? un délire ? un passage à l’acte ? ou un accident neurologique ? je n’ai rien trouvé qui l’éclaircisse, au contraire, on nous dit qu’elle est placée dans une Maison de Santé où elle meurt à 46 ans, le 22 août 19426, « au bout de 24 années d’internement psychiatrique7 ». Nous lisons ses traces, par exemple, dans les notes de la séance avec Lacan du 28 novembre 1950, où Marie de la Trinité écrit : « La folie de Marthe a laissé un grand sillage qui a influencé toute la suite8 ».
La grande Grâce et l’obéissance au directeur spirituel : un agencement à problèmes
Deux événements indissociables articulent le tournant d’entrée dans ce « hors famille », que Paule cherche dans la vie religieuse : l’expérience de la grande Grâce et l’entrée, sous obéissance, chez les dominicaines des campagnes – renoncement à la vie contemplative au Carmel qu’elle voulait mener. Un nouveau nom, qu’elle choisit, noue cet agencement : Marie de la Trinité.
La grande Grâce. Une expérience limite.
La grande Grâce, fut écrite pour la première fois le 19 mars 1937, dans une lettre adressée au P. Chauvin, son directeur spirituel. Lisons quelques passages.
Je n’ai jamais eu de grâce semblable ni avant ni après […] La grâce dont je parle, je l’ai reçue à Champagne – le 11 août, je crois, 1929. J’étais venue pour la retraite des sœurs à laquelle je ne voulais pas prendre part. J’avais refusé à Mère Saint-Jean d’y venir.
La veille le Père Périer9 revint à Lyon. […] Je lui ai dit que j’avais refusé d’aller là parce que je ne voulais pas y entrer, que je voulais uniquement la vie contemplative cloîtrée.
Il me dit d’y aller – et de me décider à entrer là. J’avais déjà fait vœu d’obéissance – et j’y allai sur sa parole.
Ces jours de retraite furent une sorte d’agonie10. […].
Ce 11 août je demandai dans l’après-midi à MSJ de rester à la chapelle le soir jusqu’à minuit pour prier. […]
Le soir arriva : après matines la plupart des sœurs quittèrent la chapelle ; quelques-unes restèrent et partirent à 10 h, je crois.
Je m’étendis par terre les bras en croix – il faisait froid sur les carreaux – j’étais mince, je sentais tous mes os, de la tempe aux pieds, je méditai sur la mort. « Bientôt il n’y aura plus que cela de moi […] ».
Ce qui se passa ensuite est bien plus difficile à dire – parce que ce ne fut pas mon opération mais celle de Dieu en moi – plus divin qu’humain.
Il n’y eut, mon Père, ni parole, ni idée exprimée humainement, ni image.
Il n’y eut rien qui puisse être perçu par les sens – ni pensée qui soit de l’effet d’un raisonnement quelconque, ni spéculation, ni théorie, ni rien de ce dont on se sert pour l’exercice naturel des facultés. […].
Comment vous dire, mon Père ?
Je fus comme immergée en Dieu – et il me sembla qu’Il m’absorbait en sa Déité – et que, restant moi, je n’opérais cependant plus par moi-même mais, par Lui, je me trouvais à la fois dans une immobilité et une activité suprême. […].
Je vis, non parce que je pouvais voir, mais parce qu’il me donnait de voir, et il n’y avait pas de distance de moi qui voyais à ce que je voyais.
[Plusieurs pages se suivent ainsi scandées : je vis…je vis…je vis]
À minuit et demi je quittai la chapelle […].
Ce mystère il était maintenant caché dans l’âme, et les facultés, livrées à leur faiblesse n’y pouvaient avoir accès – mais ce qu’elles avaient expérimenté demeurait en elles. […].
Ce que Paule a vu – lumières –, ce qu’elle a entendu – paroles –, ce qu’elle en a vécu, – l’expérience – eut des conséquences. Elle va décider mais, pour ne pas se tromper, elle va chercher une assurance. Laquelle ?
L’obéissance comme assurance contre l’égarement.
Un tournant dans sa vie se produit. Voici ce qu’elle en dit longtemps après (1971) :
Je n’aimais pas la spiritualité dominicaine trop intellectuelle pour moi et trop hâtive. Je n’avais aucune expérience du monde religieux, j’avais seulement lu dans bien des livres que l’obéissance était une voie sûre. Depuis longtemps j’avais fait le vœu de chasteté – j’y ajoutai celui de pauvreté, puis celui d’obéissance car ce directeur me mettait en garde contre ma volonté propre, ne m’aidant pas à distinguer ce qui était volonté propre, et grâce de vocation. Je pensai donc qu’en me cramponnant à l’obéissance, par amour pour Dieu, je serais à l’abri de mes propres égarements11.
La conscience est perçue comme dangereuse, en revanche, l´obéissance serait une voie sûre, un « abri contre ses propres égarements12 ». En 1944, elle poussera cette conviction jusqu’à offrir à Dieu sa conscience en holocauste et sa fonction au P. Motte, son directeur spirituel. Quels sont ces égarements qui la menacent ? l’ombre de sa sœur ? Tourments. C’est dans son analyse que Marie de la Trinité arrivera à lire autrement cet engagement de départ.
Un artifice subjectif : UTI et FRUI
Jouissance et utilité, jouir et se rendre utile, deux expériences bien différentes que Lacan reprend dans son Séminaire (Encore) en soulignant, avec Saint Augustin, que la jouissance ne sert à rien, n’est pas de l’ordre de l’utile. Il souligne que :
La jouissance, de ce fait, reste une question, question en ceci que ce qu’elle peut constituer n’est pas nécessaire d’abord. C’est pas comme l’amour : l’amour, lui, fait signe et – comme je l’ai dit depuis longtemps – il est toujours réciproque13.
Pourtant, les premières années de sa vie au couvent, Marie de la Trinité appuya sa volonté de service sur les moments de jouissance contemplative.
Cette vie commune, exigeante, avec d’importantes responsabilités, lui a été rendue possible parce que sa vraie vie était « ailleurs », cet au-delà elle le nomma « in sinu Patris14 ». C’était pour elle le lieu du repos, un lieu sans-au-delà. Hors-temps.
Sans doute, les années 1940 ont été une décennie difficile : le monde était secoué par la guerre. Quand l’armée allemande envahit la France la congrégation se déplaça vers le Midi, à Clermont-Ferrand, puis à Tarbes, retour ensuite à Flavigny, puis voyage à Rome pour faire approuver la Constitution.
Pendant une dizaine d’années, (1932-1944) tout en regrettant les limites d’un style de vie qu’elle n’aurait pas choisi, Marie de la Trinité trouve une issue de compromis en cherchant à se rendre utile de mille façons à la congrégation tout en se procurant le temps nécessaire à sa vie d’oraison suivant les conseils du P. Motte, son directeur spirituel.
Que s’est-il passé ensuite ? En 1941 déjà, Marie de la Trinité est épuisée – « écartelée » – c’est son mot à elle – par ce mauvais nouage et décide de consulter deux médecins qui lui recommandent une année sabbatique. En 1942, un phlegmon l’oblige au repos pendant six semaines. Elle profite de ce moment pour commencer à écrire ses Carnets. Ces 35 petits carnets, qu’elle va dactylographier soigneusement dans ses dernières années, n’ont été lus que par ses directeurs spirituels qui lui ont demandé d’écrire ses expériences, puis par J. Lacan 15
À partir de 1942 elle s’applique à l’écriture de cette expérience jusqu’en décembre 1946 où elle reçoit, – peut-on dire comme un arrêt, le diagnostic du Dr. Nodet : « votre névrose est grave, très grave » qui, avec son double soulignement la stoppe.
Quelques jours après le 22 décembre 1946 elle écrit ceci dans la dernière page des Carnets : « Laisse mourir et mûrir. // Laisse-toi mourir pour mûrir ».
Le 17 décembre 1978, quand elle dactylographia les Carnets, elle ajouta une note pour écarter toute hésitation au lecteur : « le carnet 35 qui est le dernier s’arrête là ».
En 1946, Marie de la Trinité est non seulement épuisée mais une « dépression » commence à s’installer, envahissant les entrelacements de temps de grâce et de temps d’épreuve.
En 1945 elle avait déjà annoncé à Mère Saint-Jean qu’elle deviendrait « inutilisable » : elle a subi ce qu’elle va nommer un « coup de mort », elle devient inutile. C’est l’annonce d’un nouvel état spirituel avec une image qu’elle a peinte inspirée d’une œuvre de Léonard : le Christ dans sa passion auquel elle ajoute un voile. « Ma première fidélité est de demeurer enfoncée sous le voile ». Endeuillée ? Sa sœur Marthe est morte en 1941, son père en 1943. Le 29 décembre 1945 elle écrit : « Pendant Matines du Dimanche, vue d’un cercueil basculant dans le caveau – est-ce moi ? ma mort naturelle ? la perte de l’usage des facultés spirituelles ? l’enfoncement dans l’oubli ?16 »
L’épreuve change aussi les façons de se manifester : au début, elle se sent écrasée par les tâches qui lui sont confiées et tiraillée entre celles-ci et sa vocation contemplative. Puis un « mur » (sic) d’obsessions l’enferme (elle est « emmurée ») de plus en plus, au point de trouver que le lieu de l’Autre lui est devenu inaccessible – une « muraille » l’en sépare – et toutes les formes de prière n’ont plus aucune portée : elle ne peut ni méditer, ni prier, ni réciter l’office divin, ni réciter le chapelet, etc. Comment retrouver ce lieu qu’elle nomma in sinu Patris ?
En 1950 elle parlera à son analyste de ce lieu où elle avait vécu « l’expérience ineffable, pure et comblante, d’une volupté, une possibilité enfin pour moi d’aimer librement et une certitude : le sentiment d’être aimée moi-même ».
Elle se souvient aussi que Lacan lui dit alors :
« La certitude de la chose, du fait, de sa réalité est incontestable – mais il faut chercher sa signification. » […] – J’ai peur – dit-elle – que j’aie toujours inconsciemment cherché cette volupté que j’ai vécue et qui m’a comblée – elle a mis aussi une gravité dans ma vie17.
Comment nommer ce silence de l’Autre, cette expérience d’absence d’un lieu qu’elle avait fréquenté ? Elle écrit c’est un « coup de mort ». Elle avait cherché l’expression de ce coup de mort dans la puissance d’une image qui renvoie à une espace de torture : un cercueil en fer avec des clous dans son espace intérieur, cercueil en forme de jeune fille. Cet instrument de torture médiéval (Die Jungfrau, Musée de Nuremberg), place son expérience dans un registre où le châtiment et la culpabilité sont évoqués.
L’année suivante, 1945, elle laisse tomber cette image de la Jungfrau et une autre image prend le devant de la scène. Elle en fait la transcription dans ses Carnets et dans une lettre à Mère Saint-Jean. Cette insistance de son écriture met en relief son importance. Voici le texte :
Je me vis comme un immense cratère, une mince bordure en marquait le contour. Le cratère n’était, comme tel, que pure capacité de l’esprit simple. Le Seigneur, à la faveur de l’oraison, l’avait ainsi comme creusé, distendu, dilaté pour sa propre demeure en moi. […] le cratère, lui, n’avait pas de fond, il n’était fini que selon la bordure. Il n’était pas lumière, mais ténèbre (sic) […]18.
Dans les années 70 elle donnera une version dépouillée de pathos de cette nuit spirituelle, de cette « ténèbre » (écrit au singulier) comme elle la nomma aussi, une allusion probable à l’Office des ténèbres du Vendredi Saint19. Dans une lettre au cardinal Feltin, elle écrit :
J’ai fait alors l’expérience que ni l’obéissance ni la ferveur ni l’acceptation de volonté d’une vie si contraignante, ni même la prière, ne suppriment les limites humaines, que la résistance à certaines épreuves n’est pas indéfinie et que l’effondrement psychique n’épargne pas la vie spirituelle soit qu’il la paralyse, soit qu’il la perturbe.
Elle nommera alors cette nuit spirituelle « l’épreuve de Job », c’est-à-dire l’épreuve du juste.
En 1944, quand elle devient « inutilisable » elle cherche des issues réparatoires en offrant sa conscience en holocauste et en faisant appel à l’ancienne pratique du jeûne – elle veut « vider son corps », en faire un lieu pour accueillir la manifestation divine. Elle fait une grande scène de colère dans la communauté, contre son directeur et contre sa supérieure qui n’autorisent pas ses excès. La vie en communauté lui devient impossible.
Plus tard, en séance avec Lacan elle évoquera ses difficultés, concluant :
Marie de la Trinité : « (…) J’ai choisi la vie religieuse non pour elle-même mais comme moyen le plus assuré d’union à Dieu. C’est seulement cette union à Dieu que je désire. […]. »
Lacan : « Mais il n’est pas prouvé que la vie religieuse est le moyen le plus favorable. »
Marie de la Trinité : « Il y a mieux que l’Église pour l’assurer, il y a l’Évangile ; et ce que j’en attendais, je ne l’ai pas eu, j’ai tout raté. La vie religieuse m’est bien égale et la vie contemplative aussi ; ce que je cherchais c’était uniquement l’union à Dieu – et j’ai tout raté. Je ne peux même plus prier – j’ai perdu l’orientation et l’élan. »
Lacan : « Mais il y a des réussites qui sont faites d’échecs. »
Marie de la Trinité : « J’ai pleuré et je me suis tue. »
Lacan : « Qu’est-ce qui vous arrête ? Une petite chose ? Des larmes ? »
Marie de la Trinité : « Oui, j’ai tout manqué.20 »
![]()
![]() Cette même conclusion l’avait déjà décidée quelques années auparavant – 1945 – à consulter un psychiatre. Un autre tournant et tourment commençait alors. Un nouveau registre allait fonctionner : la maladie mentale.
Cette même conclusion l’avait déjà décidée quelques années auparavant – 1945 – à consulter un psychiatre. Un autre tournant et tourment commençait alors. Un nouveau registre allait fonctionner : la maladie mentale.
Le psychiatre et son savoir : la maladie mentale
Au mois de décembre 1945, première consultation avec le Dr. Nodet, psychiatre, catholique. Changement de registre, elle va poser sa demande en d’autres termes : pour restaurer son expérience, il faut restaurer sa nature. Le Dr. Nodet prend la direction psychiatrique de son cas et prescrit une psychothérapie.
Deux échecs s’en suivront. Marie de la Trinité est à Paris. La crise autour du jeûne devient plus grave.
Dans la communauté on s’interroge : elle fait de grosses crises de colère comme dans son enfance. Accès de folie ? possession du diable ? Les deux interprétations circulent et le nom de Marthe aussi : si cela ne vient pas du diable, alors c’est une menace de folie ou, comme on dit, de « maladie mentale ». Un signe : le jeûne change de nom, on parle d’anorexie. Un autre registre prend place.
C’est alors que son directeur, le Père Motte, perd pied et donne à lire au Dr Nodet des lettres confidentielles de Marie de la Trinité. Le transfert de Marie de la Trinité au P. Motte est ébranlé. C’est un tournant aussi dans sa confiance au Dr. Nodet qui – après un certain temps, ne voyant pas de changements dans la malade, lui pose un choix radical : « Lobotomie ou Psychanalyse ». Son choix l’achemine au 5 rue de Lille.
En analyse avec Lacan
Le 30 mars 1950 Lacan reçoit Marie de la Trinité. Il a eu un accident de ski. Il a une jambe dans le plâtre.
Le samedi 1er avril c’est la première séance, après laquelle elle commence à prendre des notes : Encre rouge Marie de la Trinité, encre bleue, Lacan.
« C’est pour une montée21 »
Marie de la Trinité : impression de douceur, de compréhension (pleurs).
Lacan : les maladies mentales ne sont pas des maladies. Exclus : « maladie, anormal ».
Marie de la Trinité : Je dis ça.
Lacan : oui, nous l’appellerons ça.
Une discipline à essayer22.
Le style change.
Elle parle de souvenirs d’enfance, elle pleure. Lacan lui demande de noter par écrit des souvenirs d’enfance. Elle poursuit : « pension en Italie pour tenter la vie loin de ma famille. Difficultés d’adaptation, malaise ».
Lacan : Là où les silences de Dieu laisseraient à l’homme la liberté et la responsabilité de ses recherches l’homme a une place à prendre. Sur la nature de l’homme. On accorde traditionnellement à l’homme une nature : un principe de croissance qui propose à chaque individu une vraie décision. […]23.
Je voudrais seulement souligner deux moments de cette rencontre : l’accueil chaleureux de Lacan et son intervention pour écarter le langage psychiatrique ce qui permet l’émergence de lalangue de celle qui devient son analysante.
Après, le ton change, devient plus doctoral : « les silences de Dieu laisseraient à l’homme l’espace de sa liberté et de sa responsabilité. » Le silence de Dieu c’est l’insupportable souffrance de Marie de la Trinité, la muraille qu’elle espère détruite par l’analyse lui donnant un nouvel accès « in sinu Patris24 ».
Une autre phrase attire notre attention : « Sur la nature de l’homme. On la lui accorde, c’est un principe de croissance qui propose à chaque individu une vraie décision (etc.)25 ».
Conjecture : dans sa demande à Lacan, aurait-elle introduit la question de la nature « dénaturée » de son état comme elle l’a fait avec le Dr Nodet ? Pour elle, guérir serait « redécouvrir la possibilité de prier » et pour cela doit s’accomplir en elle une « restauration de sa nature ». Cette formulation s’appuie dans la tradition philosophique qui remonte à Aristote et à Saint Thomas, et se trouve déjà transformée dans l’aphorisme latin qu’elle cite souvent : Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur, c’est-à-dire que ce qui est reçu est reçu selon (la forme de) celui qui reçoit. Les « murs » dé-forment sa nature et empêchent le contact « in sinu Patris ».
C’est sa croyance en elle, assez inébranlable : elle l’écrit au Dr Nodet, et en parle dans les séances avec J. Lacan : blocages, meurtrissures, crispations, autant d’atteintes contre sa nature.
Le 4 octobre 1950 elle écrit au Dr H. Ey :
Je sens que la psychologie ne pourra jamais rien contre une crispation qui m’est restée depuis que j’ai eu, à force de tension morale, plusieurs crises nerveuses, il y a de cela environ 4 ans. […] il me semble que j’ai dans le cerveau des rides, des rigoles. Qui se sont creusées à la suite de choc […]et jamais des conversations n’arrangeront cela.
Avec cette conviction elle lui adresse une demande :
Si un traitement d’insuline ou je ne sais quoi, pouvait être tenté pour une action physique (somatique) directe, je demanderais d’interrompre les séances le temps nécessaire à ce traitement, pour les reprendre après26.
Durant les trois années d’analyse, Marie de la Trinité a fait, en transfert avec Lacan, un parcours très important : sa famille, se féminité, sa sexualité, son corps, son transfert au P. Motte, son rapport à Mère Saint-Jean, etc. Elle a joué le jeu de l’analyse mais sans jamais démordre de cette conviction : celle d’une limite de la psychanalyse comme pratique de l’imaginaire et du symbolique, limitée pour modifier ce qu’elle nomme « réel » et situe dans le cerveau. Elle demande au psychiatre d’intervenir sur ce réel d’une jouissance portée disparue et qu’elle localisait « in sinu Patris ». Elle suppose – supposition imaginaire – ne pouvoir atteindre cet au-delà à cause de crispations produites dans son cerveau, là où les paroles n’ont point de pouvoir.
À la fin de sa troisième année sur le divan de Lacan tout en se trouvant beaucoup mieux, elle demande donc à H. Ey d’entreprendre les traitements qu’il jugera bons et rentre à Bonneval. Elle est impatiente. Le réel de cette intervention, son échec par rapport à son attente, lui permettront de faire les pas nécessaires pour accepter ce qu’elle avait bien entendu dire par son analyste : « Mais il y a des réussites qui sont faites d’échecs ».
De l’échec de l’expérience de Bonneval elle fait un écrit « Pour J. Lacan : “De l’angoisse à la paix” ». Peut-être le refus de Lacan de la reprendre en analyse après Bonneval fut une intervention qui va dans ce sens, en tout cas, c’est la conclusion qu’elle en tire et ce qui la pousse « à prendre sa vie entre ses mains ». (Lacan : « Vous n’avez jamais pris votre vie en vos mains ») et à accepter les conséquences de ses choix, c’est-à-dire les risques de sa liberté.
Aux différentes demandes « d’être mise en cage » (Lacan dixit) Lacan s’abstient d’intervenir comme l’ont fait ses directeurs de conscience, lui, en revanche, lui laisse aussi la liberté de se tromper : il n’intervient pas sur sa décision de traitement à Bonneval. C’est en 1956 – trois ans après, qu’elle lui adresse son texte sur son expérience à Bonneval. Cette année, il la recevra pour un travail de contrôle (elle reçoit des religieuses en consultation depuis son analyse), contrôle qui s’arrêtera assez vite sur un point très précis : son refus de payer.
Elle va faire route avec ce qu’elle a déjà compris et dont elle a eu en 1946 ce qu’elle nomma « une vue imaginative27 » : l’image d’un volcan éteint.
Au soir de sa vie, en 1971, sa « maladie mentale » prendra la dimension d’avoir été un grand malentendu.
Elle écrira alors :
Quand je disais à des prêtres : « je ne peux plus prier » aucun n’a compris ce que je n’ai moi-même compris que très longtemps après. Cela voulait dire : « je ne peux plus avoir l’expérience de me tourner vers Dieu, de me recueillir, de lui parler » – je confondais ces conditions subjectives avec la prière elle-même28.
Ses conditions subjectives ont changé. L’expérience mystique est acceptée comme un souvenir précieux dont elle témoigne, mais l’expérience ne se renouvelle plus. Elle est hors de sa portée.
Elle croyait – c’est l’autre image qui traverse son écriture – qu’en faisant tomber les murs qui l’entouraient ou qui entouraient le lieu saint tant désiré qu’elle se retrouverait « in sinu Patris ». Ces murs, cette sonorité familiale « mu » – Mu..latier – insiste comme note musicale tout au long de ses textes. Voilà que les murs sont tombés. Oui, et alors ? Voilà son témoignage : « La pire déception fut de découvrir que, sous les obsessions, il ne restait plus rien ; car je m’imaginais que, les obsessions passées, je me retrouverais telle qu’avant29 ».
Les obsessions disparues un trou est rendu visible, effet et témoin du prix qu’elle a dû payer dans ce passage de l’angoisse à la paix. La théorie traumatique qu’elle avait fait valoir pour faire son expérience à Bonneval s’effondre, le traumatisme a laissé sa place au troumatisme, dont le cratère donne une vue imaginative : « […] le cratère, lui, n’avait pas de fond, il n’était fini que selon la bordure. Il n’était pas lumière, mais ténèbre (sic) […]30 ».
Elle a fait alors, avec cette image du volcan mais aussi avec un rêve, le seul rêve qu’elle eut à Bonneval, son passage du traumatique au « troumatique ».
Les années de sa psychanalyse avec Lacan, mais aussi l’échec de ce qu’elle attendait de Bonneval, et qu’elle déchiffra pour son analyste, lui ont rendu possible ce passage de l’angoisse à la paix dont elle témoigne.
Annexe
Marie de Saint-Jean et Marie de la Trinité, « 5 mai 1950 », Correspondance, Marie de la Trinité- Marie de Saint- Jean Vol. II, Paris, Le Cerf, p. 453-455
Ce matin, en lisant la Divine parole, l’idée m’est venue de la transcrire « avec forme » pour la mère et sa fille. Je vous envoie ceci, vous me direz si quelque résonance en jaillit pour vous ? J’ai pensé qu’en voyage, cela vous serait une détente mentale, et une nourriture pour ce fond d’esprit qui vous apparente, peut-être aussi à ce « Jean » de l’Apocalypse qui voyait tout avec forme : peut-être la forme va-t-elle plus loin que le concept et s’intériorise-t-elle plus avant dans la substance de l’être ? Ceux qui ne sentent pas la chose, manquent peut-être de certaines résonances profondes, et ils en rient comme d’une fantaisie : mais l’Écriture, y répond – tout grand visionnaire a vu, ou au moins traduit « avec forme » comme Isaïe chapitre 6 – et avec-forme-et-couleur comme parfois Ézéchiel et presque toujours le Jean de l’Apocalypse.
Quelques explications sur ces dessins :
Tite 2,11 : d’où s’est manifestée cette « grâce de Dieu » ? de la Déité, même qui est lumière et plénitude – et cette source est de jaspe comme nous, le dit l’Apocalypse – au bas, ce sont les têtes de « tous les hommes » devenus eux-mêmes jaspe en buvant à la source. Remontent le long de la source : la tempérance en forme de vase et de lyre (signe du lundi-cosmique), car c’est du cosmos qu’il faut faire usage modéré – puis, au-dessus, la justice qui doit demeurer droite sans être trop bienveillante injustement pour les uns, ni trop sévère injustement pour les autres : la justice est toujours tiraillée entre des contraires qui s’attaquent directement à elle. Au-dessus, vous reconnaissez l’adoration, car la piété qui ne procède pas de l’adoration est illusion. La couleur est violette, ce qui est bleu + rouge, = usage de la création impliquant toujours une part de circoncision sanglante, signe de l’Alliance, dont il faut apposer le sceau sur tout ce qui monte de nous à Dieu : et tout doit monter à Lui.
J’ai refait avec les couleurs des jours.
Tite 3,1.2 : le signe d’en-haut signifie que tout doit se faire en présence de Dieu, qui n’est pas une présence latérale, comme d’une créature à une autre, mais une Présence Altissime – même en nous-mêmes, elle est à la « fine pointe » de l’âme : c’est une Altissime de valeur et de mystère.
Au-dessous le cercle est une auréole de jaspe, diadème de la création et surtout de la créature humaine, figurée par le signe de la création, qui trace aussi le contour du visage sans trait, où la… serait sur la bouche : ne dire du mal de personne, éviter les contestations, n’est possible qu’avec des lèvres crucifiées ; vous savez qu’elles furent brûlées avec un charbon ardent à Isaïe : ce qui dans l’Ancienne Alliance était signe de purification, à quoi les divins desseins ont substitué la Croix, qui est un feu : « Je dois être baptisé d’un baptême de feu. »
« La plus grande douceur à témoigner à l’égard de tous les hommes », ce sont ces traits d’eau bleue : l’eau sait prendre la forme du contenant – sous l’eau, tous les hommes, tous les humains, baptisés ou non, tous bleu de création simple, sur lesquels doit fluer la douceur des fils de Dieu que nous sommes.
Tite 3, 4-7 : En-haut : Dieu notre Sauveur (Dieu notre Déité-Sauveur), Dieu notre Sauveur comme dans l’Ancienne Alliance on appelle Dieu lui-même « Sauveur » – au-dessous l’étoile du Seigneur Jésus qui est Lui-même « la bonne et joyeuse nouvelle » et dans les eaux, l’Esprit nous renouvelant « répandu sur nous largement. » Il ne couve pas seulement les eaux par au-dessus, comme dans l’œuvre de la création, mais il y plonge, leur conférant une efficacité divine – Il est tout blanc, en colombe, et nous conférant le vêtement de résurrection sainte. Au-dessous, toujours les humains. Les eaux sont de jaspe.
.