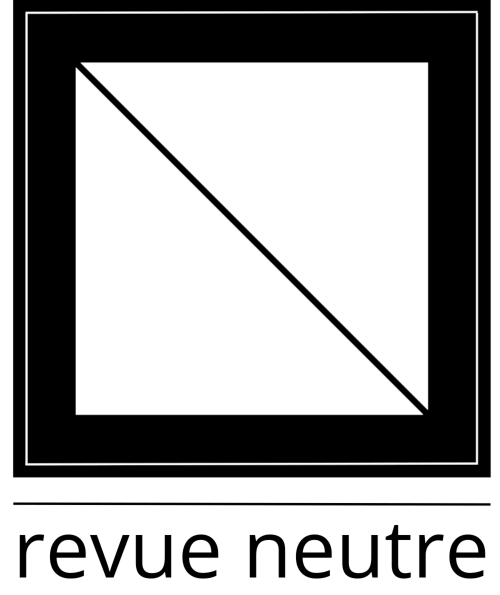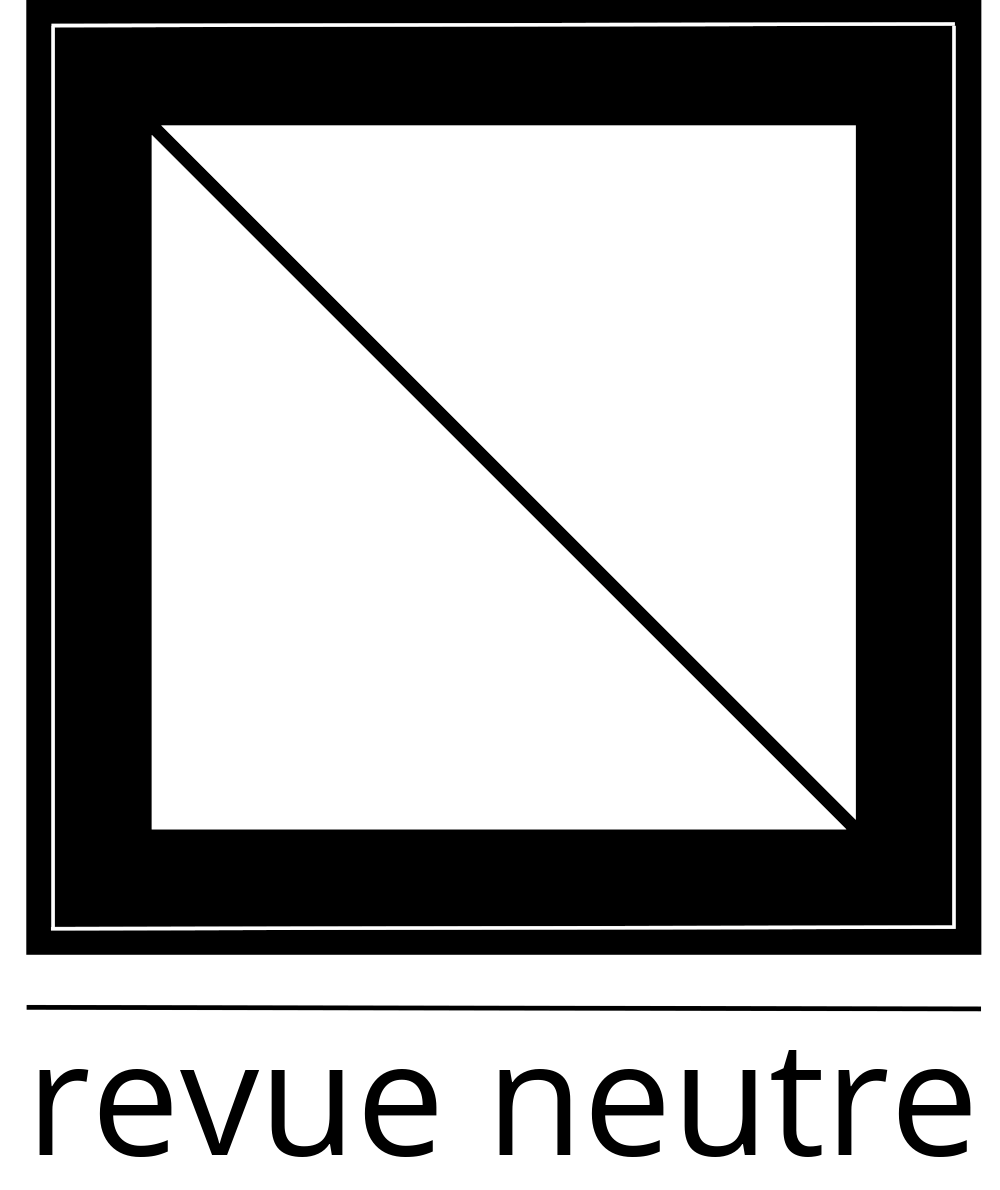TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE
Accueillir la folie. Freud, Hollós, un croisement manqué
Gloria Leff
István Hollós : premier psychiatre hongrois à exercer la psychanalyse
L’Association psychanalytique hongroise a été fondée en 1913, alors même qu’avait lieu l’une des plus importantes ruptures du mouvement psychanalytique : celle intervenue entre Freud et Jung, qui s’est manifestée lors du congrès de Munich tenu cette année-là. Cette rupture – qui a contribué à maintenir la démence précoce, dont l’étude a été introduite par Jung, à l’écart du champ freudien – annonçait l’échec des efforts de Freud pour que la psychanalyse parvienne à conquérir le milieu psychiatrique. Au fil des années, cet échec a conduit à une formation de compromis entre psychiatrie et psychanalyse : un « mélange tératologique », comme l’a nommé Jean Allouch, de deux méthodologies différentes que l’on trouve toujours dans l’analyse : la freudienne et la psychiatrique1. À cette époque, István Hollós devenait l’un des rares pionniers à se servir des thèses freudiennes pour engager une pratique analytique avec les patients qu’il prenait en charge dans diverses institutions de santé mentale en Hongrie. De fait, il est reconnu comme le premier psychiatre hongrois à exercer la psychanalyse. Il convient de noter que, par la manière dont il a fait cas de ce qui était son affaire – la folie –, il a réussi à introduire dans sa pratique une séparation radicale entre ces deux méthodologies. Cela a été possible parce qu’il est parvenu à mettre de côté la conception médicale de la folie et à suspendre la quête de sens.
Freud entendit parler de Hollós pour la première fois dans une lettre que Ferenczi lui envoya en décembre 1912. Ferenczi se félicitait d’avoir trouvé en Hollós « une personne digne de confiance » avec qui fonder la Société Psychanalytique de Budapest, et d’ignorer « les imbéciles prétentieux » qui l’entouraient2. Quelques années plus tard, alors que Hollós traduisait L’Interprétation des rêves, il consulta Freud de nombreuses fois. Comme cela apparaît dans une lettre de Freud à Ferenczi, il a eu neuf séances avec lui en mars 1918 afin d’analyser une « inhibition au travail ». Selon Freud, ladite inhibition reposait vraisemblablement sur le fait qu’il serait « allé assez loin dans son dépassement du père », et qu’il serait allé le voir pour constater « qu’il [Freud] ne valait pas grand-chose3 ». Si tel avait été le cas, on peut penser que ces neuf séances ont été particulièrement réussies. Mais nous n’avons pas le témoignage de Hollós sur ce point. En revanche, le 4 mai de la même année, Ferenczi écrit à Freud pour lui dire que Hollós avait eu une réaction assez rude « à cette dernière tranche d’analyse ». Il avait réagi « par une petite dépression et un délire de jalousie que, toutefois, il reconnaît comme tel et domine ». Ferenczi lui conseilla « de faire plutôt une petite tranche supplémentaire avec Freud4 ».
Ferenczi et Hollós ont entretenu une relation intense d’amitié et de travail. Même si dès le début Ferenczi prit le rôle de guide et de théoricien, tandis que Hollós se situait comme disciple et clinicien, il y avait entre eux une reconnaissance mutuelle. Dans le livre qu’ils ont publié ensemble en 1922, Psychanalyse et désordre psychique dans la paralysie générale5, on remarque la division des tâches entre les deux : Hollós présente les observations cliniques sur lesquelles Ferenczi se base pour élaborer la partie théorique. Une fois de plus, Ferenczi communique avec Freud en 1920 pour lui parler de la préparation de ce livre et de sa collaboration avec Hollós. Il s’avère qu’à l’époque, Ferenczi et sa femme vivaient dans une pension près de la célèbre Maison jaune – la principale institution de santé mentale de Hongrie pendant 139 ans (de 1868 à 2007) –, dont Hollós était le médecin chef. « Nous nous voyons souvent », écrit-il à Freud, « et nous voulons faire un travail psychiatrique ensemble6. »
Ces années-là, Hollós avait déjà une pratique importante dans les asiles hongrois. Après une année de pratique privée, il avait exercé comme psychiatre dans diverses institutions de province (Angyalföld, Nagykálló et Sibiu). Depuis 1900, il fit partie de Lipótmező (Champ Lipót), siège de la célèbre Maison jaune, considérée jusqu’à ces dernières années comme l’institution la plus avancée et moderne dans le domaine de la psychiatrie hongroise. Il y fut nommé directeur médical en 1919, poste qu’il occupa jusqu’en 1922, année où il fut congédié en raison de ses origines juives.
Cinq ans plus tard, en 1927, il publie ses mémoires. Il conclut son écrit par un éloge de Freud comme inventeur de la psychanalyse, avec la conviction que la découverte de l’inconscient transformera la vie des fous. On peut se demander jusqu’à quel point la rupture avec Jung avait conduit Freud à renoncer définitivement à son vœu de voir la psychanalyse conquérir la psychiatrie. Parce qu’il ne fait aucun doute qu’avec Hollós une voie s’ouvrait pour mener à bien ce projet. Mais… quoi qu’il en soit, sans que Hollós l’ait cherché ouvertement, il s’est produit entre lui et Freud un croisement manqué quant à l’accueil de la folie.
Une forme curieuse d’intolérance
Le 7 janvier 1928, Freud reçoit deux versions du livre de Hollós : l’original, en hongrois, Búcsúm a Sárga Háztól : Doktor Pfeiflein Telemach különös írása az elmebetegek felszabadításáról [Mes Adieux à la Maison jaune. Œuvre très insolite du Dr. Télémaque Pfeiflein, sur la libération des malades mentaux7]. Et le second, la traduction allemande par Heinrich Horvát intitulée : Hinter der gelben Mauer. Von der Befreiung des Irren [Derrière le mur jaune. Sur la libération des fous], édité par Paul Federn (Vienne) et Heinrich Meng (Stuttgart) en 19288.
D’habitude, Freud répondait promptement à ses correspondants. Cependant, cette fois-ci, il prit son temps. Ce n’était pas par manque d’intérêt par rapport au contenu du livre, encore moins par manque d’estime envers l’auteur. L’affaire était que l’éloge de Freud était accompagné d’un questionnement implicite : dans chacune des pages de son écrit, Hollós manifestait son engagement auprès des pensionnaires de l’asile et sa certitude que la psychanalyse avait frayé un chemin pour accorder une place à la folie. Pour sa dédicace des exemplaires adressés à Freud, Hollós aurait pu quasiment emprunter le titre de l’article que Jean Allouch écrivit soixante ans plus tard : « Êtes-vous au courant, Professeur Freud ? Il y a un transfert psychotique9 ».
On ne saurait ignorer à la fois l’honnêteté de la réaction de Freud à la proposition de Hollós et la fragilité dont il fait état devant ce qu’il ne parvient pas à comprendre. Nulle part ailleurs, à ma connaissance, sa position et ses limites à l’égard des fous et de la folie ne sont mieux exprimées :
Vienne, le 4 octobre 1928
Cher docteur,
Mon attention ayant été attirée sur le fait que j’avais négligé de vous remercier pour votre dernier livre, je veux espérer qu’il n’est pas trop tard pour réparer l’omission.
Cela ne vint pas d’un manque d’intérêt pour le contenu ou pour l’auteur que j’ai appris ici à connaître aussi en tant que philanthrope, mais cela résulte plutôt de réflexions inachevées qui m’ont longtemps occupé après la lecture et étaient de nature essentiellement subjectives. Avec une approbation sans limite pour votre chaleur humaine, votre compréhension, votre mode d’abord, je me trouvai pourtant dans une sorte d’opposition qui ne m’était pas facilement compréhensible. Je m’avouai finalement que cela venait du fait que je n’aimais pas ces malades, que je m’irrite contre eux de les ressentir si loin de moi et de tout ce qui est humain. Une forme curieuse d’intolérance qui me rend incapable d’être psychiatre.
Avec le temps j’ai cessé de me trouver moi-même intéressant ce qui analytiquement est certainement incorrect et c’est pourquoi je ne suis pas arrivé plus loin dans l’explication de cette position. Me comprenez-vous mieux ? est-ce que je me comporte par là comme les médecins d’autrefois envers les hystériques ? est-ce la conséquence d’un parti-pris devenu de plus en plus net pour la primauté de l’intellect, l’expression d’une hostilité envers le Ça ? Ou quoi d’autre ?
Avec, rétrospectivement, mes chaleureux remerciements et toutes mes salutations.
Votre Freud10.
Qu’a lu Freud dans ce livre qui, au lieu de le conduire, comme à d’autres occasions, à élaborer un nouveau fragment de théorie ou à remettre en question la pratique de l’un de ses disciples et adeptes, l’avait plongé pendant des mois dans une réflexion « essentiellement subjective » ? Dans quelle mesure le ton et l’approche de l’auteur ont-ils contribué à le confronter à cette opposition sourde et incompréhensible vis-à-vis de « ces malades » qu’il n’aimait pas, qui l’irritaient parce qu’il les sentait « si loin de lui et de tout ce qui est humain » ? István Hollós fut ce « Cher Docteur » à qui Freud confia ses sentiments les plus intimes à propos des fous et ses propres limites dans son accueil de la folie. On remarque le contraste avec la façon dont il a accusé réception de la thèse que Lacan lui enverra quatre ans plus tard : une simple carte postale dans laquelle il remercie de l’envoi : « Dank für Zusendung Ihrer Dissertation. Freud11. »
Mais il y a davantage dans les réflexions inachevées qui l’occupèrent pendant des mois, avant qu’il ne se décide à répondre à Hollós. Ce n’est pas la seule fois que Freud laisse transparaître, de différentes manières, la primauté qu’il accordait à l’intellect ; il suffirait de lire tout au long de son œuvre et de ses correspondances sa position vacillante concernant la télépathie, l’occulte, la mystique ; ses approches incessantes de ces questions qui l’interpellaient, pour tenter d’appréhender ce qui est difficile à concevoir, ce qui ne peut être prouvé ni représenté, ce qui n’est pas susceptible d’explication. La transmission de pensées, « d’autres choses appelées occultes » et das Es de Groddeck frappaient avec force à la porte de la psychanalyse et, en 1921, Freud considérait que ce qui avait été fait avec ces choses était « si inachevé, si fragmentaire pour l’instant ; [qu’]il faudrait une autre vie pour le faire mieux12 ». Néanmoins, bien que Freud n’ait pas abandonné son pari sur les capacités de la science pour transformer la nature de ces « objets d’étude », son ouverture à ces thèmes l’amena, à la fin de sa vie, à modifier sa relation avec l’approche de la science officielle, à ouvrir une sorte d’exploration imaginaire sur l’avenir de la psychanalyse et même à envisager la possibilité que la pensée analytique s’étende dans de nouvelles directions13.
Cependant, dans la lettre qui est restée inédite pendant plusieurs années, une nouveauté mérite d’être soulignée : la réception pleine et franche par Freud de ce que Hollós avançait l’amène à se demander, comme il ne l’avait jamais fait avec Groddeck en vingt-cinq années de correspondance animée et féconde, si dans cette primauté accordée à l’intellect il pouvait rencontrer l’expression d’une « hostilité envers le Ça ». L’intolérance qu’il ressentait à l’égard des patients accueillis par Hollós pouvait-elle être interrogée par ce terme forgé dans les échanges avec Groddeck ? Par ce terme que Freud avait d’abord rejeté, puis reformulé et qu’il s’était enfin approprié pour en faire une instance de sa deuxième topique14 ? Par ailleurs, cette hostilité dont il est question à l’égard du Ça pouvait-elle être examinée à travers le sentiment d’irritation que lui inspiraient « ces malades » ? Contrairement à Groddeck, Hollós n’était pas un interlocuteur de Freud, et peut-être cela mettait-il entre eux la distance nécessaire pour permettre un aveu. Parce que la réflexion de Freud ne passe pas par les relations entre l’âme et le corps, ni par l’opposition entre le Ubw et le Vbw ; pas non plus par la représentation adéquate pour donner une place à das Es. Ce qui est mis noir sur blanc n’est pas une question théorique mais une forme curieuse d’intolérance dans laquelle, d’une certaine manière, confluent subjectivement pour Freud les fous, la folie et le Ça. En outre, il met en lumière quelque chose qui avait été évité dans son explication théorique relative à l’inexistence du transfert psychotique. Ne peut-on lire dans la lettre tardive de Freud une confirmation catégorique du fait qu’il y a bien du transfert dans la psychose, et questionner sa spécificité ? Peut-être fallait-il un aveu de cet ordre pour situer l’origine de cette déclaration précoce et inamovible sur l’inexistence du transfert dans la psychose. Le témoignage de Hollós et l’aveu de Freud s’articulent pour définir de manière exemplaire le type d’implication que le transfert psychotique réclame15. Pour Hollós, il n’y avait aucun doute que dans le rejet du fou et de la folie, on rejetait ce qu’il y a de plus étranger, obscur et terrifiant en soi-même. Jusqu’à quel point Freud s’accorda-t-il avec Hollós sur ce point pour qu’à peine quelques années plus tard, en rédigeant « La décomposition de la personnalité psychique », il se serve de ce sentiment inexplicable pour décrire le Ça comme « la part obscure et inaccessible de notre personnalité16 » ?
Ősvalami, ősvalami, comme cela sonne étrangement pour moi !
Toujours est-il que Hollós n’était pas indifférent à ce que l’invention de das Es freudien impliquait. Pendant les années 1930, il entreprit avec Géza Dukes la traduction en hongrois de Das Ich und das Es. Ce fut une aventure différente de celle qui l’avait amené à s’engager dans la traduction de L’Interprétation des rêves. À cette occasion, Hollós avait trouvé dans la langue populaire hongroise le mot qui, selon lui, définissait le plus précisément ce que Freud exprimait avec sa Traumdeutung17, mais cette fois-ci, il fut confronté à un problème qui semblait insurmontable : trouver une expression hongroise adéquate qui pourrait refléter pleinement la signification de das Es. Jusqu’à ce moment, la littérature psychanalytique hongroise l’avait traduit par le terme ösztön-én (« Moi-instinctuel »). Le désaccord de Hollós et Dukes avec cette traduction fut total et, dans la préface qu’ils écrivirent pour la publication de cette œuvre, ils donnent leurs raisons. Pour commencer, ils affirment que, à travers l’examen de l’inconscient, Freud était parvenu au substrat psychique primordial, au fondement psychique qui touchait aux limites du corporel et, suivant Groddeck, l’avait nommé Es. Ensuite, de manière claire et concise, ils rejettent que das Es puisse être dénommé un Moi, car das Es est régi par ses propres lois et c’est le Moi qui, selon la construction de Freud, avait émergé de das Es. En examinant les figures proposées par Freud, Pola Mejía Reiss souligne que celles-ci ne montrent aucune prééminence du Moi sur le Ça18. Et c’est cela que Hollós et Dukes mettent en évidence dans leur critique de « ösztön-én ». S’il fallait encore le préciser, dans « La décomposition de la personnalité psychique », Freud désigne « das Es » comme un pronom impersonnel et souligne « son étrangeté par rapport au Moi ». Il ne s’engage pas dans une définition précise du terme et affirme qu’il ne peut être décrit que « par opposition au Moi19 ».
Ces considérations topiques occupent brièvement les traducteurs dans la première partie de leur préface, mais leur objection à cette traduction s’accompagne d’une proposition alternative. En effet, la manière dont Hollós et Dukes ont saisi l’œuvre de Freud se reflète dans l’expression hongroise qu’ils ont trouvée pour rendre compte de ce vers quoi pointe l’invention de das Es. Ce fut au cours de longues discussions avec Dezső Kosztolányi – l’un des poètes et écrivains hongrois parmi les plus proches de la psychanalyse – que, soudain, comme dans une illumination, le poète s’exclama « Qu’est-ce que cela pourrait être d’autre, sinon un “ősvalami” ?! » [« Hát mi lehet az más, mint “ősvalami” ?! »]. Les traducteurs y virent une trouvaille20. Ősvalami est un néologisme composé de deux mots : ős signifie « primitif », « ancien », « ancestral », « primordial ». Il est utilisé pour faire référence à quelque chose de fondamental ou qui est à l’origine de quelque chose. D’autre part, valami signifie « quelque chose ». En soi, c’est un mot qui dénote un indéfini, un concept ou une idée vague qui ne peut être définie avec précision. Pour mettre cela en contexte, dans la préface, il est écrit que « nous appelons valami tout ce qui est profond dans l’âme que nous pouvons ressentir mais que nous ne pouvons pas saisir consciemment ». Ce terme n’effleurait-il pas ce que Freud ressentait, mais ne pouvait pas définir avec précision, ce qu’il ne pouvait pas s’expliquer ?
Malgré cette remarque précise, s’efforcer de donner un sens à une telle invention reviendrait à passer à côté du cœur de la trouvaille : il ne s’agit pas seulement que le primordial, avec l’ajout de valami, puisse être qualifié d’indéfinissable, vague, imprécis ; ni que le valami, précédé de ős, touche ce primordial qui a ses propres lois, qui contient « nos pulsions instinctives et désirs inconscients ». Ce qui prend du relief avec le néologisme, c’est que le terme lui-même confronte à ce qui ne peut être ni défini, ni saisi, ni spécifié, ni délimité, ni localisé… Alors : neutre ? La question conduit inévitablement à l’aporie signalée par Barthes : parler le Neutre « c’est le défaire, mais ne pas le parler, c’est manquer sa “constitution”21 ».
Dans l’un des développements de Blanchot sur son « neutre », sa référence au aliquid est remarquable, à ce « quelque chose » qui résiste à la définition, auquel ne correspond aucune question, ce « quelque chose » par où pointe le bout du nez le « ősvalami » de Kosztolányi :
Neutre, ce mot apparemment fermé, mais fissuré, qualitatif sans qualité, élevé (selon l’un des usages du temps) au rang de substantif sans subsistance ni substance, terme où se ramasserait sans s’y situer l’interminable : le neutre qui, portant un problème sans réponse, a la clôture d’un aliquid [quelque chose] auquel ne correspondrait pas de question. Car peut-on interroger le neutre ? Peut-on écrire : le neutre ? qu’est-ce que le neutre ? qu’en est-il du neutre ? Certes on le peut. Mais l’interrogation n’entame pas le neutre, le laissant, ne le laissant pas intact, le traversant de part en part ou plus probablement se laissant neutraliser, pacifier ou passifier par lui (la passivité du neutre : le passif au-delà et toujours au-delà de tout passif, sa passion propre enveloppant une action propre, action d’inaction, effet de non-effet22).
Il suffirait de reprendre la phrase de Kosztolányi : « Hát mi lehet az más, mint “ősvalami” ?! » pour repérer comment, avec le biais de lecture que donne Blanchot, on y entrevoit ce quelque chose qui tend vers le neutre. Premièrement, le Hát imprime une nuance d’étonnement à l’expression ; ce n’est pas Dezső Kosztolányi qui réfléchit comment traduire : « ősvalami » s’impose à lui sans penser. Deuxièmement, avant de lancer cette trouvaille, il fait référence à ce dont il va parler comme un « cela » : « Mais qu’est-ce que cela pourrait être d’autre, … ? » Avec ce démonstratif neutre, le poète désigne un lieu marqué par l’indéterminé, l’impersonnel, l’indéfinissable. Troisièmement, s’agit-il vraiment de demander ce qu’est « ősvalami » ? Le néologisme ne définit ni n’explique : il surprend, il dérange.
L’assentiment des traducteurs fut immédiat. Leurs élucubrations prirent fin, et l’ouvrage de Freud a été intitulé en hongrois Az Ősvalami és az Én. Pour Hollós, il s’agissait d’un événement semblable à ceux auxquels il avait tant de fois assisté chez ces patients « qui ne trouvaient pas les mots adéquats pour exprimer leurs problèmes inconcevables, parce que les mots à leur disposition n’étaient pas suffisants en contenu, en couleur23 ». Dans un autre contexte, le mystère de la création du mot se répétait. Ce nouveau mot, comme ceux inventés parfois par ses patients, « contenait des concepts liés de manière incroyable », et le poète, plongé dans les discussions avec les traducteurs, exprime soudain en un seul mot le point de rencontre de ce qui ne peut être défini et de ce qui ne peut être localisé. Le fou et le poète confluaient indistinctement dans ce mystère créatif.
Il va sans dire qu’en tentant de traduire en français le néologisme, en séparant les deux mots qui le composent, on détruit immédiatement l’étincelle, l’étrangeté, l’effet de surprise qu’il produit et, par conséquent, sa pertinence. On pourrait dire d’une telle invention ce qu’Allouch a écrit à propos du chiffre : il se présente opaque, illisible, on ne peut pas passer rapidement en croyant l’avoir lu et compris : « ősvalami » constitue ostensiblement une énigme24. Ce n’est pas pour rien que le problème a interpellé même ceux dont la langue maternelle est le hongrois. Hollós et Dukes soulignent dans la préface que, puisqu’il s’agit d’un néologisme, le terme « ősvalami » peut sembler inhabituel, peut-être étrange, la première fois qu’on l’entend25. En paraphrasant ce que Nietzsche avait écrit sur le neutre, les lecteurs auraient bien pu s’exclamer : « ősvalami, ősvalami, comme cela sonne étrangement pour moi26 ! ». Les traducteurs avaient tellement raison d’affirmer que seul le temps serait un juge compétent, qui déciderait si le terme aurait ou non une viabilité. Aussi dérangeante qu’a été l’irruption du Es freudien dans la terminologie analytique, sa traduction en hongrois l’a été tout autant. À tel point que, selon Mónika Takácz, « ősvalami » a disparu comme terme du vocabulaire psychanalytique hongrois et, sans tenir compte des observations de Hollós et Dukes, on a repris l’impertinent ösztön-én27.
En s’immergeant dans la langue de ses patients, en travaillant dans sa propre langue avec le mystère de la création du mot, Hollós avait trouvé sa propre manière d’exercer la psychanalyse. En se libérant du jargon psychiatrique et même de la terminologie psychanalytique, à travers son imagerie poétique, ses réflexions, et son style pour articuler ses observations cliniques, Hollós est parvenu à exprimer – avec subtilité, aisance et une remarquable précision – jusqu’à quel point, en écoutant ses patients, il avait suspendu la quête de sens. Ce chemin que Hollós a trouvé pour accueillir la folie brille par éclats dans les petites histoires qui traversent les pages de Mes adieux à la Maison jaune. Dans sa réponse honnête, Freud reconnaît là une voie digne d’intérêt, que cependant il n’aura pas réussi à lui-même emprunter, en raison de ses propres limites.
.