TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE

Vitalité du neutre, neutralité du vital
Jean Allouch
Feu M. Pascal,
qui savait autant de véritable rhétorique
que personne n’en a jamais su,
portait cette règle jusqu’à prétendre
qu’un honnête homme devait éviter de se nommer
et même de se servir des mots « je » et « moi » […].
Ce n’est pas que cette règle doive aller jusqu’au scrupule1.
Une insolite question ici se présente : comment peut-il se faire que chacun se suppose ? Se suppose quoi ? Un soi, parfois lourdement redoublé en un soi-même, voire un moi-même, en un « moi-je ». Dans une langue bien moins plaisante que celle d’Arnauld et Nicole que l’on vient de lire, la modernité s’est aussi interrogée sur cet « être soi », y a même vu une fatigue, La Fatigue d’être soi2.
« Vitalité du neutre, neutralité du vital », ce titre n’est pas composé de deux énoncés. Il suffira que soit aperçue la vitalité du neutre pour que vienne au jour frisant la neutralité du vital – de cette vie qui s’en vient et s’en va sans se préoccuper plus que ça de tout un chacun.
Ce sera aujourd’hui mon lot de faire valoir l’intérêt pour l’exercice spychanalytique de la conjonction de « vitalité » et de « neutre ». J’éclairerai cette confluence selon trois problématiques liées : le on, le ça et le neutre lui-même, dont la percée dans la culture germanique a déjà fort bien été présentée par Pola Mejía Reiss. Chez Roland Barthes, le neutre est vital. Il est ce qui récuse, non pas frontalement mais radicalement, mais par un biais, le mortel « vouloir saisir » dont l’instrument est le langage, ce lot de signes et de sens imposés à qui parle une langue donnée. Selon Barthes, le bébé n’est pas, comme chez Lacan3, plongé dans un « bain de langage », mais pris dans un filet aux mailles serrées. Il ne nage ni ne s’ébroue dans un milieu aquatique (qui prolongerait, imaginé par certains, l’immense bonheur du fœtus baignant dans le liquide amniotique) ; il est d’emblée mitraillé, prisonnier d’un codage qu’il ne peut, au mieux, que fissurer – telle serait la fonction libératoire du neutre.
J’en suis venu au neutre pour avoir récemment distingué chez Lacan deux analytiques du sexe. Ce neutre était déjà là en puissance dès mon premier livre, Lettre pour lettre, qui prolongeait un exposé à l’École freudienne en 1979 ; j’y proposai de faire place à l’opération de la translittération… dont on n’a pas voulu alors même qu’elle était un prolongement de la conception lacanienne de la lettre. Différent en cela du traduire et du transcrire, translittérer (trois termes qui composent un ternaire cousin de S/I/R) se passe du sens, c’est une opération neutre, pas pour autant sans effets.
Dans l’histoire du mouvement freudien, un tel refus n’a rien de très nouveau. D’autres contributions ont aussi été plus ou moins sauvagement écartées alors qu’elles apportaient quelque chose d’inédit (Jung, Ferenczi, Groddeck, Reich, Klein, Lacan, etc.). La même année 1979, un propos de Lacan délivre la raison de tels rejets :
Tel que maintenant j’en arrive à le penser, la psychanalyse est intransmissible. C’est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé – puisqu’il faut bien qu’il y soit forcé – de réinventer la psychanalyse4.
Ce propos appelle une certaine conception de ce que pourrait être une école de psychanalyse, conception sur laquelle je ne me pencherai pas aujourd’hui. Ceux – dont je ne suis pas – qui annoncent vouloir transmettre citent souvent cette première déclaration en négligeant l’indication qui vient juste après, selon laquelle chaque psychanalyste se trouve forcé de réinventer la psychanalyse – valable pour qui le disait, sans aucun doute. D’ailleurs, notez-le, le souci affiché de transmettre contribue à rendre infertiles ceux qui en sont habités. Ce qui est cohérent car pour transmettre il faut s’imaginer propriétaire d’un patrimoine bien constitué ou d’un message qui ne l’est pas moins. Transmettre… on laissera ça aux religions. Un cas connu de vous a établi la vanité de cette intention patrimoniale : Freud a voulu transmettre sa psychanalyse en fondant l’IPA ; si transmission il y eut, elle s’est jouée ailleurs et autrement que prévu, celle que dénote un nom propre : Lacan, l’hérétique. Lacan qui fut lui aussi habité par ce souci de transmettre, qui choisit un biais familial que chacun peut aujourd’hui juger.
En renouvelant de part en part les notions psychanalytiques jusqu’à lui reçues, Lacan aura réalisé une opération barthésienne : se dégager de l’emprise de ce qu’un langage « freudien » impose à tout un chacun. C’est du neutre que Barthes attendait une telle soustraction d’un monde endoxal ; il ne l’espérait pas seulement d’un renouvellement des significations qui ne ferait que reconduire les intolérables contraintes langagières. En son temps et à temps, au bon moment, j’ai dénommé cette opération lacanienne : « Freud déplacé ».
ON
Bien des traits notoirement présents dans ce que Lacan a appelé « champ paranoïaque des psychoses » attestent que le on y soit vital.
On parcourra plusieurs manifestations de ce « on » : chez Albert Londres, Marguerite Duras, Émile Benveniste, Jacques Lacan, Nicolas Henckes. Ce sont les envoûtements d’Antonin Artaud qui m’ont conduit à ne plus négliger ce on dont le statut sémiotique reste flottant. Teinté de pensée religieuse, tout un courant de pensée s’élève là-contre, promeut la personne, la relation je-tu. Martin Buber s’y est illustré5, l’humaniste s’en repaît et avec lui les mots désormais magiques : la rencontre, le vivre ensemble, la réciprocité. La spychanalyse n’est pas un humanisme. Comment le serait-elle, elle qui a affaire à ce qu’on appelle l’inhumain ?
Albert Londres
Il aura fallu que quelqu’un de non envahi, de non occupé par le savoir psychiatrique et psychanalytique fasse un pas vers la folie (transfert psychotique6) pour que soit rendu patent le caractère souvent déterminant du « on » dans quelques-unes de ses diverses et notables manifestations.
Albert Londres, poète, journaliste d’investigation, a mené enquête chez les fous, ces « rois solitaires », écrit-il7. Il fut un homme d’esprit, de cet esprit qu’il sut recueillir dans les asiles. Alors qu’il cite la sœur qui l’accompagne lors d’une de ses visites et qui lui a déclaré que « la folie est une punition de Dieu », il commente, sans bien sûr récuser le propos : « Les hommes y ajoutent la leur » (p. 99) – une anticipation de l’Histoire de la folie à l’âge classique. Ou encore, alors qu’en sa présence une mère visitant son fils interné lui déclare : « Plutôt que de penser à cette Sainte Vierge tu ferais mieux de t’occuper de ta femme et de tes trois enfants », il conclut : « Ce qui prouve que si l’on enferme les fous, on laisse les idiots en liberté ! » (p. 104). Où se loge ici l’idiotie ? Cette mère ne peut concevoir qu’en s’intéressant à Marie son cher fils s’occupe bel et bien de sa femme et de sa progéniture.
Albert Londres prit acte de l’importance du « on » dans les discours de persécutés. Évoquant l’un d’eux, il écrit, soulignant le on : « La nuit on le guette, on l’espionne, on l’insulte » (p. 69). Et, peu après : « On ne cesse de s’occuper de lui, on le frappe, on le pince, on le martyrise par l’électricité, le fer, le feu, la nappe d’eau, les gaz ». Cette prégnance du « on », il ne l’invente pas : secrétaire de l’aliéné8, il la recueille.
Il entend un certain « Bibi du grand Univers » demander en criant : « Pourquoi l’on m’en veut ? » (p. 73. Le surligné signale que ce n’est pas Albert Londres qui attire l’attention dur le on) ; et une autre aliénée témoigner : « […] cette nuit on m’a fait le cercle de feu » (p. 75) ; une autre encore, qui a vu son mari transformé en diable par l’électricité et la radiogueraphie, dire : « Alors on me criait : “Catin de Ninon ! Catin de Ninon !” » (p. 76, certains reconnaîtraient là un automatisme mental ); une « veuve non joyeuse » demande « que l’on ne se livre pas sur elle à des pratiques d’auscultation épidermique » (p. 113).
Duras
Une incidence spécifique du on s’entend dans l’« on dit » – cet « on dit » qui déplaît lorsqu’il est vu comme malveillante rumeur mais qui, cependant, a rendu Marguerite Duras telle qu’en elle-même l’éternité l’a faite alors que, changeant radicalement son style jusque-là plutôt usuel et salué par Queneau, elle écrivait Le Vice-Consul9 et Le Ravissement de Lol V. Stein. Dans L’Amour, Duras se livre à ce que l’on pourrait appeler une épreuve de langue. À un certain moment de son texte, le pronom « elle », intempestivement qualifié de « personnel », disparaît de ses phrases : « Ne ressent pas être vue. Ne sait pas être regardée. Se tient face à la mer10. » Cette absence d’« elle » intensifie, magnifie une présence d’« elle » au lieu de l’Autre, porte cet « elle » absentifié jusqu’à pouvoir être idéalisé. On songe à un haïku qui, lui aussi, se dispense de la personne, est un neutre.
Émile Benveniste
Benveniste (se) demandait : le langage est-il voué « à ne consister qu’en instances “personnelles” ? » Sa réponse :
Il y a des énoncés du discours, qui en dépit de leur nature individuelle, échappent à la condition de la personne, c’est-à-dire renvoient non à eux-mêmes, mais à une situation « objective ».
Benveniste offrait au « on » son statut « pascalien » de neutre, soit : une « non-personne », un « n’importe qui ou n’importe quoi pouvant [je souligne] toujours être muni d’une référence objective »11. « La notion de personne, écrit Benveniste, est propre seulement au je/tu […]. » Elle n’est pas ou fort peu dans « il » / « elle », moins encore dans l’on. Ce on, dirais-je, peut être reçu ou porté, bien ou mal d’ailleurs ; en lui-même il n’est pas porté à la personnaison ; le on est un portable. Différemment du psy, lui si largement endossé. Votre position à l’instant ne sera pas la même si je vous demande : « Vous m’entendez ? » ou bien si je (me et vous) demande : « On m’entend ? » Cette seconde manière de m’adresser à vous laissera tout un chacun bien plus libre, libre de se retourner afin de voir si quelqu’un, si quelque on aurait répondu. De même, ce ne sera pas le même événement si quelqu’un déclare : « Je me suis fait voler mon stylo », ou bien : « On m’a volé mon stylo ». La lourdeur du psy est portée par le premier énoncé ; la légèreté de la liberté signifiée par le second. Il en va de même dans le bref récit suivant : à table en famille, un enfant casse un verre. Si une gifle ne vient pas aussitôt le sanctionner, la réponse reçue (en « tu) peut être : « Fais donc attention. ». Au sortir de l’événement, cet enfant sera plus libre si on lui a dit (réplique écrite par Walter Benjamin) : « Monsieur maladroit vous salue bien12 » ou bien (autre traduction) : « Avec les compliments de M. Maladroit. »
Un propos majeur de Lacan croise Benveniste. On n’y prend guère garde, tant d’autres propos semblent y contrevenir, promouvoir un dit « sujet de l’énonciation », un « je » que vient si facilement investir le « psy », l’occuper, en tenir lieu (se tenir en son lieu). On lit dans Encore :
Le « je » n’est pas un être, c’est un supposé à ce qui parle13.
Le biais de cette supposition est un malentendu, que Benveniste permet d’apercevoir en se livrant à ce que je qualifierai de science-fiction. Il fait observer que « si chaque locuteur […] disposait [au lieu du je], d’un “ indicatif“ distinct, […] il y aurait autant de langues que d’individus et la communication deviendrait impossible14 ». Le je est un jeu de langue, un signifiant flottant qui me désigne ici, qui là désigne quelqu’un d’autre. Quoique défini comme « pronom personnel », pris en lui-même, le je présente une face de démonstratif neutre, tel le « ceci » étudié plus avant. Ce que Benveniste a appelé « indicatif distinct » Kripke en a fourni une définition en le dénommant autrement. Il écrit : « un terme est un désignateur rigide si et seulement s’il se réfère au même individu dans tous les mondes possibles. ». Le je n’a pas cette propriété. J’ajouterai que cette supposition d’un je vu comme « indicatif distinct » étend plus avant son empire. Il n’y a aucune raison en effet d’admettre que si quelqu’un, dans un discours, un dialogue, un écrit, dit plusieurs fois je de supposer que c’est alors d’un même qu’il s’agit (d’une même personne, d’un même individu).
Où donc loge-t-on ce lacanien « je » méconnu supposé ? Parfois, à l’endroit où interviendrait le on (si le « je » n’y faisait obstacle en venant, de fait, se loger là). Le « on » est ici « ce qui parle » : un « cela qui », un « ça qui », un impersonnel, un neutre. Je n’invente pas ce jeu du neutre et du je. Elle a déjà été mise en œuvre par Perec15. Dans La Disparition, l’absence du « e » l’empêche de jamais écrire ni « elle » ni « « je » tandis que, comme en contrepoint, l’avant-propos voit proliférer les « on » (plus avant, on a noté le même phénomène chez Duras). Avant-propos :
On pillait, on violait, on mutilait. Mais il y avait pis : on avilissait, on trahissait, on dissimulait16.
Jacques Lacan
Le 16 décembre 1975, Jacques Lacan, l’un des plus notoires « chiens17 » de Freud, s’ébrouait de sa thèse qui venait d’être republiée : la paranoïa et la personnalité, disait-il alors, n’ont pas de rapport car « c’est la même chose ». En 1932, il avait cru apercevoir dans certains « troubles mentaux » des « troubles spécifiques de la synthèse psychique », synthèse qu’il dénommait alors « personnalité »18. Envisager la paranoïa comme « une réaction d’une personnalité19 » (thèse, p. 98) ne pouvait qu’ignorer le neutre on. La radicale et capitale rectification de 1975 fut un événement majeur20 ; il ouvrait la possibilité de prendre acte de l’incidence du neutre là où l’on n’avait pas su la voir.
Nicolas Henckes
Dans l’ouvrage « Mon cher confrère21 », Nicolas Henckes, chargé de recherches au CNRS, enseignant à l’EHESS, historien de la psychiatrie, note qu’au XXe siècle la pensée psychiatrique a pris ses marques sur :
l’idée que les individus développent leur vie psychique à partir d’une sorte d’infrastructure, la « personnalité » – notion voisine d’autres : le caractère, le tempérament.
La thèse de Lacan tapait dans le mille. Selon Henckes, la personnalité fut l’héritière de la théorie de la dégénérescence, et je préciserai qu’elle se trouve silencieusement reconduite dans l’idée de « structure ». On n’en a pas fini avec la personnalité et la dégénérescence (son arrière-fond) quand on parle d’une « structure hystérique », « obsessionnelle », etc., quand bien même Lacan aura écarté cette personnalité axiale dans sa thèse.
Hormis dans ses marges22, on chercherait en vain quelque référence au neutre dans cette thèse. Il reste cohérent que, alors promoteur de la personnalité, Lacan ignore le neutre. Ce que confirment les remarques de Henckes.
LE ÇA
Quel est le tout premier mot le plus souvent prononcé lorsque deux personnes se rencontrent ? On interroge : « Ça va ? » On demande si le ça va. Ce ça vient ici porté par une intrusion, un manque de délicatesse : Beckett détournait l’intrusion, répondait en un soupir désolé : « Ah ! je me le demande. »
À diverses reprises, l’analyse a approché le neutre, sans jamais cependant lui offrir la place qui lui revient – à commencer par l’exercice analytique lui-même qui s’en trouverait pourtant allégé (le Neutre selon Barthes : sortie non conflictuelle des conflits, cependant pas pour autant un « ni-ni », ce dernier vu par Barthes comme étant « la caricature du Neutre »).
À l’endroit du neutre, tout s’est passé comme si, avançant une main tout près d’un foyer incandescent, certains psychanalystes l’avaient aussitôt retirée par crainte d’être brûlés (de perdre l’individualisant « psy » ? la personnalité ? la structure ?).
Freud réserva un accueil mitigé à ce ça que (lui) proposait Groddeck. Parmi les quelques citations de Freud que je vous épargne, je n’en retiendrai ici qu’une seule où, distingué du moi, le ça est vu comme « un chaos, un chaudron plein d’excitations en ébullition », aspirant à « procurer satisfaction aux besoins pulsionnels ». N’est-ce pas là une manière de vitalité ? Groddeck avait présenté le ça comme « ce par quoi l’on est vécu », un énoncé où, d’un même mouvement, place est offerte au neutre « on » et à la vitalité.
La vitalité ne se définit pas simplement par une opposition frontale à la mort, moins encore par opposition à cette mort reconnue pulsion avec Freud. Lacan en précisait les coordonnées freudiennes :
Dans la pensée de Freud en revanche, la vie n’est plus, pour citer Bichat, l’ensemble des forces qui résistent à la mort, mais l’ensemble des forces qui signifient que la mort est pour la vie son rail » (15 février 1967).
Une vie duraille. La Vie du rail est le nom que les cheminots de la SNCF ont élu pour leur magazine. Il y a une vitalité duraille du ça. Celle que Pasolini (cité par Barthes23), lui qui tenait tant au caractère sacré de la vie, appelait « una disperata vitalità ». Celle d’Artaud :
Pour exister il suffit de se laisser être
mais pour vivre,
il faut être quelqu’un,
pour être quelqu’un,
il faut avoir un os,
ne pas avoir peur de montrer l’os
et de perdre la viande en passant24.
Celle, aussi, de Lacan présentant la vie comme une « gueule ouverte », une « assimilation dévoratrice25 » (Le Transfert…, 5 mars 1961). Les ayant précédés, voici l’aride Kant, guère attendu ici, selon qui la vie est « la puissance (Vermögen) qu’a un être d’agir d’après les lois de la faculté de désirer (Begehrungsvermögen) ».
Récemment invité au centre Rachi, Erri de Luca faisait observer que ce n’est pas l’espoir qui fait vivre, lui qui maintiendrait en attente de jours imaginés meilleurs, mais le désespoir, lui qui conduit des migrants sur de dangereux chemins où ils risquent leur vie. Hegel, convoqué par Lacan :
Hegel formule que l’individu qui ne lutte pas pour être reconnu hors du groupe familial n’atteint jamais à la personnalité avant la mort26.
On appellera « vitalité » ce qui fait précisément défaut à l’héroïne de La Femme gelée d’Annie Ernaux : très appliquée à réaliser ce qu’elle imagine devoir être sa vie, cette femme a rempli toutes les consignes qu’une société occidentale moderne tente d’imposer aux femmes, tout au moins d’un certain milieu (scolarité réussie, bons rapports avec l’entourage, copines sympas, études universitaires, mariage, enfant, travail bien rémunéré) : appliquée, oui, elle l’est, mais en négligeant de vivre – consigne jamais indiquée. Elle se découvre hégélienne : une vie qui n’est pas risquée ne vaut pas la peine d’être vécue.
Groddeck n’a pas proposé, ni même envisagé de chasser l’inconscient au profit du ça. Le ça est, au neutre, un nom pour la vitalité de l’inconscient. Il écrit :
Le Ça vit l’homme ; c’est la force qui le fait agir, penser, grandir, être bien portant et malade, en un mot qui le vit (p. 308, italique de Groddeck).
Ce n’est pas vers son ineffable singularité (un « je » à nul autre pareil, bien fait pour titiller le narcissisme de la petite différence) que l’analyse oriente l’analysant (elle laisse cela à la psychologie qui s’en repaît), bien plutôt lui offre-t-elle un accès plus souple, ouvert et libre à cela, à ce là, à ce ça dont, au départ, il n’a que des signes diversement encombrants ou jouissifs (ou les deux). Une analyse qui a eu effectivement lieu se boucle non pas dans le conflit mais au neutre.
LE NEUTRE
C’est une autre manière de psychanalyse qui vient au jour dès lors que sa place est accordée à la vitalité du neutre. Cette psychanalyse devenue spychanalyse n’est alors pas indéfinie. Deux traits marquent l’intervention du spychanalyste qui serait réglée sur le neutre : la délicatesse, le kairos. Ces deux traits ont été mis en avant par Roland Barthes dans son cours sur le Neutre.
Le principe de délicatesse, ce « désir du neutre »
Qui l’évoque avec délicatesse ne peut que s’abstenir d’en produire un concept. Eux aussi, les théoriciens de l’Inde ancienne étaient avertis que « le péril de l’intervention de la logique est grand en matière de poétique27. » Ce fut la performance de Roland Barthes (son cours sur le Neutre), non pas celle d’Éric Marty (son livre La Sexualité des Modernes) auquel un manque de délicatesse de la part de certains psychanalystes, redoublant le sien, a offert un accueil emballé sans avoir été pesé. En prolongeant le modus operandi de Groddeck, on préférera évoquer la délicatesse à l’aide de plusieurs historioles lacaniennes.
I Parce que c’était amusant, j’ai déjà raconté ce qui a eu lieu d’inattendu lors de mon premier rendez-vous avec Lacan, alors que je venais lui demander de m’accepter en analyse28. Je l’informe être en analyse chez l’un de ses élèves que, bien entendu, je nomme, et lui fais part de mon mécontentement. Il me fâchait, le bougre, avec ses interprétations voulues lacaniennes. Lacan met fin à cette pas encore « séance » sans me dire qu’il m’acceptait en analyse. Très déçu, presque décomposé, je reste un instant le bec dans l’eau jusqu’à ce que, sorti du consultoire, une pensée me traverse : « Mais bien sûr, il ne pouvait pas me donner la réponse si attendue car je n’avais pas clairement annoncé à Rosolato mon départ de chez lui ! » C’eût été un manque de délicatesse de la part de Lacan de m’avoir proposé un deuxième rendez-vous. Un manque de délicatesse vis-à-vis de ma demande, et à l’endroit de Rosolato qui n’en sut jamais rien.
Un contre-exemple vient ici. Premier rendez-vous d’un interne en psychiatrie auprès d’un didacticien de l’IPA. Il lui fait part de sa demande de didactique et de ses salades et reçoit cette réponse : « Faisons d’abord tranquillement votre analyse personnelle, on verra plus tard pour la didactique. » Ce psychanalyste n’a jamais revu le type en question qui a d’emblée compris qu’il avait eu affaire à un imbécile.
II Mon livre sur les chries29 de Lacan comporte beaucoup d’historioles où perce la délicatesse, notamment celle-ci :
Jupe fendue
De visite, en entretien ou en contrôle chez Lacan, chacun s’asseyait sur une petite chaise basse, si basse que les genoux, pour peu que les jambes soient repliées, s’élevaient sensiblement plus haut que les fesses.
Elle vint, pour ce contrôle, affublée d’une jupe généreusement fendue et, nécessité faisant loi, une fois assise, se trouva offrir un spectacle au-delà de ce que la coutume d’une époque pourtant fort libérale admettait sans problème.
— Quelle belle jupe ! commente Lacan30.
Lacan n’est pas en train de draguer. Quoique… L’intervention suspend l’éventuelle exhibition, s’en détourne, la détourne ; « Le verbe déjoue ce qui est attendu », écrit Barthes présentant la délicatesse (p. 58) ; il répond, délie, dissout, en un mot, il analyse. Cette intervention de Lacan résonne aussi avec la remarque barthésienne selon laquelle le temps suspendu est « une définition du neutre lui-même » ; un « temps pour comprendre » écrit Barthes, à ne pas confondre avec celui, voulu « logique », de Lacan.
Kairos
Quel psychanalyste récuserait qu’une interprétation se doit d’être délivrée « au bon moment » (Freud) ? Avec tact ? Cela semble aller… de soi. Il reste qu’il y a là un tour de main qui réclame que l’on y regarde de plus près, une version du kairos qui fait problème. Freud écrivit à Marie Bonaparte :
[…] en interprétant de manière hâtive, on gaspille le plus précieux, le pur, les choses doivent se révéler d’elles-mêmes […]31.
Freud écarte ici ce qui fut appelé « éjaculation précoce de l’interprétation », où vient au jour le peu avenant schéma d’un psychanalyste viril (homme ou femme) et d’un patient femme (homme ou femme). Toutefois, avec Lacan, s’agissant du kairos, c’est une autre figure du psychanalyste qui vient au jour, celle d’un psychanalyste maître. Elle transparaît dans l’innovation technique lacanienne qui s’est tardivement appelée « ponctuation » ou « scansion » (de la séance). L’analyste « sait mieux que personne [sic !] que la question y est d’entendre à quelle partie de ce discours est confié le terme significatif, et c’est bien ainsi qu’il opère32 ». Mieux que personne ? On rit. On rit de ce même rire qu’Antonin Artaud adressait au pouvoir psychiatrique : « Laissez-nous rire. »
On ne déniera pas pour autant l’usage du terme kairos concernant cette habileté (lacanienne) de l’analyste, son tact tandis qu’il intervient. Selon Barbara Cassin, elle est celle des Sophistes33. Barthes présente Protagoras dans des termes où l’on retrouve quasi tel quel ce qui vient d’être relevé chez Lacan :
Protagoras a établi la force de l’à-propos (dunamis kairou). Il proclamait qu’il possédait un savoir total, et qu’il pouvait se permettre de parler de n’importe quoi à propos (to kairo) un art de l’Instant Opportun : kairou chronou téchné34.
Toutefois, ce rappel sert à Barthes de contrepoint introduisant un autre abord du kairos, celui des Sceptiques, plus conforme à ce qu’il entend faire valoir comme étant le Neutre. Dans « Constructions dans l’analyse » (1937), Freud se montre sceptique. Il se demande :
Qu’est-ce qui nous garantit, pendant que nous travaillons aux constructions, que nous ne faisons pas fausse route et que nous ne compromettons pas la réussite de la cure en soutenant une construction inexacte ?
Ladite « construction » reste en attente de sa validité – je ne dis pas de sa vérité – pour autant toutefois qu’elle soit proposée sans arrogance. Barthes :
Je réunis sous le nom d’arrogance tous les « gestes » (de parole) qui constituent des discours d’intimidation, de sujétion, de domination, d’assertion, de superbe : qui se placent sous l’autorité, la garantie d’une vérité dogmatique, ou d’une demande qui ne pense pas, ne conçoit pas le désir de l’autre35.
L’interprétation reste fragile, elle laisse place à un suspens qui « empêche le système – en l’occurrence le fantasme – de prendre » (un trait qui caractérise le kairos selon Barthes, p. 216). La nécessité s’y efface, laissant place à la contingence. Fragile, l’interprétation est aussi délicate. Elle « détache un trait » et le fait « proliférer en langage » (« la métaphore crée la délicatesse »). Elle est « quelque chose comme un état amoureux » « décroché du vouloir saisir (un/une partenaire36) ». Il n’y a de vitalité qu’à la condition de ne pas vouloir à tout prix en être le maître.
L’interprétation est porteuse d’un taire, d’un silence qui est celui du spychanalyste. Reconnaître que ce silence soit une certaine manière d’aimer charrie bien des ambiguïtés ; elles sont toutefois levées par Lacan ayant déclaré en 1972 que l’analyste est frère de l’analysant37. Je ne sais rien de mieux pour faire entendre ce si spécifique silence qu’une strophe de Marguerite Yourcenar, après quoi, bien sûr, je me tairai. Le silence y est reconnu porteur d’une parole. On y entendra aussi tout à la fois le neutre, la délicatesse et la vitalité :
Voici que le silence a les seules paroles
Qu’on puisse, près de vous, dire sans vous blesser :
Laissons pleuvoir sur vous les larmes des corolles ;
Il ne faut que sourire à ce qui doit passer38.
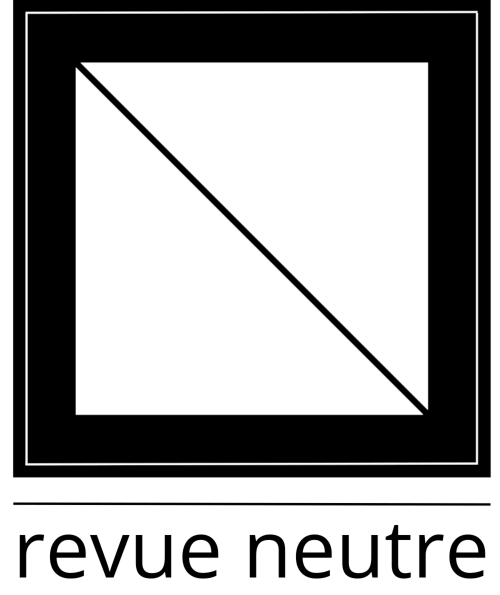

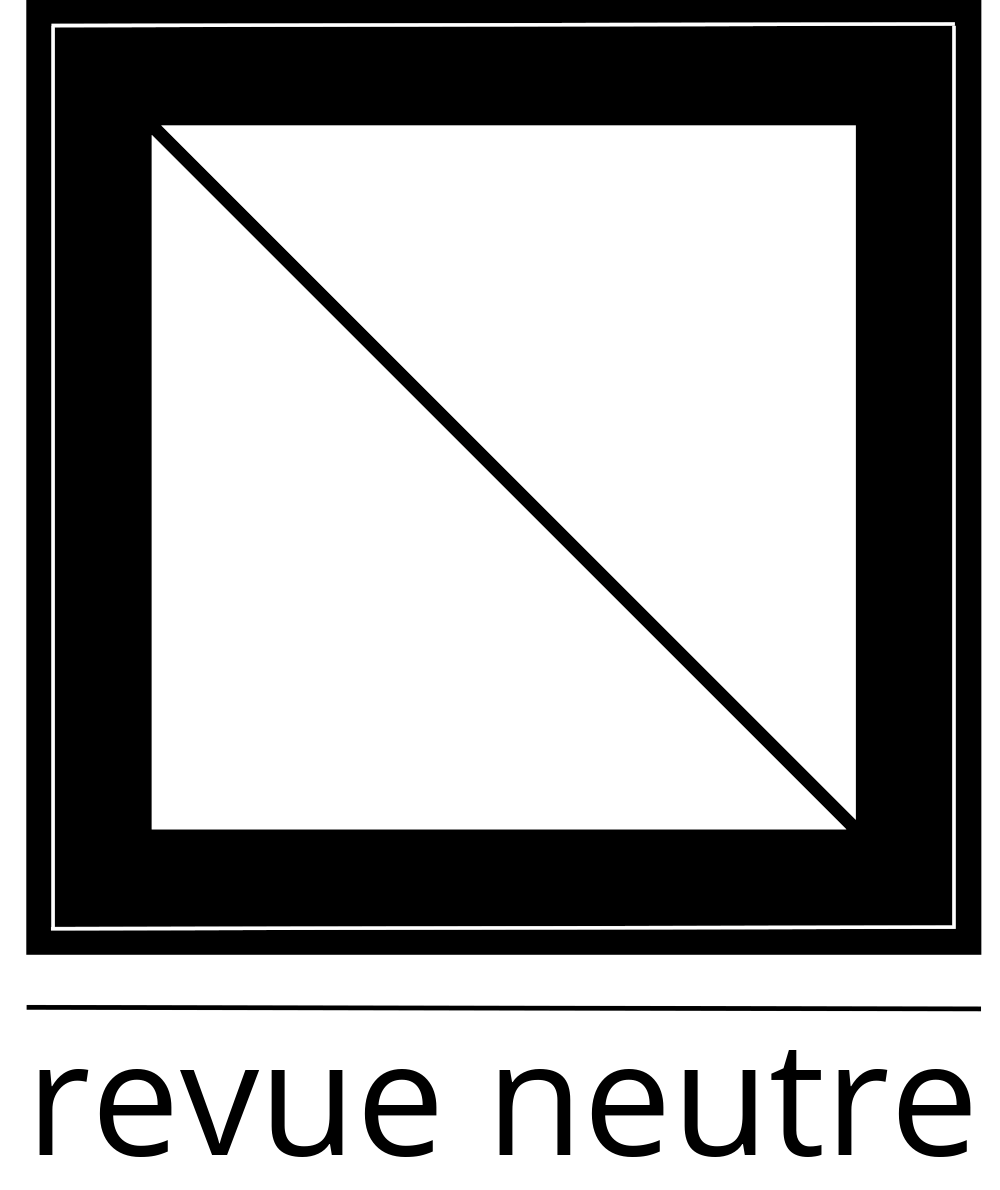

[…] https://revueneutre.net/vitalite-du-neutre-neutralite-du-vital/ [visitado última vez 11 de marzo de 2024.] […]